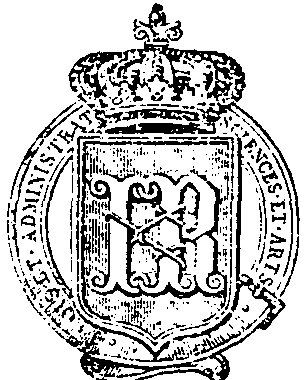
RECHERCHES
SUR
LES LANGUES CELTIQUES
PAR W. F. EDWARDS
MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ETC.
OUVRAGE PRÉSENTÉ
A L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES
LE 26 DÉCEMBRE 1831
ET QUI A OBTENU LA MÉDAILLE DU PRIX VOLNEY DÉCERNÉ PAR L'INSTITUT
DANS SA SÉANCE DU 2 MAI 1834
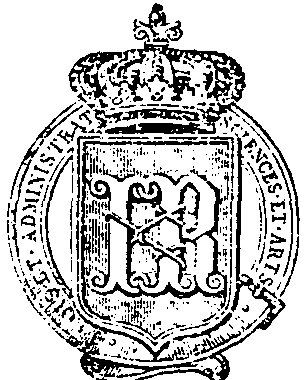
PARIS
IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU ROI
A L'IMPRIMERIE ROYALE
_____
M DCCC XLIV
AVERTISSEMENT.
———
En se livrant à l'étude de l'anthropologie, mon frère a compris que la grande question de l'origine des diverses races humaines ne pouvait être résolue tant que les observations du naturaliste, les recherches du philologue et l’érudition de l'historien ne viendraient point se prêter un mutuel appui ; aussi, sans se laisser effrayer par l'étendue d'une pareille tâche, s'est-il appliqué en même temps à l'examen des caractères physiques des peuples, à la comparaison des langues et à la discussion des faits historiques. Sa vie, malheureusement, a été trop courte pour lui permettre d'achever une oeuvre aussi vaste. La plupart des résultats auxquels il était arrivé sont maintenant perdus pour la science ; mais, tout en préparant les matériaux pour l'Histoire naturelle de l'homme, qu'il se proposait d'écrire, il a traité, avec plus ou moins d’étendue, quelques-uns des points dont il s'était plus spécialement occupé. Sa Lettre à M. Amédée Thierry contient l'énoncé de principes fondamentaux pour l'étude des caractères physiques des races ; et dans divers mémoires, imprimés, par les soins de la Société ethnologique de Paris, on trouve l'indication de vues nouvelles relatives à l'origine des peuples de l’Europe. L’ouvrage posthume que sa veuve publie aujourd’hui fait partie de la même série de travaux. Il m'appartient moins qu'à tout autre d'en juger ici le mérite, mais je puis le citer comme une preuve de l'étendue et de la variété des connaissances du profond physiologiste à qui l'on doit le traité de l’influence des agents physiques sur la vie.
Des louanges de la part d'un frère pourraient paraître entachées de partialité ; je m'abstiendrai, par conséquent, de toute réflexion sur les services que William Edwards a rendus aux sciences naturelles, et d'ailleurs il n'est aucun physiologiste qui les ignore. Mais puisque j'ai été conduit à parler au public d'une personne dont la mémoire m'est si chère, qu'il me soit au moins permis d'ajouter un mot sur l'homme privé, et de dire que, dans l'estime de toits ses amis, il était aussi liant placé pour les qualités du coeur que pour l'élévation de l'esprit.
H. Milne EDWARDS.
Paris, ce 23 octobre 1844.
MÉM0IRE
EN RÉPONSE A LA QUESTION SUIVANTE,
PROPOSÉE
PAR L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES :
Déterminer, par un travail à la fois lexicographique et grammatical, le caractère propre des idiomes vulgairement connus sous le nom de celtiques en France et dans les îles Britanniques, et rechercher la nature et l'importance des emprunts qu'ils ont faits, soit au latin, soit aux autres langues.
___________
L'Académie a rendu un grand service en appelant, par la question qu'elle a proposée, l'attention des Français sur les langues jadis parlées par leurs ancêtres.
Ce sujet ne pouvait guère être proposé plus tôt ; il fallait que les règles de critique, qui doivent servir à caractériser et à comparer les langues, fussent établies sur des bases scientifiques, ce qui exigeait une étude approfondie d'une foule de langues, tant anciennes que modernes : c'est ce qui a été fait, et l'Académie y a puissamment contribué.
La linguistique est née de nos jours. On a parcouru toutes les contrées de la terre, partout on s'est attaché à connaître les idiomes usités, et dans les temps actuels et dans les temps les plus reculés. On est revenu chargé d'une riche moisson. On a étudié ces langues chacune en particulier, on les a comparées, distinguées, classées. Il est résulté de ces travaux, des principes qui servent de base à la science nouvelle qu'on a appelée linguistique.
Mais parmi les langues qui ont été l'objet de cette étude, on ne saurait guère compter celles qui ont été en usage, depuis la plus haute antiquité, dans la France et dans la Grande-Bretagne, et qui sont encore parlées dans quelques portions de, ces pays.
Les savants qui se sont occupés de cette science y ont cependant jeté un coup d'oeil. Il leur a suffi, pour reconnaître dans les idiomes que nous distinguerons, dans la suite, par le nom de celtiques proprement dits, des rapports assez marqués avec la grande famille appelée indo-germanique, et pour les ranger dans cette division.
Un autre idiome, le basque, que l'on a quelquefois nommé celtique, a été profondément étudié par un savant célèbre dont nous citerons plus tard les travaux.
D'autres savants, nés dans les provinces où se parlent encore ces idiomes, s'en sont occupés spécialement, à la vérité, mais en général dans d'autres vues. Ils ont soigneusement recueilli les règles du langage et les mots qui en constituent le corps (c'est un grand service rendu, et leurs travaux sont précieux) ; mais, quand ils ont voulu porter leurs regards au delà, ils ont élevé des prétentions si extraordinaires relativement à l'influence et à l'extension de leur langue maternelle, qu'ils ont excité dans le public, en général, les préventions les plus défavorables. Ces préventions n'étaient pas sans fondement, car les prétentions des celtisants étaient poussées jusqu'au ridicule ; de façon qu'antiquités celtiques et fables absurdes étaient à peu près synonymes. De là un sentiment opposé à celui qui animait ces érudits. Un préjugé aussi déraisonnable, aussi aveugle, est allé, au moins en Angleterre, jusqu'à la fureur.
Il est temps de faire intervenir la raison dans cette question.
L'Académie en fournit l'occasion et les moyens. En appelant l'attention sur les idiomes vulgairement connus sous le nom de celtiques, parlés dans la France et dans la Grande-Bretagne, elle donne la latitude, ou impose l'obligation de traiter des langues basque, gaëles (irlandaise et écossaise), galloise et bretonne.
Toutes ces langues, à l'exception de la première, ont constamment été appelées celtiques.
La première, le basque, a été désignée de même par occasion.
Ainsi, elles entrent toutes dans la désignation d'idiomes vulgairement connus sous le nom de celtiques. Mais dans le cours de ce travail, j'emploie souvent l'expression de celtiques proprement dites, pour désigner celles qui suivent la première que j'ai nommée ; et quand je veux les embrasser toutes, je dis langues celtiques en général.
J'ai donc pris les paroles de l'Académie dans leur plus grande extension. Lorsqu'elle veut qu'on caractérise les idiomes par un travail lexicographique et grammatical, elle exige nécessairement qu'on compare ces langues entre elles, pour faire connaître en quoi elles se ressemblent, en quoi elles différent.
C'est ce dont je me suis occupé.
Quand l'Académie demande qu'on recherche la nature et l'importance des emprunts que ces idiomes ont faits, soit au latin, soit à d'autres langues, elle veut qu'on les compare à ces langues, c'est-à-dire que l’on détermine, s'il est possible, ce qu'ils ont essentiellement de commun avec elles, comme langues sœurs, si elles le sont, et ce qu'ils leur ont emprunté ; car comment reconnaître les emprunts, si l'on ne connaît pas les besoins ?
En traitant de la grammaire, j'ai traité les points fondamentaux et caractéristiques. Je n'ai pas supposé d'emprunts, lorsqu'il y avait des rapports avec le grec et le latin, parce que ces points sont de l'essence de la langue, et que d'ailleurs ils ont été de même dans les temps des plus anciens monuments de ces langues ; et il en est qui en conservent de très-anciens, au moins relativement l'époque actuelle, car les Gallois ont une grammaire du IXe siècle et qui ne se ressent en rien de l'esprit des grammairiens latins.
Quant à la partie lexicographique, la question est autrement difficile. L'Académie a imposé une rude tâche, quoiqu'elle soit aisée en apparence ; et elle l’est en effet sous plusieurs rapports ; mais il en est d'autres où l’investigation est, à ce qu'il me semble, nouvelle.
Il est de toute évidence, et d'après les principes établis, que lorsqu’une nation a une certaine idée, ou une certaine chose qu'elle n'a pas inventée, et qu'elle en a le mot, qui se trouve aussi chez le peuple qui a eu primitivement cette idée ou cette chose, elle lui a emprunté ce mot. Or, toutes les fois qu'on peut remonter à l'origine, on reconnaît l'emprunt.
A cet effet, il faut être instruit de la civilisation relative des deux peuples. C'est ce que l'histoire ne donne pas toujours, et, même sur les points où elle nous éclaire beaucoup, elle ne nous dit pas tout ce qu'il faudrait pour décider les questions qui peuvent se présenter. Ainsi nous savons avec la dernière certitude que les Romains ont enseigné la religion chrétienne aux peuples que nous avons appelés celtiques ; mais s'ensuit-il que tous les mots employés par les Romains dans l'exposition de leur culte et de leurs dogmes, et qui se trouvent dans les deux langues, soient des emprunts que les Celtes aient faits aux Romains?
Parmi ces mots, il en est qui expriment des idées communes à tous les peuples qui ont tant soit peu de civilisation. Par exemple, les idées de Dieu, d'esprit, de ciel, de création, de croyance, etc. sont des idées communes à tous les peuples qui ne sont pas. des brutes. Les Allemands n'étaient guère avancés dans la civilisation, en prenant ce mot, par opposition avec l'état sauvage, lorsqu'ils embrassèrent la religion chrétienne ; cependant les idées que je viens d'indiquer et une foule d'autres qui se rapportent à ce sujet sont exprimées dans leur langue avec des racines et des combinaisons qui leur sont propres. Sans doute ils ont fait des emprunts qu'il est facile de reconnaître, mais on les reconnaît eu ayant recours à d'autres principes.
Voici la difficulté dont il s'agit, exprimée d'une manière générale.
Nous supposons qu'il y ait deux langues sœurs, et il faut l'admettre, ou il n'y aurait point de linguistique. Or, on entend par langues sœurs, deux langues qui ont un fonds commun et indépendantes l'une de l'autre, quels que soient les emprunts qu'elles aient pu se faire d'ailleurs, sans quoi il n'y aurait pas de degré de parenté.
Maintenant, comment distinguer les mots qui constituent ce fonds commun et indépendant, de ceux qui résultent des emprunts qu'elles ont pu se faire ?
Y a-t-il des caractères, pris dans les langues, mêmes, qui puissent nous en fournir les moyens.
Les mots étant essentiellement composés d'un son et d'un sens, nous allons les considérer sous ce double rapport.
D'abord, les langues reçoivent un caractère distinctif de la nature des sons élémentaires qui entrent dans la formation du mot, et de l'ordre dans lequel ils sont combinés.
Il est si vrai que cette qualité et cette combinaison servent à les distinguer indépendamment du sens, qu'une personne qui a l'oreille exercée peut reconnaître une langue étrangère, qu'elle aurait entendu parler, sans en comprendre un mot. Elle juge la plupart du temps par sentiment ; mais on peut, quoique ce soit difficile, établir des principes par l'analyse.
Les mots eux-mêmes, c'est-à-dire considérés sous le double rapport que nous avons indiqué, fournissent des caractères plus sûrs et plus faciles. S'ils sont composés et qu’un de leurs éléments n'appartienne qu'à une langue, le mot commun doit être attribué à l’autre.
Il est possible que cet élément qui ne se trouve pas dans une des langues y ait existé et soit perdu ; il n'en faut pas moins ranger le mot dans la classe de ceux qui sont empruntés, parce que la probabilité l'exige. Or, à la rigueur, presque tous les mots sont composés, surtout dans les langues auxquelles nous avons à comparer les langues celtiques. Les mots y ont une physionomie qui les fait reconnaître comme appartenant à telle ou telle partie du discours. Ce caractère dépend de la terminaison du mot ; car les noms, les verbes, les adverbes, etc. ne se terminent pas ordinairement de même, mais ont, la plupart du temps, une inflexion qui les distingue. C'est ce qui a fait établir deux éléments dans les mots, la racine et la syllabe affixe. La première désigne l'idée fondamentale d'une manière générale, la seconde la détermine et en fait une partie spécifique du discours. Cette même racine peut avoir un emploi très-étendu, modifié chaque fois par une nouvelle terminaison.
La racine simple est également variée, dans la même étendue, par une particule qui la précède et qui lui est unie.
Ces mots, modifiés des deux manières que je viens d'énoncer, peuvent être jugés par la même règle qui sert à reconnaître l'origine d'un mot composé de deux racines, comme nous l'avons exposé plus haut.
Tout ce qui précède est évident et reconnu, et n'exige pas qu'on s'y arrête.
Mais voici le point difficile, et où je ne vois pas qu'il y ait des principes établis pour nous conduire.
Si dans les deux langues il y a une racine commune, et qui soit terminée, dans chacune d'elles, par une affixe propre à la langue, comment reconnaître s'il y a emprunt, lorsque ni les données de l'histoire, ni les considérations tirées de la nature et de la combinaison, ne nous en fournissent les moyens ?
Lorsque les deux peuples ont eu de fréquentes communications, et à plus forte raison lorsque l'un a dominé sur l'autre, il faut nécessairement que le peuple dominé, lors même qu'il conserve sa langue, ait emprunté même des mots qui expriment des idées communes. Il est vrai que la plupart du temps il empruntera le mot et son affixe en tout ou en partie ; mais il lui arrivera quelquefois de conserver la racine, et de substituer à la terminaison étrangère une terminaison nationale.
Mais, quoiqu'on sache, en général, que cela doit arriver, quel moyen y. a-t-il de distinguer ces mots et de reconnaître l’emprunt. Je n'en connais pas, hors les procédés que j'ai déjà indiqués.
J'ai remarqué que ces mots doivent être relativement en petit nombre, parce que, le besoin ne s'en faisant pas sentir, ces emprunts doivent être rares ; et ce que j'avance n'est que l'application particulière d'un principe général et fondamental qui sert de base à la linguistique,
Il faut donc ranger des mots pareils dans la classe des mots essentiellement communs à ces langues, comme langues soeurs, et cela parce que la probabilité l'exige.
Il faut que je m'arrête ici un instant pour appuyer ce principe, qui est de la dernière importance dans les comparaisons que nous aurons à faire. Il faut que je prouve par d'autres considérations que, lorsqu'une nation quelconque emprunte un mot, elle tend à l'emprunter avec des caractères qui le font reconnaître.
Lorsqu'on emprunte un mot étranger, on cherche à l'imiter aussi bien que l'on peut, sans se donner trop de peine. On l'altère cependant, parce qu'on n'a ni l'oreille, ni la prononciation, ni la mémoire assez exercées pour le conserver dans son intégrité. L'altération porte principalement sur la dernière syllabe, quand il y en a plusieurs. On y retranche ou l'on y ajoute quelque chose, au hasard, en suivant le goût et le génie de la langue maternelle ; mais on ne fait pas l'analyse du mot dans ses éléments. On ne saurait la faire sans connaître la langue, et la connaître à fond ; c'est une analyse difficile, même pour les savants : ils s'y trompent quelquefois, pour ne pas dire souvent. Or une nation agit, en altérant le mot, comme au hasard, puisqu'elle n'agit pas scientifiquement ; si elle coupe le mot, elle ne tombera que par un cas fortuit sur le point qui sépare la racine de sa terminaison, et, à plus forte raison, sur la double articulation, quand il y a une particule préfixe.
Ce sera donc le très-petit nombre de mots empruntés, que le hasard aura secondés à ce point, qu'ils soient réduits à leur racine pour recevoir une terminaison indigène.
Ainsi donc, lorsqu'il se présentera, dans les deux langues, un mot avec une racine commune, et une terminaison caractéristique de chaque peuple, la probabilité est très faible que ce mot ait été emprunté, si les deux langues sont réellement soeurs ; et la probabilité sera d'autant moindre, que les rapports entre les deux langues seront plus intimes.
Mais voici ce qui la rend plus faible encore : si la comparaison s'établit entre plusieurs langues affiliées, d'une part, et une autre qui a de même avec elles des rapports communs.
Faisons d'une manière hypothétique une application aux langues que nous avons à examiner. Je suppose que toutes ces langues aient de certains rapports entre elles ; je le répète, ce n'est pour le moment qu'une pure supposition. Si un mot de cette espèce que nous venons de décrire se trouve en même temps dans le breton et dans le latin, d'après ce qui précède, il y a une grande probabilité que les Bretons ne l'ont pas emprunté au latin. Il faudra donc le ranger parmi ceux qui constituent le fonds commun de ces langues comme langues soeurs.
Mais si la même racine se trouve encore dans le gallois, avec les mêmes caractères tirés de la terminaison spécifique, la probabilité augmente dans une raison beaucoup plus forte car il n'y a pas de motifs pour qu'un second peuple séparé par les mers, et par toutes les conditions politiques et autres, tombe précisément sur le même mot dont il n'a pas besoin : c'est là le cas que je suppose, et abstraction faite de toutes données historiques et de toutes celles tirées de la nature des sons.
La probabilité croîtra dans une proportion plus forte encore, si un pareil mot se trouve dans le gaël irlandais, plus encore s'il est en même temps dans le gaël écossais, et s'il se trouve derechef dans le basque, la probabilité approchera tellement de la certitude, qu'il y en aura plus qu'il ne faut pour convaincre les esprits les plus incrédules. Elle ne sera pas, je l'avoue, absolue ; mais où est-elle dans les matières purement humaines ? Elle agit sur notre esprit comme si elle en avait toutes les propriétés.
Voilà les principes qui m'ont guidé dans la comparaison des langues que j'ai entrepris d'examiner. Je n'ai admis sciemment aucun mot comme parallèle au grec et au latin, c'est-à-dire comme faisant partie d'un fonds commun, sans qu'il n'ait les caractères que je viens d'indiquer. Il ne me reste plus qu'à faire connaître les sources où j'ai puisé et la marche générale que j'ai suivie.
Les données matérielles des langues celtiques, je les ai prises : pour le gallois, dans la grammaire et le dictionnaire d'Owen ; pour le breton, dans la grammaire et le dictionnaire de Legonidec ; pour le gaël irlandais, dans la grammaire et le dictionnaire d'O'Brien ; pour le gaël écossais, dans la grammaire et le dictionnaire d'Armstrong ; pour le basque, dans la grammaire et le petit dictionnaire qui l'accompagne, de l'Écluse, ainsi que dans le grand ouvrage de Lacramendi. Ce sont les meilleurs ouvrages. J'en ai consulté d'autres, mais je ne m’appuie que sur ceux-là.
Quant à la marche que j'ai adoptée en traitant de la grammaire de chacune de ces langues, j'ai suivi un procédé analytique qui la réduit, ce me semble, à ses éléments les plus simples. Il en est résulté d'ailleurs cet avantage, dans les comparaisons multipliées que j'avais à faire, que l'on peut saisir avec la plus grande facilité les rapports qui les lient, non-seulement entre elles, mais aussi à d'autres langues, ainsi que les différences qui les distinguent.
Quant à la partie lexicographique, j'ai longtemps balancé sur l'ordre que je suivrais. Une foule de combinaisons se sont présentées à mon esprit, j'ai fini par choisir celle qui me paraît la plus simple et la plus propre à remplir les conditions que je m'étais proposées. Pour la saisir, il suffit de jeter un coup d'oeil sur cette partie de mon travail ; on verra que j'ai rangé les langues celtiques proprement dites, suivant leur rapport d'affinité. Le gallois et le breton se suivent immédiatement ; le gaël, irlandais et écossais, vient ensuite. Ces langues forment ainsi deux tribus : la première pourrait être appelée langues bretonnes, puisqu'elle renferme le breton anglais et le breton français ; la seconde pourrait s'appeler langues gaëles, renfermant l'irlandais et l'écossais.
J'ai suivi l’ordre alphabétique, sous le rapport de la lettre qui commence les mots de ces langues celtiques. Je ne l’ai pas suivi strictement pour les autres lettres, à cause des mutations de voyelles et de consonnes qui caractérisent ces langues.
J'ai d'ailleurs classé les mots celtiques par familles ayant une racine commune. Les principales idées exprimées par ces familles sont indiquées par le titre en français. Ces idées sont rangées par ordre de filiation, non en ligne droite, mais par embranchements, comme toute classification naturelle, quand il y a une assez grande variété de sens ; il en résulte, entre autres, cet avantage, qu'on verra ainsi, sans qu’aucune explication soit nécessaire, des exemples nombreux du génie de ces langues. Si les idées ne s'y associent pas toujours, comme nous avons coutume de le faire, qu'on ne rejette pas pour cela cette classification. La connexion est toujours naturelle et presque toujours évidente. Ce n'est pas la partie la moins curieuse de ce travail ; on y voit, si je puis m'exprimer ainsi, l'esprit figuratif de ces langues ; et la preuve que la filiation, indiquée par les modifications d'une racine, est dans le véritable génie de la langue, c'est que la même filiation se reproduit dans une diversité de racines. Je n'ai pas eu le temps de développer les considérations que cette association d'idées et de mots peut fournir, et de justifier la formation de ces groupes, sur lesquels on pourrait élever quelques doutes, lorsqu'on ne connaît pas mes raisons.
En tout état de cause, on peut les considérer comme des groupes qui ont toujours une liaison réelle, soit naturelle, soit artificielle ; et il en faut pour rompre la monotonie, fixer l'attention et faciliter les comparaisons.
On voit d'ailleurs presque toujours, ce qui seul est une justification suffisante, que le même fonds d'idées se reproduit dans chaque tribu de ces langues celtiques.
J'ai divisé les mots celtiques de chaque lettre en quatre parties, correspondantes chacune à la langue principale, parmi les langues anciennes ou modernes à laquelle je les compare.
Ainsi la première division comprend ceux qui sont analogues au grec. S'il s'en trouve d'autres qui leur soient analogues dans les langues qui m'occupent, je les mets à la suite en choisissant, seulement les principales ; je ne les ajoute pas toujours.
La seconde division renferme les mots qui répondent au latin à l'exclusion du grec, ou lorsqu'ils n'ont avec le grec que des rapports trop éloignés. Les autres langues sont rangées sous le latin, quand elles s'y rapportent, d'après le même principe que je viens d'indiquer pour la partie grecque.
La troisième division contient les mots qui se rapportent au français, à l'exclusion du latin et du grec ; et dans le cas où les rapports avec ces langues seraient trop éloignés, je ne mets ordinairement sous le français que les mots analogues en italien. Cela suffit pour l'objet que je me propose. On peut facilement y suppléer pour les autres langues néo-latines; leur insertion m'eût mené trop loin.
La quatrième partie comprend les mots celtes qui correspondent à l'anglais. J'y mets assez souvent l’indication que ces mots se trouvent aussi en flamand ou en allemand, mais je ne les spécifie pas toujours, pour abréger.
Ces langues celtiques proprement dites sont ainsi rangées par tribus les unes au-dessous des autres, dans la même colonne. La place de chaque langue est toujours gardée, afin que d'un coup d'oeil on puisse constamment voir jusqu'à quel point la racine est commune, et où elle manque.
A la vérité, elle ne manque pas toujours quand elle n'est pas marquée ; il arrive quelquefois qu'elle existe et qu'elle m'est échappée : cependant, comme ce cas est relativement rare, le tableau que je présente est suffisamment exact.
On s'est ordinairement contenté, dans la comparaison des langues, d’un assez petit nombre de mots, pourvu qu'ils fussent choisis dans la classe de ceux qu'en général on n'emprunte pas, c'est-à-dire ceux qui représentent les idées et les objets les plus usuels. Cela suffit pour un premier aperçu et pour ranger les langues dans de grandes catégories.
Mais pour résoudre les questions proposées par l'Académie, et surtout la dernière : "déterminer la nature et l'étendue des emprunts que ces idiomes ont faits, soit au latin, soit à d'autres langues", il faut d'autres recherches.
Il faut d’abord, comme je l'ai exposé précédemment, déterminer ce que ces langues ont de commun, si tant est qu'il y ait communauté entre elles ; sans quoi il est impossible de juger les emprunts autrement que par des données historiques. Nous avons vu combien elles sont, par leur nature, vagues et insuffisantes.
Quoique l'étude des langues elle-même présente des moyens plus certains, nous en avons signalé les difficultés ; et on ne saurait les surmonter sans une comparaison des plus étendues et des plus approfondies. Il me suffit d'un exemple tiré du cas le plus simple et le plus facile, un mot composé qui se trouve dans les deux langues. N'est-il pas indispensable, d'après ce qui précède, de s'assurer si les deux racines se trouvent où ne se trouvent pas dans les deux idiomes. Ainsi, dans la circonstance même où le principe est d'une application à peu près certaine, on voit ce qu'il présente de difficultés dans cette application, seulement par l'étendue de la recherche. Je ne parle pas de celle qui consiste à déterminer quelles sont les racines, ce qui n'est pas souvent chose aisée.
D'ailleurs, dans toute science il y a au moins deux choses essentielles, quand il s'agit d'établir un rapport : 1° en constater la nature ; 2° en donner la mesure. Or, quant au premier point, relativement au sujet qui nous occupe, l'affiliation des langues celtiques proprement dites aux langues indo-germaniques est assez bien constatée. Ce n'est pas que je prétende préjuger cette question, ni me reposer sur les travaux d'autrui ; on sera assez convaincu d'ailleurs que je ne m'en suis pas servi.
Quant au second point, l'étendue de ces rapports, il faut autant que possible la donner complète, c'est-à-dire en avoir la mesure. Voilà à quoi je me suis attaché pour les langues celtiques proprement dites.
J'ai examiné avec soin chacune de ces langues à leurs sources : 1° en les réduisant à leurs principes les plus simples ; 2° en les comparant dans toute l'étendue de leur portée lexicographique. Il se présente, à l'égard des emprunts de ces langues, une difficulté dont il faut dire deux mots.
Ces langues s'éteignent progressivement ; si l'on ne mettait pas un choix dans les sources, on pourrait, suivant celles où l'on puiserait, parvenir à deux résultats opposés.
La partie de la population dont la langue s'altère la fait passer par tous les degrés d'altération.
Il y aura là des emprunts de tous les degrés.
Il y en aura de même lorsque toute la population aura altéré sa langue.
Où faut-il puiser alors ?
Aux sources les plus pures, aux dictionnaires, qui présentent la langue dans sa plus grande intégrité : voilà ce que j'ai fait.
Je n'ai pu présenter la comparaison du basque dans la même étendue. Celle que je lui ai donnée, cependant, paraîtra, je l'espère, assez considérable. Si dans mon manuscrit, quelle que soit la peine que je me suis donnée pour le revoir, il y a quelques lacunes ou quelque autre faute palpable dont je n'ai pas la conscience, je prie l'Académie de considérer quel temps il a fallu seulement pour le faire copier et quel temps m'est resté pour le revoir.