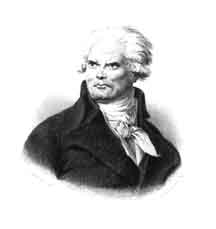


|
La grande majorité des orateurs répertoriés par Cormenin comme modèles de
l'éloquence de la presse, du barreau, de la politique ou de la religion,
est née entre 1775 et 1785. Ces personnages ont donc tous été formés à la
rhétorique sous la période révolutionnaire ou sous le règne de l'Idéologie,
au début du premier Empire. Ils ont ainsi concouru simultanément à: | 1° transmettre une certaine forme de connaissance des mécanismes figuratifs de la rhétorique tropologique classique; et 2° remodeler le contenu de ce savoir pour le rendre congruent à des besoins topiques et argumentatifs contemporains ainsi qu'à des nécessités d'efficacité persuasive particulièrement d'actualité au coeur des débats et des révolutions diverses du XIXe siècle. |
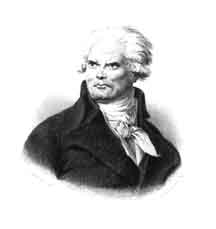
| 
| 
|

| 
| 
|

Marquis de LAFAYETTE [1757-1834] | 
| 
|
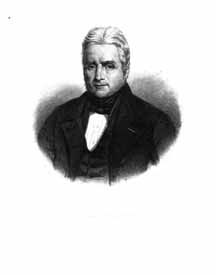
| 
| 
|

| 
| 
|

| 
| 
|
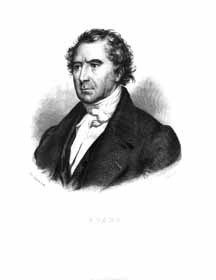
| 
| 
|

| 
| 
|

| 
| 
|