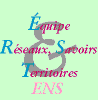Phi-NTS2: Philosophies des numériques, des
techniques et des sciences
Seconde édition: écrire le monde
Ens de Lyon, 26 et 27 juin 2025
Salle Condorcet
Argument
Pour cette seconde édition, un moyen de fédérer ces thèmes serait de solliciter la notion d’écriture du monde.Hacking a montré que la notion de construction sociale de la réalité est contradictoire, même si elle est alimentée par des rationalités mues par le désir de justice. En même temps, notre réalité est en partie façonnée par le social. Nous en avons des exemples avec les engagements militants qui se focalisent sur la partie visible des humains comme avec la notoriété que Musk offre aux partis populistes via l’agrégateur d’échanges dont il est propriétaire. Les uns et les autres influencent nos comportements, infléchissent et parfois hiérarchisent nos débats. Il en est de même en économie (hypothèses devenant dogmes, chiffres statufiés) ou en écologie, quand la responsabilité d’un usage frugal des services proposés incombe majoritairement aux consommateurs (cas du « numérique » et de la 5G). Dans tous ces cas s’instituent des lois, des normes et des représentations. De façon analogue, les réseaux sociaux et les intelligences artificielles rappellent qu’une technique peut être popularisée ou bridée par des investissements financiers, plus sociaux que naturels.
Nous pouvons aussi repérer une construction intellectuelle de la réalité. Depuis les Grecs jusqu’aux physiciens actuels en passant par Granger, nous en connaissons la fécondité: le concept de technologie de l’intellect clarifie grandement les effets de l’écriture et explicite la dimension mécaniste de la pensée. Son efficacité déborde du champ des sciences sociales. En sciences exactes et expérimentales, les notions de différentielle, de groupe et d’invariance consolident et simplifient notre rapport au monde. Le conflit entre les approches corpusculaire et ondulatoire de la lumière fut réglé par Von Neumann qui a montré leur dualité avec les espaces de Hilbert. Or ces derniers ne relèvent pas des lois de la nature. Ils sont de pures constructions.
C’est ce point de convergence entre sciences sociales et exactes, relativement à la notion de construction intellectuelle de la réalité que nous pourrions explorer à l’occasion de ce colloque. Avec des exemples, des références, des découvertes.
Ces constructions sont aussi sociales: si Fourier et Einstein furent de réelles singularités scientifiques, ils appartenaient à des écoles de pensée, à des espaces d’échange: à des collectifs. Il en est de même pour Goody ou Lévi-Strauss. Les uns et les autres n’auraient pu développer leurs théories sans se frotter aux hypothèses et aux savoirs de leurs prédécesseurs. Cette extension sociale de l’idée de construction libère alors la notion des considérations morales: la construction sociale est souvent accusée, sinon évoquée pour dénoncer un ordre ou des représentations inégalitaires.
Rappeler le rôle de cette construction intellectuelle (via le virtuel, le concept, et aussi l’instrumentation) dans nos représentations du monde, quand nous les voulons les plus affinées, peut être une façon, non pas de prétendre que le monde est écrit, mais de rappeler que nous participons à son écriture, avec nos outils et nos concepts. Aux temps des numériques, où s’écrivent des algorithmes qui écrivent les possibles et, le plus souvent, les contraintes de nos échanges, de notre accès à l’information et de nos avenirs politiques, cette approche émancipe: nous pouvons nous aussi écrire le monde.
Ce serait enfin un moyen d’arrimer la culture aux sciences et aux techniques alors qu’elle est communément pensée comme loin de ces dernières, bien qu’elle soit de plus en plus instrumentée, technicisée, modélisée. Et cela nous permettrait de montrer comment une épistémologie réaliste et ancrée dans le contemporain alimente la philosophie politique.
Programme
Chaque conférence dure environ 45mn, débats inclus.Jeudi 26 juin
- 10h-10h15. Café
- 10h15-11h. Éric Guichard: Réconcilier sciences sociales et sciences exactes. Virtuel, écriture, matérialité.
- 11h-11h45. Pierre-Antoine Chardel: La confiance érodée dans la société des flux. Un défi éthique et herméneutique majeur à l'ère hyper-moderne.
- 11h45-12h30. Mickaël Normand: Écriture et machine comme formes techniques de la délégation de pensée.
- 12h30-14h. Déjeûner.
- 14h-14h45. Stéphanie Roza: La réécriture du monde par les réseaux sociaux.
- 14h45-15h30. Emmanuel Saint-James: Philologie de la programmation.
- 15h30-15h45. Pause
- 15h45-16h30. Robert Alessi. Écriture digitale de la culture: le cas des anciens textes de médecine grecs et arabes.
- 16h30-17h15. Patrick Flandrin: Vivre et penser comme des bots.
Vendredi 27 juin
- 10h-10h15. Café
- 10h15-11h. Claude Imbert: Des « données » aux algorithmes. Rémanences hellénistiques et syntaxes contemporaines.
- 11h-11h45. Gabriel Bounias: Le dialogue entre langage mathématique et expérience. Une épistémologie de l'intuition physique.
- 11h45-12h30. Jean Dhombres: Hilbert, Von Neumann et Turing. Écrire la lumière, écrire les limites des mathématiques.
- 12h30-14h. Déjeûner.
- 14h-14h45. Valérie Charolles: L'écriture du monde par les chiffres. Enjeux philosophiques, anthropologiques et politiques.
-
14h45-15h30. Jean Lassègue: Empire alphabétique, empires
numériques.
- 15h30-15h45. Pause
- 15h45-17h. Table
ronde. Intervenants et public. De l'épistémologie à la philosophie
politique. Conceptualisation, écritures et représentations du monde.
Page créée le 15 avril 2025, modifiée le 6 juin 2025.