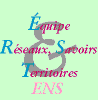Éric Guichard
Récursivité de l'indépendance:
le 9 juillet 2011
Avant-propos: ce texte a été écrit en octobre 2012, à l'occasion des 30 ans du Collège international de philosophie, et fut publié au printemps 2013 dans l'ouvrage numérique du même nom (http://30ansciph.org/). De récentes rencontres avec des spécialistes du Sud-Soudan et les tristes évènements politiques de décembre 2013 m'incitent à republier ce texte, avec l'espoir intrépide et peut-être irréaliste qu'il s'ajoutera à la solidarité internationale envers ce jeune pays pour y ramener la paix.
J'ai le souvenir d'une question posée par Derrida, que m'avait soumise un ami anthropologue au début des années quatre-vingt dix: comment se fait-il que les assemblées constituantes puissent définir le cadre de la légitimité politique, par exemple démocratique, alors même qu'elles ne sont pas issues de ce cadre? N'y-a-t-il pas une contradiction, à tout le moins un paradoxe à instituer des règles qu'on ne peut avoir respectées? Cette antinomie réapparaît régulièrement, au fil des nouvelles constitutions, et des indépendances: se glisse là une récursivité qui rend vaine la recherche d'une origine. Par exemple, en France, cela fait au moins cinq fois qu'a été réécrite de fond en comble la constitution depuis la fondation de la République, sans compter les toilettages républicains ni les refontes royalistes. Le dernier pays à se lancer dans une telle écriture est le Soudan du Sud, qui a proclamé son indépendance le 9 juillet 2011. Cette date est celle qui a pour moi la plus grande importance, dans ces 30 années qui ont suivi la fondation du CIPh. Cette nouvelle contrée a désormais un moyen de se défendre, sinon de s'exprimer devant des instances internationales comme l'ONU. Pour son bonheur, et le nôtre, elle n'est aucunement composée d'un « peuple » ni même d'une « tribu ». La notion de peuple était relativement opératoire quand des régions tombaient sous la coupe d'étrangers organisés qui maintenaient ou construisaient de la différence (en termes de droits, notamment). L'histoire nous rappelle que les dominants étaient naguère occidentaux. Les notions de peuples vietnamien ou algérien se sont ainsi construites. Mais ce ne fut ni toujours ni partout le cas. Au Sud-Soudan, le colonisateur fut souvent « arabe », en un sens aussi précis et aussi flou que celui que nous donnons à « occidental ». Cette colonisation se traduisait essentiellement par des razzias d'esclaves ou de troupeaux, et s'arrêta quand de rares officiers britanniques arrivèrent à la fin du XIXe siècle. Ils ne se contentèrent pas de protéger leurs nouveaux administrés des raids nordistes. Fascinés par les cultures qu'ils découvraient, ils entrèrent en rupture avec Londres et freinèrent considérablement les projets de colonisation à l'occidentale, réduits à la construction de rares écoles primaires et à la réduction des vendettas locales. Le 1er janvier 1956, le Soudan devint un pays indépendant. Ce pays, 5 fois grand comme la France, vécut aussitôt une incessante guerre civile qui opposa grosso modo son Sud au reste du pays (un Nord étendu au 2/3 du pays). Oublions les distinctions de dictionnaire entre les deux entités (des Arabes qui seraient islamisés contre des Noirs qui seraient animistes, des contrées arides versus une région nilotique marécageuse) pour nous assurer que les couleurs de nos gens peuvent varier du cuivre le plus enjôleur au bleu le plus profond, qu'il existe des maîtresses femmes qui dirigent des villages du Nord quand des Occidentaux croient que l'emprise de la charia y est totale, et que des hommes armés, quelles que soient leurs régions (Nord, Sud, Ouest: cf. le Darfour), savent terroriser leurs proches d'une façon sinistre. Dans ce grand pays comme dans beaucoup d'autres, la plus grande humanité voisine avec la monstruosité, et aucune catégorie sociale, coloriale, religieuse ou politique n'explique des comportements ignobles. Comme ailleurs, la possession des armes, du pouvoir et de l'argent sont les plus susceptibles de générer l'horreur. On pourra se référer à Port-Soudan d'Olivier Rolin pour s'en donner une idée. Hier, le Soudan était donc plongé dans la guerre civile. Aujourd'hui, le Nord et le Sud se font la guerre. Autant de mines posées aux abords des points d'eau, de coups de mitrailleuses, d'enfants tués. Quid de demain? Espérons que la paix l'emportera. Le premier intérêt de cette expérience historique est de nous mettre en face de nos vulgates: aujourd'hui, la notion de peuple s'appuie sur une rhétorique qui sollicite des arguments historiques ou politiques élémentaires, souvent faux et émotionnels; en Europe, on fait appel au peuple pour se faire élire sur un programme... populiste. Ainsi, les habitants du pays le plus pauvre du monde, parce qu'ils se sont constitués en nation à partir d'un patchwork de cultures et donc d'organisations politiques pourraient donner une leçon politique à tous ceux qui votent et font voter pour des peuples. Nous savons désormais que cette notion de peuple est artificielle, construite. Elle renvoie autant à une expérience collective dans la longue durée et réécrite par l'histoire et les institutions (c'est donc une notion plastique) qu'à des violences éruptives qui, le temps d'un coup d'État, d'une émeute, d'un déploiement de chars, meurtrissent ou reconfigurent des savoir-vivre politiques lentement tissés. Le second intérêt est de nous rappeler que la colonisation, tout comme le racisme, sont des notions hélas universelles. Façon de nous obliger à nous extirper de nos histoires locales quand nous voulons penser l'autre et les formes de la domination d'hier et de demain. Pour le dire autrement, nous sommes vraiment tous pareils, même si nous ne naissons pas tous avec les mêmes chances. Le troisième est de nous inviter à considérer les indépendances qui se constituent sans constitution ni réflexion philosophique. Nous pouvons nous demander jusqu'à quel point la question dérangeante de Derrida est récursive. Certaines expériences urbaines ne signalent-elles pas une tentative de passage à la limite, où une personne pourrait créer un État pour elle toute seule? Cette question est abordée par des géographes comme Mike Davis ou David Harvey, qui nous rappellent que des villes ou des quartiers s'autonomisent et se ferment à autrui, sans d'autres arguments théoriques que la volonté d'édifier des murs et de multiplier à leurs abords les vigiles ou les militaires. Le Soudan du Sud, les deux Soudans sont des terrains aussi instructifs que chaleureux pour qui ne se satisfait pas des schémas trop huilés pour être crédibles.
Page créée en octobre 2012 ,
modifiée le 26 décembre 2013