L'internet et l'écriture:
du terrain à l'épistémologie
Habilitation à diriger des recherches
Université Lyon-I
Garante: Geneviève Lallich-Boidin.
Rapporteurs: Jean Dhombres, Yves Jeanneret, Isabelle Lefort
Autres membres du jury: Emmanuël Souchier, Francis Chateauraynaud.
Éric Guichard
Soutenue le 8 octobre 2010
Sommaire
1 L'internet, objet d'étude?1.1 Définir l'internet
1.2 Technique et industrie
1.2.1 Pouvoirs
1.2.2 Utopies et idéologies
1.3 La part de l'invention
1.3.1 Le difficile choix des témoins
1.3.2 Créativité, collectifs et cultures
1.3.3 Technique, culture et bricolage
1.4 Bilan méthodologique d'une dualité 2 La construction d'un terrain
2.1 L'informatique littéraire à l'ENS
2.1.1 Du Soudan à l'internet
2.1.2 Tropismes et part de l'expérience
2.1.3 La découverte du lien entre technique et discours
2.1.4 Rétrospective
2.2 Le défrichage d'un terrain
2.2.1 Aux racines des usages de l'internet
2.2.2 Des usages aux territoires de l'internet
2.2.3 Pousser l'écriture à ses limites
2.3 Sociologies
2.3.1 Universalisme et déplacements méthodologiques
2.3.2 Auto-analyse en vue de généralisation 3 Technique et réflexivité
3.1 Usages et discours
3.1.1 Définir l'internaute
3.1.2 Le législateur prescripteur d'usages
3.1.3 Miliciens et sculpteurs de l'internet
3.1.4 Le plâtre discursif de la fracture numérique
3.2 Vers la réflexivité
3.2.1 Les scientifiques et l'écriture
3.2.2 La tresse de l'internet, de ses usages et de ses discours
3.2.3 La cartographie informatique
3.2.3.1 Outils, cheminements et théories
3.2.3.2 L'atlas de l'immigration
3.2.3.3 Données et flux de l'internet
3.2.3.4 Un atlas en SVG
3.3 Écriture, territoire et culture
3.3.1 Cartographie et philosophie
3.3.2 La construction des territoires de l'internet
3.3.3 Écrire le territoire
3.3.4 Culture et représentations
3.4 Conclusion
Remerciements
Je voudrais tout d'abord remercier Geneviève Lallich-Boidin, qui a accepté d'encadrer cette habilitation. Ses rigueurs scientifique comme morale, la solidarité professionnelle et intellectuelle dont elle a toujours témoigné, ses conseils, précis et systématiquement bienveillants m'ont grandement aidé à réaliser ce travail à la fois rétrospectif et prospectif. Ensuite, mes compagnons de route et amis: Henri Desbois, Clarisse Herrenschmidt, Paul Mathias, Philippe Rygiel, dont la culture sans cesse renouvelée et l'esprit critique, agréablement complétés d'une patience et d'une générosité sans failles, ont toujours été de précieux ferments scientifiques. J'y ajoute Jean Dhombres et Jack Goody, qui représentent pour moi l'horizon idéal du savant. On retrouvera sans surprise dans le texte qui suit les apports intellectuels de Christian Jacob, Yves Jeanneret et Joëlle Le Marec, envers qui je suis fort redevable: leurs travaux m'ont incité à m'aventurer en des territoires qui m'étaient neufs, mais qu'ils avaient déjà balisés et qu'ils m'ont aidé à explorer. De nombreux collègues, professeurs et proches ont grandement déterminé ou facilité mon parcours intellectuel: Patrice Abry, François Baccelli, Georges Balandier, Marie Bauwens, Jean Bazin, Jean-Claude Chamboredon, Jean-François Chanet, Michel Cosnard, Émilie Devriendt, Patrick Flandrin, Étienne Guyon, Rupert Hasterok, Halima Khaldi, Hervé Le Bras, Isabelle Lefort, Étienne Li, Patricia Loué, Rashed Mnéimné, Gérard Noiriel, Marie-Ange Schiltz, Bernard Victorri. Qu'ils soient ici chaleureusement remerciés. Et un joyeux merci à celle qui partage ma vie.Précisions pour les lecteurs
Afin de signaler les citations de mes propres textes, j'ai choisi la «surenchère informationnelle»: dans la version pdf, elles sont entre guillemets, en italiques, et accompagnées d'une note marginale qui en indique la source. Dans cette version html, la référence en note marginale est intégrée dans la citation, entourée de doubles accolades. elles sont entre guillemets, en italiques, et accompagnées d'une note marginale qui en indique la source. Exemple: «l'écriture, avec ses objets, ses méthodes et ses savoir-faire, {{[Guichard, 2004a], p. 29.}} tous sans cesse remis en chantier [...]». Ainsi, les références à mes écrits antérieurs ne peuvent être confondues avec des citations ou des évocations d'auteurs, dont la mention bibliographique reste dans le texte courant. Dans cet écrit, le «nous» alterne avec le «je». Dans le premier cas, j'énonce des propos qui concernent autant mes lecteurs que moi-même. Dans le second, j'énonce une position personnelle (par exemple, une hypothèse). J'ai abondamment utilisé le système hypertextuel de LATEX: références bibliographiques, URL de sites web, références croisées. Les premières me libèrent de procédures intellectuelles comme techniques historiquement situées: les renvois à des ouvrages déjà cités, avec leur somme d'op. cit. et d'ibid.. Je crois que le lecteur voit son confort accru quand il rencontre une référence bibliographique adossée à une citation (l'éventuelle gêne produite par la redondance pourrait être compensée par un programme informatique qui donne, pour chaque référence, l'ensemble des pages qui la mentionnent). Les renvois aux sites web sont autant imposés par l'actualité de la documentation électronique que par la nature de mes productions informatiques (cartes animées, logiciels) que je ne puis intégrer dans ce texte imprimé. Son édition électronique permettra un accès direct à la variété de ces objets en ligne. Enfin, par souci pédagogique comme éthique, j'ai choisi de multiplier les références croisées: j'ai voulu que mes lecteurs puissent suivre au mieux mon raisonnement, et qu'ils n'aient à aucun moment le sentiment que des faits, des hypothèses ou des arguments évoqués dans une page soient ensuite transformés en assertions que je n'aurais pas démontrées. Si cette circulation hypertextuelle s'avère inconfortable, c'est à ma personne qu'il faudra adresser des reproches. Dans le cas contraire, les remerciements s'adresseront au «moteur scribal» que j'ai utilisé et à son inventeur, Donald Knuth.Introduction
Les pages qui suivent constituent un mémoire d'habilitation à diriger des recherches qui explicite le cheminement de ma réflexion en s'inspirant grandement des travaux théoriques comme pratiques réalisés depuis ma thèse (2002). J'ai rédigé celle-ci lorsque j'étais agrégé-répétiteur à l'École normale supérieure (ENS, Paris) et elle m'a valu d'être qualifié en sociologie-démographie et en sciences de l'information et de la communication. En m'offrant le choix entre deux postes de maître de conférences, cette dernière discipline m'ouvrait les portes de l'Université. Le périmètre intellectuel circonscrit par les sciences de l'information et de la communication témoigne à mon avis de la fertilité d'une approche au croisement des échanges entre les humains et des méthodes et machines qu'ils déploient. La jeunesse de cette discipline et son inscription dans un univers hexagonal pourraient la desservir. On peut cependant considérer que ce sont des atouts pour aborder des questions contemporaines, sauf à supposer qu'on puisse aujourd'hui penser les relations entre les humains en faisant abstraction des prothèses techniques qu'ils ont inventées et dont ils s'entourent pour échanger. Je n'en oublie pas pour autant l'ensemble des perspectives et des savoirs que j'ai pu affermir au contact des sciences sociales et des mathématiques: les pages qui suivent font abondamment référence à ces fontaines intellectuelles et le fait de penser rétrospectivement la richesse de leurs apports s'avéra particulièrement stimulant et même enthousiasmant. La réflexion sur l'articulation entre ces diverses manières de faire, de regarder, d'orienter la pensée me conduit régulièrement à l'épistémologie, dont je montre qu'elle a plus de liens que prévu avec la technique. Ces constats m'invitent à développer une vision large et accueillante de la notion de discipline. D'une part, je suis désormais persuadé qu'une discipline est plus dynamique, qu'elle se défend mieux en s'exposant, en se montrant bienveillante envers d'autres, à des courants d'idées, au contemporain (et donc aux besoins des étudiants) qu'en adoptant une posture défensive. D'autre part, une discipline renvoie à l'institutionalisation d'une transmission spécifique des savoirs et savoir-faire, celle développée à l'Université; à ce titre, s'exerce toujours une tension entre ce qui est et ce qui sera enseigné. Et la recherche actuelle signale bien des enseignements de demain. Aussi pensé-je que cette dernière est en grande partie stimulée par les formes de «braconnage intellectuel» chères à Gaston Bachelard et Michel de Certeau: «faire feu» de toutes les connaissances, méthodes, de tous les acquis et de toutes les découvertes des savants et scientifiques, pourvu que les unes et les autres alimentent efficacement et concrètement des problématiques soigneusement définies. Ce mémoire s'articule en trois parties. La première propose une définition de l'internet et, partant de deux points de vue a priori opposés (industrie mondiale vs individu) soulève des questions simples, qui mènent à des réponses que j'espère aussi simples, mais jusqu'ici peu évoquées. La seconde s'appuie sur mon expérience de chercheur dont la double formation mathématique et anthropologique a pu s'épanouir dans une aventure intellectuelle et technique fort féconde initiée à l'ENS. Sont alors posés les jalons qui me permettront d'inverser ou de renouveler nombre de problématiques quant à l'internet, ses usages, ses discours, et plus généralement quant à l'écriture et la technique. Grâce à ces balises, je puis alors proposer un cheminement qui va de la socio-histoire des sciences de l'information et de la communication à leur épistémologie. Dans la troisième partie, je clarifie la circulation entre technique et réflexivité. En prenant appui sur l'écriture contemporaine et son expression cartographique, j'interroge les relations entre territoire et représentation sociale, entre technique et culture. Ce qui conforte l'approche théorique et pragmatique de ma première partie et me conduit à énoncer une méthodologie qui ouvre vers la possibilité d'une épistémologie générale.
Chapitre 1
L'internet, objet d'étude?
Je propose dans cette partie une définition de l'internet aussi large que possible afin de rendre saillantes quelques problématiques que j'approfondirai.
Je précise d'emblée que le mot «technique» est ici employé dans son sens général, qui dépasse le strict sens applicatif d'un «ensemble de procédés méthodiques reposant sur des connaissances scientifiques et permettant des réalisations concrètes»1.
Je postulerai avec Bertrand Gille et Thomas Hughes [Gille, 1978,Hughes, 1998] que la technique intègre une notion de système propre à décrire de nombreuses techniques complexes du XXe siècle (transport, communication, énergie, armes, etc.), dont l'internet, pour lesquelles les parts des hommes, des machines et des méthodes s'entremêlent.
En conséquence, la possibilité que la technique soit aussi un «ensemble des procédés individuels propres à une personne, en particulier à un artiste» ne sera pas négligée.
1.1 Définir l'internet
Il est difficile de s'offrir une représentation unitaire de l'internet. C'est à la fois:- Un système technique complexe de câbles, d'ordinateurs, etc., qui s'appuie sur d'autres systèmes similaires (réseau électrique ou des opérateurs de télécommunications par exemple); ici prime la notion de maillage d'ordinateurs, certains étant dédiés au fonctionnement du réseau2 quand d'autres ne lui accordent qu'un minimum de ressources. Derrière les fils et processeurs s'affiche une industrie polymorphe, du percement de tranchées à la location de longueurs d'ondes, des fibres optiques aux centres d'interconnexion entre fournisseurs d'accès à l'internet.
- Un ensemble de protocoles écrits qui en garantissent le fonctionnement, y compris sur des réseaux hétérogènes. Le succès de l'internet repose sur deux protocoles, l'un au-dessus de l'autre: TCP sur IP, qui servent de socle commun à d'autres, eux aussi structurés en «couches», jusqu'aux plus près des utilisateurs (FTP, SMTP pour le courriel, HTTP pour le web, etc.). La notoriété de ces derniers (souvent appelés logiciels) ne doit pas occulter la masse des autres programmes qui font (et ont fait) fonctionner l'internet, qui facilitent des procédures d'automatisation et qui permettent des formes de surveillance et de détournement de l'internet.
- Enfin, une variété d'utilisateurs qui à eux tous font l'internet: évidence qui n'empêche pas de rappeler que la description exhaustive de leurs pratiques ou de leurs statuts est irréalisable. Contentons-nous de signaler qu'existent des lecteurs, des auteurs, des éditeurs du web, des programmeurs, des métrologues, des propriétaires, des commerçants, des bandits, des rêveurs, etc., et qu'une même personne peut à la fois ou successivement endosser plusieurs de ces fonctions.
1.2 Technique et industrie
1.2.1 Pouvoirs
L'internet relève d'une technique industrielle sophistiquée et indéniablement matérielle. À titre indicatif, en 2006, le moteur de recherche le plus utilisé avait besoin de 300 000 ordinateurs pour fonctionner9. Les centres de données pour services internet ou d'interconnexion entre fournisseurs d'accès sont des usines dotées d'imposantes alimentations électriques, redondantes pour éviter les coupures et qui servent autant à refroidir les ordinateurs et routeurs qu'à les faire fonctionner. En France, leur consommation électrique totale dépasserait en 2009 le centième de celle du pays entier10. On en déduit que le moindre site web un peu célèbre a besoin de milliers de machines et de beaucoup d'énergie, même quand sont mises en avant ses capacités à fabriquer du social et du symbolique11. La mise en place de telles puissances énergétiques et industrielles suppose des moyens financiers considérables, et laisse entrevoir des moyens politiques qui ne le sont pas moins. Ce constat pousse à la clairvoyance: à l'instar du gaz et du pétrole, l'internet est le cadre de multiples appétits, convoitises ou tensions. Et toute analyse qui minore ou nie cette réalité ne peut que nourrir le soupçon. L'intérêt pour la dimension banalement technique de l'internet permet donc d'en déduire une dimension économique et sociologique: il suffit de prêter attention aux rapports de force propres à cette industrie. Qui sont les propriétaires et locataires des câbles, des data centers? Ces derniers sont-ils considérés comme stratégiques par les militaires? Comment s'organisent les alliances entre opérateurs? Quels groupes industriels et commerciaux sont concernés par les flux d'argent mis en circulation (de la publicité au creusement de tranchées dans les villes)? Quels types d'usages garantissent les plus grands profits? À qui appartiennent les données qui circulent sur les réseaux? Qui peut se les approprier ou les écouter? Qui a une vue d'ensemble du réseau? Autant il est aisé de répondre à la dernière question -personne ne sait réellement décrire les réseaux de l'internet, tant en termes de topologie que de flux12-, autant les autres questions restent majoritairement ouvertes et mériteraient d'être fouillées13: des travaux approfondis répondant à de telles questions pourraient clarifier les coalitions, les solidarités et les dépendances entre entreprises, États, et organisations14 . Ils pourraient se compléter d'une cartographie détaillée des emplacements des câbles de l'internet au plan mondial qui repère leurs propriétaires15; ce qui permettrait à la fois de prolonger cette analyse des rapports d'alliance, de sujétion et de compétition, et de l'articuler avec une géographie de l'internet qui renvoie à une géopolitique peu connue. De tels travaux contribueraient à clarifier le débat politique comme juridique. Ils aideraient aussi à comprendre les parts de la croyance et de la rationalité quand sont sollicitées, en nos propres mondes, les techniques contemporaines16 .1.2.2 Utopies et idéologies
Ces questions ont l'avantage d'en nourrir d'autres, aussi simples: si l'internet n'est pas un univers libre et sans conflits, mais truffé d'enjeux économiques, pourquoi ceux-ci sont-ils occultés au point que son évocation s'accompagne souvent de discours enchantés? Ensuite, est-il possible de vérifier si les tenants de tels propos sont rigoureux ou naïfs, sincères ou de mauvaise foi? Et si ce type de question n'appelle pas de réponse claire, peut-on savoir si les partisans de ces discours sont pris dans un écheveau d'intérêts et de conceptions qui les dépassent? Il apparaît que la distorsion entre la réalité industrielle et matérielle de l'internet et les discours souvent enthousiastes à son sujet, quoique déroutante, s'avère en réalité une entrée féconde: elle permet d'évaluer les intérêts en jeu, les idéologies sur lesquelles s'appuient consciemment ou non les argumentations, et, en amont, les formations discursives qui s'organisent aujourd'hui autour de la technique, de la société et de la science. Ce point et ses articulations anthropologiques seront approfondis. Toutefois deux exemples, qui se font écho, permettront d'en dresser une première esquisse.Le web 2.0 et la fin des services publics
Le premier est un film fortement mis en valeur par des journaux spécialisés comme http://www.internetactu.net: Us Now se présente comme a project about the power of mass collaboration, government and the internet17. En une heure, ce film explique comment, grâce au web collaboratif18 , «nous» pouvons tous nous organiser sans services publics -systématiquement présentés comme inutiles, hiérarchiques, bureaucratiques- et pourquoi ce web 2.0 nous invite à repenser la notion de gouvernement, lui aussi inutile dans sa fonction actuelle. Les exemples d'organisations qui se libèrent de la tutelle d'intermédiaires abondent: associations de mères (http://mumsnet.com), de clubs de football19, etc. Jusqu'à Linux, décrit comme meilleur que Windows car «les développeurs y travaillent tous les jours, même le dimanche». Et, serait-ce pour ne pas apparaître trop marqué politiquement, le film n'oublie pas de critiquer le système bancaire traditionnel20 ni l'industrie culturelle -avec l'incontournable exemple de la musique. À intervalles réguliers est détaillé un «nouveau paradigme», qui conduit systématiquement à une «augmentation de l'offre de liberté» (sic); pour mieux expliquer la portée d'un tel paradigme, les présentateurs l'associent à un logo: celui de YouTube, de MySpace, des sites précités, de Blogger, sinon de Google, etc. Dans ce film, la référence à l'argent semble prohibée; toutes les entreprises évoquées se voient dresser une genèse qui insiste sur l'esprit charitable21 de leurs fondateurs. Cette croyance en la capacité des entreprises à but lucratif à mieux protéger le bien public que les institutions qui en ont la charge relève en fait de l'idéologie. Ainsi, ces discours vantant une nouvelle ère, caractérisée par l'avènement de relations sociales plus denses et plus libres, cette glorification des usages modernes de l'internet sert-elle l'ultralibéralisme en même temps qu'elle s'en inspire. Qui par ailleurs a intérêt à diffuser de telles représentations du monde et pourquoi? Et qui est susceptible de les financer?Les bénéficiaires du web 2.0
Je ne répondrai pas ici à la première question, qui mériterait un ouvrage entier: de tels films et discours font la promotion d'une culture, et l'idée que ses promoteurs aient intérêt à sa diffusion n'est que bon sens. En revanche, aussi naïve soit la seconde, elle trouve assez vite des réponses. Le web 2.0, dont les mérites sociaux et intellectuels sont vantés au point que, même dans les espaces critiques que sont les universités, ceux qui n'y adhèrent pas sont souvent disqualifiés comme rétrogrades, a ses meilleurs partisans chez les... vendeurs de routeurs. À la réflexion, c'est assez logique: qui d'autre qu'un fabricant de matériel d'interconnexion a le plus avantage à ce qu'il y ait partout des possibilités d'échanger: dans les appartements, les bureaux, les aéroports, les trains? Ou, pour le dire autrement: qui a intérêt à ce que le maximum de personnes communiquent systématiquement sans se rencontrer, sinon les fabricants d'interfaces, de relais, de passerelles entre les canaux et les systèmes d'information? Pour autant, les personnes qui auraient un avantage objectif à la diffusion de ce web 2.0 ne reproduisent pas directement l'idéologie rencontrée précédemment. Par exemple, le discours du président de Cisco à ses actionnaires22 et plus encore, le texte qui l'introduit23, explicitent l'intérêt de l'entreprise pour le tout communicationnel: télé-présence, réseaux sans fil à large bande, routeurs pour centres de données, réseaux intelligents. Étrangement, le PDG de l'entreprise, John Chambers, associe ses projets de développement économique avec «des initiatives citoyennes», écologiques et éducatives. Ces juxtapositions imprévues de la technique, de l'humanitaire, et de l'industrie sont justifiées par les retombées économiques qu'elles induisent: «j'ai toujours pensé que les meilleures entreprises au monde devaient également être les premières à partager les fruits de leurs succès. Tout d'abord, il est vrai que c'est un comportement juste. Ensuite, pour être honnête, c'est très bon pour les affaires24». Et dans sa conclusion, il ne prétend pas que le web collaboratif réalise une promesse pour l'humanité. Il se contente d'affirmer que son développement enrichit son entreprise et ses salariés: les «modèles économiques collaboratifs et les technologies permettant le Web 2.0 en réseau garantissent l'amélioration des activités et du quotidien des 66 000 employés de Cisco». Il est donc aisé de trouver des émetteurs officiels et originaux de la doxa web 2.0, dont le propos s'accorde avec leurs intérêts, et qui ont les moyens de financer des publicités pour la vente de leurs produits. Ces émetteurs ont des discours en accord avec leurs intérêts économiques, moins prophétiques et moins teintés d'idéologie naïve que ceux des adeptes du web 2.0. En revanche, les propos entendus dans le film Us now relancent la problématique de l'engagement du scientifique s'il s'avère que l'idéologie de tels films et discours promeut une culture objectivement antagoniste à celle des savants et de la rationalité. Et, tout en évitant l'écueil d'une théorie du complot (éventuellement doublée d'un déterminisme social total: des acteurs inconsciemment au service d'un pouvoir aussi totalitaire que masqué), ils devraient à la fois aider à repérer les individus et groupes sociaux qui ont objectivement et consciemment avantage à la diffusion de la culture qu'ils promeuvent, et à comprendre quels ressorts font que bonne foi et mauvaise foi peuvent se conjuguer de façon suffisamment complexe chez les destinataires-relayeurs de ces discours25: par exemple, beaucoup d'informaticiens, d'analystes de l'internet, de politiques les reprennent à leur compte, et de tels propos sont aussi présents en de nombreux appels d'offre de programmes de recherche.Ainsi, le regard sur le caractère technique et industriel de l'internet n'élude pas l'analyse de pratiques sociales complexes. Au contraire, il permet une analyse détaillée des rapports de force, de dépendance et d'intérêt entre des acteurs variés et met en évidence de fortes corrélations entre économie et idéologie. Il dévoile de nombreux porte-parole de cette idéologie, aux statuts variés (les mondes savants n'en sont pas exempts et leurs bailleurs de fonds non plus26), et laisse transparaître la complexité de leurs positions, pouvant aller de la mauvaise foi délibérée à la franchise la plus directe en passant par des croyances qui traduisent des normes sociales et des imaginaires.
1.3 La part de l'invention
1.3.1 Le difficile choix des témoins
Réciproquement, s'intéresser aux humains en relation au sens large avec l'internet oblige tout d'abord à se débarrasser de tout préjugé face à la notion d'utilisateur: cette catégorie fort floue recouvre peut-être plus d'un milliard de personnes dispersées un peu partout dans le monde, et dont nous ne savons rien ou presque. À partir du moment où nous tentons de leur associer des pratiques, nous devons donner de ces dernières des définitions précises, puis nous demander quelles catégories d'humains elles concernent, quelles agrégations elles supposent, quels implicites les structurent. C'est pourquoi la notion d'usage de l'internet invite d'emblée à la méfiance: usages de quoi (quelles définitions de l'internet?), mais aussi usages de qui? Des Calabrais, des Japonaises, des vieux pauvres, des Scorpions ascendant Cancer ou des flibustiers de l'internet? La notion d'usage est souvent accolée à une représentation sociale qui propose une décomposition des sociétés et du monde en sous-groupes, parfois bien définis, d'autres fois arbitraires, imaginés, projetés. Or, c'est le plus souvent dans ce dernier contexte que l'usage est sollicité, au point que les études à ce sujet semblent avoir pour fonction première de conforter l'imaginaire social de leurs commanditaires [Le Marec, 2002]. Pour prendre la mesure de la variété des analyses et expériences de l'internet, la démarche idéale me semble consister en une approche herméneutique située, au plus près des pratiques d'écriture. Aussi l'étude des «auteurs» (ou scripteurs) de l'internet me semble-t-elle féconde. Cette démarche a l'avantage de partir d'un cercle assez réduit et relativement facile à caractériser: les informaticiens de l'internet, mais aussi l'ensemble des individus impliqués d'une façon ou d'une autre dans la conception, la maintenance, le détournement, ou l'application de protocoles, logiciels ou programmes, ces derniers fussent-ils réduits à quelques lignes -incluant donc les auteurs de pages web, dès qu'ils usent de code html, php ou JavaScript27. Cette approche peut englober tous les praticiens de l'internet, tant que leurs pratiques relèvent un tant soit peu du bricolage, voire du braconnage. Elle permet d'éviter la rhétorique commune sur les usages et de mesurer la puissance inventive des individus, en précisant comment elle relève d'une combinaison de singularités et de collectifs, l'archétype de ces derniers étant la notion -fort variable suivant les époques et les personnes concernées- d'école de pensée. Une approche purement sociologique de ces auteurs est possible. Mais elle est délicate, du fait de la multiplicité des acteurs impliqués. En effet, le degré d'enchevêtrement des statuts des auteurs de programmes, protocoles et logiciels, connus ou méconnus, est élevé: solitaires ou travaillant en équipes, salariés, entrepreneurs, chômeurs, retraités, étudiants, militants, etc., les profils de ces scripteurs sont parfois un mélange de tout cela, qui peut être pimenté de paradoxes; par exemple quand des employés sont payés par des firmes privées pour développer des logiciels gratuits (ex.: Sun/Oracle avec OpenOffice28). Cet éventail des statuts et caractéristiques est désormais mondial, ce qui complique la donne: il n'est pas si simple de comparer un administrateur de réseaux irakien, un webmestre cubain et un pirate californien. Une première façon de clarifier cet univers social consiste à poser la question: «qui paie qui et à faire quoi»? Se dévoilent alors les rapports de domination et de collaboration entre institutions, et entre elles et leurs employés: structures politiques, pédagogiques ou entrepreneuriales favorisant le développement de logiciels libres, ou à l'inverse interdisant leur usage, centres de recherche financés au moins partiellement par des entreprises de production logicielle29 ou par des États à l'écoute de ces dernières30, fournisseurs d'accès à l'internet mandatés par l'État pour surveiller leurs clients, etc. Autant de cas de figure qui n'empêchent pas des pratiques contradictoires au sein d'une même structure, des évolutions, voire des revirements, mais qui peuvent donner à lire, à partir d'un éventail de positions et de situations collectives comme individuelles, ces relations de pouvoir entre des personnes et des organisations évoquées au point 1.2.1. De tels travaux peuvent se poursuivre en France avec les sociologues qui montrent comment les discours qui sollicitent le registre de l'économie (mondialisation, compétition, crise, etc.) ou de la gestion (création, conduite de projets, épanouissement) réduisent l'autonomie professionnelle d'un grand nombre de personnes aux métiers en relation avec l'informatique et l'internet31.1.3.2 Créativité, collectifs et cultures
Au moins cette focalisation sur les auteurs met-elle en évidence la difficulté à évoquer leurs productions sans évoquer les mots «logiciel» et «informatique» -souvent proscrits quand sont évoqués les usages de l'internet- et leur originalité: une telle variété de statuts ne se rencontre pas dans toutes les industries. En effet, les amateurs n'ont pas (ou plus), dans la chimie ou dans la téléphonie mobile, la place qu'ils occupent dans l'internet32. Et, malgré la floraison des logiciels existant et les contraintes objectives de l'écriture en réseau, la place offerte à l'initiative et à l'inventivité -même si parfois celle-ci relève d'une faible connaissance de ce qui a déjà été fait et qui serait aisément réutilisable- et la façon dont elles sollicitent savoirs et savoir-faire invitent à considérer attentivement les pratiques de ces auteurs particuliers. Il semble impossible d'aborder la question de cette production en faisant l'impasse sur sa dimension intellectuelle, et donc sociale. L'exercice de la pensée à des fins précises devient rapidement limité s'il se conduit en solitaire. Ce fait est repéré par les historiens des mondes lettrés, au point qu'il les conduit à s'intéresser majoritairement à la façon dont des pratiques collectives s'institutionnalisent [Jacob, 2007,Baratin et Jacob, 1996]. Il est flagrant avec l'internet: entre la sollicitation des moteurs de recherche et l'usage intensif de l'échange (avec le courriel ou les listes de discussion), la production intellectuelle des informaticiens professionnels ou amateurs33 affiche son caractère social. Ce constat s'explique en partie par la notion d'effort, qu'il introduit efficacement. Avec l'internet, nous sommes tous confrontés à «des procédures intellectuelles et contraignantes» [Mathias, 2009] -douloureux revers de l'accroissement potentiel de nos capacités intellectuelles. L'internet nous résiste bien souvent, que ce soit parce que les réponses d'un moteur de recherche à nos requêtes nous plongent dans le désarroi, parce qu'un traitement de texte populaire déplace à notre insu quelques notes de bas de page, ou encore parce qu'un programme refuse de s'effectuer si nous n'y ajoutons pas un point-virgule. Ce qui nous conduit à l'échange. Néanmoins, ce caractère collectif de l'activité mentale semble sous-évalué. L'étude des praticiens de l'internet aide alors à montrer que des postures scientifiques -a priori divergentes- contribuent à étouffer cette dimension collective de l'activité intellectuelle et son articulation avec le développement de la technique: les conceptions spiritualistes, qui nient que la pensée puisse être dépendante des outils de communication et des techniques; le déterminisme social, qui minimise l'effort individuel et donc élude les détails de l'acquisition des savoirs, de leur affinage et de leur transmission; enfin, l'histoire populaire, avec ses auteurs spécialistes de la construction sociale de la figure du génie et de l'inventeur héroïque. De telles attitudes, répandues, donnent à penser que la surenchère actuelle au sujet de l'intelligence collective34 et de la puissance des réseaux sociaux de l'internet puisse être une réaction aux inerties intellectuelles qui ont étouffé le débat sur les relations entre psyché, social et technique. Il y aurait alors un effet de substitution instructif: la «révolution culturelle» de l'internet ne serait alors que révélation d'une évidence historiquement occultée. Des positions militantes comme théoriques traduiraient alors des conflits pour des positions statutaires, des enjeux de légitimité, qui impliqueraient jusqu'aux universitaires et intellectuels [Bourdieu, 1984]. Le regard sur la façon dont la dimension la plus privée et la plus solitaire de l'activité professionnelle d'un individu (chercher, trouver, adapter, produire) le plonge d'emblée dans un univers social offre une autre piste: le détail de la production d'une culture. En effet, les personnes en rapport direct avec le développement d'une technique dont la dimension intellectuelle est manifeste sont, au-delà des conflits et compétitions qui les animent, prises dans un collectif délimité par le partage du savoir et en quelque sorte engagées dans une même aventure, qui les conduit à l'échange. Cet engagement va produire des souvenirs, une histoire, un désir de narrer cette aventure, malgré les tensions, les prises de distance, les rejets qui ne manqueront pas de l'émailler. Cette histoire peut s'enraciner dans une culture à dimension mémorielle tandis que l'expérience fabriquera deux autres formes de culture: l'une à dimension sociale -un comportement adaptatif, appris- et l'autre, à dimension intellectuelle -fruit du savoir acquis35, inventé, transmis. Une des formes les plus manifestes de cette socialisation est le colloque d'informaticiens au sens large avec sa variante, le hackathon36. La compétence des participants est manifeste, son caractère technique ne l'est pas moins: leur savoir-faire, face à ces machines que sont les ordinateurs, se voit sans conteste. En même temps, la logique d'échange et de développement des connaissances dans ce type de rencontre témoigne de son caractère intellectuel, scientifique. De tels «lieux éphémères de savoir» donnent à voir la façon dont se constitue et s'étoffe une technique, comment elle fabrique une culture en même temps qu'elle en dérive; ils aident à repérer et à préciser les trois composantes de la culture évoquées précédemment:- une culture au sens fort et individuel du terme (avoir de la culture, un savoir étendu, spécialisé), qui peut se confondre avec la notion de culture savante: cette culture est en rapport étroit avec le présent (le savoir en train de se faire) mais aussi avec le passé (écoles de pensées, aspects cumulatifs et paradigmatiques du savoir -manifestes dans le domaine de l'informatique). Je nomme culture1 cette dimension de la culture.
- Une culture comportementale, de type habitus, qui est à la fois enracinée dans un passé (références à la Californie, à la décontraction des premiers fabricants de micro-ordinateurs) et se nourrit elle aussi au quotidien du rappel et de l'invention de normes et de pratiques sociales, avec la possibilité qu'elles s'incorporent en des rituels: la vente aux enchères, à l'issue d'une conférence, des tee-shirts et autres objets emblématiques des précédentes conférences (et qui étaient alors donnés) est symptomatique de la façon dont les groupes développent une identité et une mémoire tout en laissant les individus y acquérir des places singulières. Les sommes importantes que certains dépensent -plusieurs centaines d'euros- garantissent la tenue des futures conférences, attestent de leur engagement dans le groupe, de leur réussite professionnelle et aussi de leur conception du monde37. La dimension morale d'un tel moment s'affiche: on l'intitule «vente de charité». Nous avons ici affaire à une culture très dynamique: elle se fabrique, et ne se cache pas derrière des normes si incrustées qu'elles sont invisibles à ceux qui les adoptent38. J'appelle culture2 ce type de culture. Remarquons qu'il convient de ne pas mettre tous les habitus dans le même placard. On évoque souvent chez ces informaticiens un code linguistique qui témoignerait de leur culture naïve et moraliste: le Bien, le Mal, le Chevalier blanc, etc. Ce type d'analyse, parfois légitime, montre ses limites quand il est systématisé: la volonté de bien faire n'est pas uniquement la conséquence d'une pression du groupe, mais aussi celle d'une expérience de production où la qualité d'une méthode (et les défauts d'une autre) apparaît «objectivement». Quiconque a tenté de programmer comprend rapidement ce qu'est un mauvais travail, une méthode à ne pas reproduire. Et ce type d'errance finit par s'inscrire dans l'histoire: le nom donné par ses auteurs à l'ancêtre du MS-DOS était QDOS (Quick and Dirty Operating System). Ainsi ce registre linguistique traduit-il en termes humoristiques une expérience d'érudition plus qu'une soumission à des normes collectives, et devrait pouvoir être rapproché du sentiment esthétique que revendiquent les mathématiciens devant une «belle» formule ou une démonstration «élégante». Nous avons ici un chaînon explicite entre la culture1 et la culture239 .
- Enfin, la culture3, plus conforme à l'idée commune de culture collective, qui a besoin du temps pour se sédimenter, et qui va en retour forger, sculpter les individus: la culture comme «comportement appris» (Ruth Benedict), qui concerne un «ensemble de méthodes et valeurs construites collectivement pour lutter contre l'adversité» -définition personnelle adaptée de Malinowski [Malinowski, 1968]. Cette culture se tisse à la suite des deux précédentes, de leur mémoire -sorte de culture-héritage qui sera réinjectée dans les deux autres (cf. l'exemple de la Californie).
- La technique fabrique de la culture. Je reconnais que nous ne sommes pas loin de l'évidence anthropologique, mais je trouve instructif que le regard sur les pratiques des informaticiens rappelle ce fait aussi directement.
- Puisque la culture1 nourrit la culture3 (avec un éventuel décalage de génération), nous pouvons imaginer que la culture3 actuelle est en partie façonnée par une culture1 d'hier. En l'occurrence par de multiples éruditions, savoir-faire, inventions, et résolutions de problématiques. Ceci donne à la définition de la culture (culture3) une dimension technique et scientifique qui est peut-être trop négligée (et certainement en rapport avec la minimisation de la dimension collective du savoir): les cartographes du XVIIIe siècle, les ingénieurs du XIXe siècle auraient alors fabriqué une culture, une grille d'entendement du réel dont nous subissons aujourd'hui les effets. En même temps, cela suppose que des conceptions rationnelles, ou au moins efficaces dans une temporalité donnée, aient pu produire à terme des éléments culturels qui le sont moins, qui relèvent de pures projections sociales40: une raison d'antan pourrait être source d'une croyance actuelle. Ce fait me semble fort intéressant.
- Et s'il est admis que cette culture3 forge les comportements et les esprits, il est utile de se demander quels sont ses effets sur la culture1, ou au moins sur ses modalités: la production de nos techniciens a de fortes chances d'être influencée par cette troisième forme de la culture qui a façonné leur enfance et leur vécu. Pour le dire autrement: réapparaît l'hypothèse qu'au delà des enjeux et rapports de force qui peuvent la déterminer, une technique soit aussi influencée par des imaginaires, des conceptions ou projections sociales, voire des préjugés sociologiques (cf. point 1.1 ).
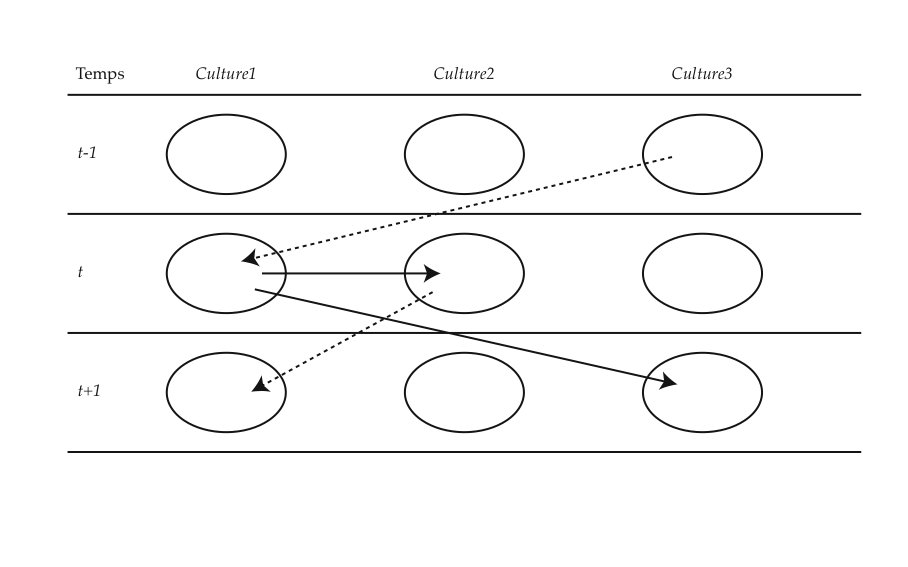
1.3.3 Technique, culture et bricolage
Ces constats et déductions, les nouvelles hypothèses qu'ils induisent, et l'univers logique qui permet leurs échafaudages formels résolvent une contradiction et offrent deux pistes de recherche.- Rappelons le souci de ma première approche: elle permet de discerner rapidement des rationalités économiques et politiques, des appâts du gain et du pouvoir, des capacités à produire et à diffuser des idéologies pour arriver à ses fins, conserver quelques privilèges ou maintenir un ordre social. En même temps, il restait peu de place pour l'exposé de la dimension rationnelle des techniques, pour expliquer comment celles-ci s'accordaient avec les croyances de leurs inventeurs, avec les productions scientifiques des laboratoires qui s'associaient à ces inventions41 et -ne les oublions pas- les succès économiques.
La seconde approche complète la première en explicitant les relations entre individu et collectif, entre savoir et culture. L'invention assume son enchâssement dans la culture et son intention de la transformer, et la technique affiche sa fonction sociale. Et il n'apparaît plus choquant que les inventeurs, les savants, les entrepreneurs ou même leurs thuriféraires aient des croyances, des représentations du monde, ni qu'elles se combinent avec des savoirs et des savoir-faire.
Le schéma 1.2 propose une synthèse de cet état de faits.
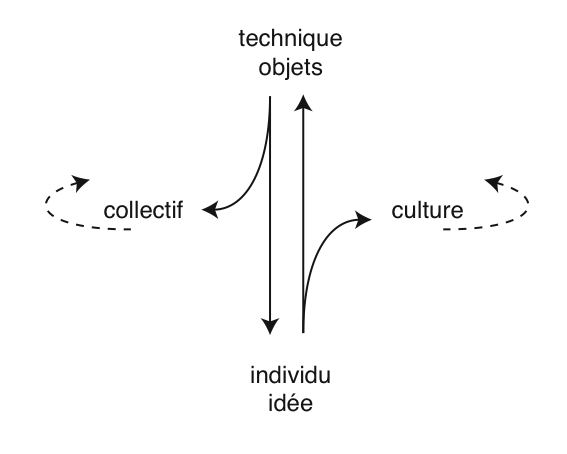
Figure 1.2: La culture au carrefour des objets et des sujets . Le lien entre savoir et culture, apparaît alors sous une forme plus cohérente: on ne demande jamais à une culture d'être non-contradictoire, même si elle se fonde sur des raisonnements. Au point qu'elle est, pour certains, construite sur des «contradictions cognitives» [Goody, 2003]. Et de ce fait, son évocation civilise le dialogue quand l'idéologie le rend conflictuel42. Une telle prise de recul n'implique pas l'abandon de toute analyse critique, au contraire, et je pense que certains idéologues méritent d'être jugés quand s'affiche le caractère stratégique de leurs choix et quand ils sont faits en toute conscience. Mais, d'une part, la faiblesse de leur argumentation résulte de son efficacité: leur talon d'Achille réside dans leur capacité à faire oublier le détail des dimensions inventive et culturelle des techniques. D'autre part, s'il est facile de distinguer l'idéologue de son idéologie -la seconde ne risque guère de passer devant un tribunal- nous pouvons prendre conscience du statut spécifique des idéologies qui s'appuient sur la technique: non seulement elles se fondent dans une culture, dans un ordre du discours43, qui souvent les débordent, mais elles peuvent avoir une dimension mythique. Au moins, quand nous rencontrons une idéologie en relation avec une technique, aussi flagrante ou choquante soit-elle, sommes-nous dans l'obligation d'imaginer qu'il en existât d'autres, en d'autres temps, aussi efficaces, et peut-être aussi incontournables. Ainsi, le détour par le savoir et la culture donne-t-il une épaisseur à l'idéologie comme objet scientifique: les croyances populaires, les mythes de l'internet, aussi forcés soient-ils, témoignent de cet étroit échange entre technique et culture, de l'inséparabilité entre technique et représentations sociales, et invitent à repérer des équivalents passés à partir d'autres exemples. - Le détour par l'histoire aide aussi à imaginer une réelle approche scientifique de la technocratie, trop souvent considérée comme menaçante au moment de son étude, plus rarement étudiée dans un contexte historique. Et si la technocratie semble aussi dangereuse, tel un bras armé des aliénations contemporaines [Habermas, 1973], l'étude des conditions détaillées de sa production, ainsi que des formes précises des cultures ou des idéologies qui ont marqué ses membres pourrait à la fois montrer son hétéronomie et ses genèses: n'est-elle pas, elle aussi, le produit d'une compétence technique et d'une culture, souvent nationale? Peut-on vraiment imaginer comment elle va déterminer les structures profondes des sociétés des siècles prochains?
- Enfin, et je l'ai déjà évoqué, la compréhension de l'influence concrète de la compétence technique sur la culture mène naturellement à d'autres questions historiques. Il est fort probable que les personnes engagées dans le développement d'une autre technique (le chemin de fer, le nucléaire, la pilule contraceptive, le téléphone, etc.) aient elles aussi produit des éléments de culture au travers de leurs réalisations, qui pouvaient autant témoigner de leurs représentations sociales, de leurs conceptions que de leurs inventions. Et cela doit aussi valoir pour les savants à l'origine des sciences théoriques. En ce cas, quelle est et fut l'influence -par exemple depuis 1600- des lettrés du nombre et de la figure, et plus généralement des ingénieurs, des techniciens et des scientifiques, sur notre culture? Jusqu'à quel point ce type d'interrogation a-t-il ou non été minoré au XXe siècle, au moins en France? Autant de questions à mon avis fructueuses.
1.4 Bilan méthodologique d'une dualité
J'ai choisi une définition de l'internet qui présentait de façon presque duale une industrie et des humains. Une description qui privilégie le premier terme met en évidence des consortiums, des multinationales appartenant à divers champs de l'économie mondiale. Leur taille, leurs besoins sont tels que tout regard scientifique sur l'internet est conduit à étudier les enjeux économiques et politiques de cette industrie lourde et fortement interpénétrée. En même temps, cette réalité des rapports de domination semble niée par des prophètes qui nous invitent à embrasser un nouveau monde presque paradisiaque. Il est aisé de repérer le caractère idéologique de tels discours, ainsi que les pôles de puissance qui ont intérêt à leur diffusion. En revanche, il n'est pas si simple d'expliquer comment cette idéologie peut s'articuler avec une culture, comment elle peut aussi aisément recruter des oblats; ni, plus largement, de comprendre comment une rationalité technique sophistiquée peut s'accorder, voire s'articuler avec un large éventail de croyances47. La démarche inverse s'intéresse aux personnes impliquées d'une façon ou d'une autre dans le fonctionnement, la maintenance ou le développement de l'internet. Elle aussi permet de décrypter des relations de pouvoir, de dépendance et d'allégeance. Mais est-ce le fait de la jeunesse, sinon de la spécificité de la technique étudiée? La confusion des genres et des statuts des personnes, entre amateurs et professionnels, tout comme la complexité de leurs intérêts font que l'analyse sociologique apparaît ici plus lente qu'avec la première approche, même si elle semble à terme aussi fructueuse. En revanche, l'intérêt pour les productions individuelles met en évidence leurs caractères intellectuel et collectif, leur étroite articulation avec la culture, et le détail de ses composantes. Autrement dit, la focalisation sur les savoirs et les productions des techniciens de l'internet ouvre des perspectives sociales et culturelles qui seraient difficiles à appréhender avec la seule première approche; elle permet d'intégrer l'internet dans un contexte plus large où apparaissent les relations actuelles et passées entre technique, savoir et culture; d'une façon qui intègre les idéologies, les discours et les représentations sociales.
Chapitre 2
La construction d'un terrain
2.1 L'informatique littéraire à l'ENS
2.1.1 Du Soudan à l'internet
En 1991, après diverses activités sur lesquelles je reviendrai, je suis devenu agrégé-répétiteur à l'École normale supérieure: «caïman d'informatique littéraire», profil inventé par l'ENS pour introduire l'informatique dans sa division littéraire. Rétrospectivement, mon statut comme mes fonctions d'alors peuvent sembler ambigus: j'étais à la fois chercheur en sciences sociales et tuteur en informatique; j'enseignais parfois à des personnes plus diplômées que moi, les aidais à obtenir des postes universitaires alors que j'étais moi-même un intérimaire de la recherche: mon poste était reconductible chaque année. Je n'étais pas docteur. J'étais à la fois invité à le devenir dès que possible et à me dévouer à l'institution -ce qui avait pour effet de reporter l'écriture de la thèse. Le poids des incertitudes du futur ne bridait cependant pas mon autonomie intellectuelle: je compris vite que le moyen le plus efficace de familiariser les élèves et les enseignants-chercheurs de la division littéraire de l'ENS avec l'informatique consistait à l'associer au plus près de la recherche. Et mon implication dans les méthodes statistiques, lexicométriques, cartographiques m'aura permis des dialogues exceptionnels avec des historiens, linguistes, géographes, sociologues, philosophes, antiquisants, juniors ou seniors. De Marguerite de Navarre aux immigrés de l'entre-deux-guerres en passant par les cours de mathématiques pour agrégatifs de sciences sociales et la cartographie de l'internet, je me suis impliqué dans une série de recherches et de débats épistémologiques souvent passionnants, et qui ont alimenté presque naturellement cette discipline en construction qu'était l'informatique littéraire. Les doutes et les efforts étaient bien présents. Mais l'originalité des projets qui sous-tendaient de tels travaux a plus fréquemment favorisé l'invention que la banale reproduction de méthodes balisées. En d'autres termes, j'ai eu l'occasion de défricher des savoirs marginaux48 et dont le statut et l'évolution m'auront permis de comprendre comment disciplines, concepts et méthodes sont associées. J'avais aussi choisi de m'engager en des activités «techniques»: je m'étais engagé dans un programme d'informatisation du futur département de sciences sociales, qui allait mener à l'achat de machines Unix reliées entre elles par des câbles au nom étrange: Ethernet, première strate d'un réseau plus vaste appelé internet. Ces ordinateurs étaient élégants, appréciés des chercheurs en informatique; ils en avaient pour nom «NeXT». Un peu plus tard, j'aurai confirmation que c'est sur de telles machines qu'un curieux protocole, le World Wide Web aura été mis au point. En attendant, il me fallait apprendre comment fonctionnaient ces ordinateurs et donner à mes collègues le goût de leur usage. Tâches qui requéraient dans les deux cas l'aide des informaticiens, qu'ils fussent enseignants-chercheurs, agrégés-répétiteurs, techniciens ou élèves -autant j'avais réussi à me débrouiller seul avec des ordinateurs personnels, autant la notion de réseau m'était étrangère. De mes débuts, je garde le souvenir de personnes généreuses, qui m'apprenaient sans compter leur temps les langages de l'informatique Unix: ceux-ci sont d'une efficacité redoutable, mais rudes. Quant aux premiers usages de l'internet, quels pouvaient-ils être sinon un import, un placage de ceux de nos chercheurs en informatique? C'étaient eux qui «nous» conviaient à nous émerveiller de la présence de tel ajout (patch) au système d'exploitation des NeXT sur un serveur FTP néo-zélandais, à «chatter» avec des amis partis aux États-Unis, à nous envoyer des mails presqu'inutiles puisque nous n'étions qu'une poignée, dans l'univers parisien des sciences humaines, à connaître l'existence de ce mode de communication. Et l'appropriation définitive de ces machines -attestée par leur détournement, par des usages qui n'étaient plus ceux des chercheurs en informatique, et qui n'étaient pas non plus ceux, transplantés, des chercheurs littéraires avec leurs ordinateurs personnels- aura pris au moins trois ans. En sus de leurs usages, ces experts en informatique auront aussi exporté leurs préoccupations réflexives: à partir de leur pratique et des questions qu'elle leur posait, ils ont suggéré l'idée que l'internet allait produire la bibliothèque gratuite, publique, universelle rêvée par tant de savants, que ces réseaux portaient un projet autant social et intellectuel que technique49, voire qu'enfin l'idéal savant et l'idéal politique allaient se rejoindre [Flichy, 2001]. J'étais sensible à ces idées, à ces «capacités», à ces possibles, d'autant qu'ils prenaient assez aisément consistance pourvu qu'on s'obstinât devant un clavier et un écran. Et il me semblait que ma position statutaire, le fait que le département de sciences sociales avait décidé de jouer les pionniers de l'informatique pour l'École littéraire, et les possibilités de dialogue et d'échange qu'offrait un lieu interdisciplinaire actif jour et nuit et assez concentré permettait d'inviter des normaliens de toutes disciplines, élèves ou enseignants à pratiquer l'internet, à d'en mesurer les limites et à explorer les questions que posait cet objet indéfinissable, mouvant, informatique, et communicant. Je décidais de fédérer et d'institutionaliser ces expériences et débats50: quatre ans après mon arrivée à l'ENS, j'y fondais l'Atelier Internet51, qui tentait d'appréhender de façon théorique et pratique l'«incidence des réseaux sur les modalités de la recherche». Ce séminaire était soutenu par le ministère de la Recherche, et de nombreux informaticiens de la rue d'Ulm, élèves et chercheurs, littéraires ou non, ainsi que des personnes extérieures à l'ENS y participèrent: jusqu'à 30 personnes, et avec parfois des pics à 100. D'emblée, alors que nous nous voulions humbles et scientifiques, nous étions engagés dans ce regard rétrospectif sur l'univers collectif de nos propres pratiques: presque malgré nous, nous reproduisions la démarche classique des intellectuels52. L'objet de nos travaux s'exprimait en peu de mots: en quoi l'internet allait-il changer les pratiques des chercheurs? Cette rencontre avec ce qui allait devenir ma préoccupation première n'était pas fortuite. Et si l'expérience de l'ENS, en me permettant d'explorer de nombreuses perspectives de l'internet (informatique théorique, sciences de l'érudition, histoire des techniques, etc.) a déterminé certaines de mes hypothèses de travail, celles-ci étaient déjà partiellement profilées par ma double formation initiale. Celle-ci est certainement à l'origine du poste qui m'a été proposé à l'ENS: mes employeurs -membres d'une large commission de lettres et sciences humaines- m'avaient plus sélectionné parce qu'ils me faisaient confiance pour les accompagner dans leurs choix futurs que du fait de mes compétences informatiques, dont ils connaissaient le caractère récent et fragmentaire. À leurs yeux, je disposais de deux atouts essentiels pour l'avenir de l'École: mathématicien, je saurais communiquer avec les chercheurs en informatique et enseigner les statistiques; anthropologue, je saurais dialoguer avec les chercheurs en sciences humaines. En effet, aux alentours de mes 20 ans, élève de l'ENS St-Cloud, je m'étais fortement spécialisé en mathématiques. J'étais aussi épris d'une conception universaliste de la liberté. À la fin de mon cursus, je décidais donc de me confronter avec les formes les plus manifestes de la domination entre les humains, avec le projet de trouver le moyen de l'éradiquer. Je savais que de nombreux pièges empêchaient d'avoir le recul nécessaire pour les observer et les analyser. En bref, j'avais eu l'intuition que les propos politiques de l'époque manquaient d'expérience, notamment quant au Tiers-Monde, et que je comprendrais mieux ce dernier si j'évitais les anciennes colonies françaises. Aussi, une fois l'agrégation en poche53, je parcourus l'Égypte, le Soudan, puis son Sud alors en pleine guerre civile. C'est dans cette dernière région que s'ébranlaient mes dernières certitudes en matière de solutions politiques universelles. Je décidais alors de devenir anthropologue. Revenu à Paris, j'assaillis plusieurs professeurs et directeurs d'études jusqu'à ce qu'un d'entre eux accepte de me prendre en thèse: Georges Balandier m'ouvrait ainsi indirectement les portes du DEA de sciences sociales ENS-EHESS -dans lequel j'interviendrais souvent, cette fois en tant qu'enseignant. Le caractère aventureux de mon voyage chez les Dinka du Sud-Soudan et ma force de persuasion aidaient l'équipe pédagogique de ce DEA interdisciplinaire à se convaincre que je saurais tirer profit de cet enseignement, malgré mon absence totale de diplômes en sciences humaines54. Les cours se tenaient rue d'Ulm, où le sociologue Jean-Claude Chamboredon était le réel maître d'oeuvre de ce nouveau DEA fondé un an avant que je n'en profite. Son énergie, sa clairvoyance et son dévouement ont certainement contribué à faire de cette formation un des hauts lieux parisiens du débat entre l'histoire, la sociologie, l'anthropologie et la géographie. Ainsi, mes contacts avec les sciences humaines et l'ENS Ulm avaient une histoire, où deux disciplines a priori éloignées, les mathématiques et l'anthropologie, eurent chacune leur rôle à jouer -et l'ont assurément encore à l'heure où j'écris ces lignes. Ce qui devait être un passage, de l'une à l'autre, aura finalement produit un savoir métis, dont la lente édification est aussi la conséquence du goût développé cette année de DEA pour l'ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales. D'autres facteurs expliquent mon «hybridation» professionnelle des années 1990: mon terrain, au fin fond d'une ancienne colonie britannique, était loin de ceux des africanistes français, et la solution trouvée pour accroître mes savoirs pratiques d'anthropologue55) s'est avérée insoutenable: avant d'être une ville africaine, Yaoundé était pour moi la capitale d'une dictature soutenue par l'État français et ses ressortissants, sans réelle place pour le débat scientifique. À mon retour, malgré les efforts méritoires d'un Jean Bazin, qui ouvrait considérablement le champ de la discipline56, j'éprouvais quelques difficultés à trouver le fil d'Ariane qui me conduirait à un poste de chercheur en anthropologie57. Ce sera finalement mon terrain soudanais qui aura décidé de mon destin intellectuel: fin 1989, cinq ans après mon premier séjour, je fis une ultime tentative pour y retourner. Il était alors injoignable par les chemins traditionnels: Khartoum avait fermé le Sud. Je décidais alors d'y aller en passant par Nairobi; la guérilla y avait ses quartiers et un de ses représentants à Berlin m'avait promis qu'elle me conduirait chez les Dinka. Un sauf-conduit dûment tamponné témoignait de ses dires. Hélas, je piétinais quelques mois au Kenya sans pouvoir pénétrer au Soudan: je n'arrivais qu'à enquêter sur le marché de l'humanitaire [Guichard, 1990] et à visiter quelques hôpitaux de campagne où de pauvres hères contemplaient les bandages qui enveloppaient les moignons de leurs jambes arrachées par les mines. Je pris acte du caractère inaccessible de ce terrain soudanais58 et décidais de m'intéresser à des choses plus paisibles: à mon retour en France, je m'achetais un puissant ordinateur et j'apprenais à conjuguer l'informatique avec la photographie, la mise en page et les méthodes des sciences sociales. Pour ce dernier thème, Jean-Claude Chamboredon m'aidait à nouveau: en me faisant découvrir des experts, comme Marie-Ange Schiltz, ou des étudiants du DEA engagés en de lourdes enquêtes, tel Jean-François Chanet; enfin, en m'invitant à prendre en charge les enseignements de méthode dans ce même DEA.2.1.2 Tropismes et part de l'expérience
Ainsi, le hasard n'est pas l'unique responsable de mes intérêts pour l'internet et l'informatique des sciences humaines: de lourds déterminismes étaient responsables de ce détour par l'ENS. Ce détour fut aussi une chance, au point que sans lui, ce mémoire d'HDR n'aurait peut-être jamais vu le jour. Je fus embauché par Ulm six ans après mon DEA de sciences sociales; je n'avais pas de thèse et mes espoirs de reconversion professionnelle se dissipaient. Sachant que je n'aurais jamais pu tirer un trait sur ma première culture, je trouvais à l'ENS l'espace interdisciplinaire qui me permettait de l'accorder de façon continue avec celles que j'allais approfondir. La collégialité de l'institution, ses centralités spatiale et intellectuelle, la modernité de ses débats scientifiques, la présence d'élèves brillants et de cultures variées facilitaient aussi l'épanouissement de ma pensée et, plus tardivement, ma production savante: les échanges autour d'un café se transformaient en programme de recherche. Une passion commune devenait séminaire, qui se concluait par un livre: sensible au racisme que subissaient les immigrés, j'ai travaillé avec Gérard Noiriel sur les conditions de leur vieillissement en région parisienne (entre 1990 et 1992), puis nous avons monté dans la foulée un séminaire d'histoire quantitative de l'immigration qui fut à l'origine d'un ouvrage collectif [Guichard et Noiriel, 1997], lequel nous a valu les éloges de Pierre Bourdieu (et de Roger Guesnerie) lors du conseil scientifique du département de sciences sociales de 1997. Fort de l'expérience pratique et théorique de l'Atelier Internet, j'en profitais pour fonder avec Gérard Noiriel et un jeune ancien élève qui participait aux deux séminaires -Philippe Rygiel- une des premières revues savantes en ligne: les «Actes de l'histoire de l'immigration» (http://barthes.ens.fr/clio); parce que des informaticiens comme Jacques Beigbeder ou Roberto Di Cosmo proposaient toujours des réponses simples aux questions qu'on leur posait, j'ai pu, avec une facilité qui m'a surpris le premier, réaliser en 1999 un atlas de l'immigration en ligne. Celui-ci est toujours utilisé (http://barthes.ens.fr/atlasclio). Bien entendu, cet outil n'aurait pu exister sans la dynamique collective impulsée autour de la cartographie et ses «apports heuristiques en sciences sociales» -titre d'un séminaire que Jacques Revel me demandait de monter à l'EHESS à partir de 1997. Les débats de ces rencontres, l'expérience de la cartographie en ligne, l'intérêt pour la cartographie de l'internet, ont «naturellement» nourri la problématique des territoires de l'internet [Desbois, 2001], aujourd'hui si féconde. Et ainsi de suite, pourrais-je dire: tout cela faisait sens, et dévoilait, à défaut d'une «archéologie des savoirs», la dynamique de leur construction, leur épaisseur, leurs liens. Mon propos n'est pas de dresser un panorama idyllique ou complaisant de ces 11 annnées. Le niveau d'exigence de mes interlocuteurs -élèves ou enseignants à l'ENS, étudiants ou chercheurs parisiens- pouvait me prendre un temps considérable. Parfois, certaines demandes relevaient plus du service que de l'enseignement ou de la recherche. Tout cela pouvait ralentir l'acquisition de savoirs complémentaires et l'aboutissement de travaux personnels. Mais les bénéfices méthodologiques étaient toujours importants. Et, dans l'ensemble, de nombreux inconvénients se retournaient en avantages: par exemple, les représentations que certains enseignants ou responsables de l'ENS avaient de l'informatique et de l'internet - menace, technique transparente, discipline associée aux mathématiques, ou un peu des trois- ne favorisaient pas toujours une mise en perspective épistémologique. Cependant, elles m'ont obligé à préciser mon champ de recherche, à comprendre quelles confusions sociologiques pouvaient pousser des scientifiques à se persuader de la neutralité de la technique, et quels implicites de l'outillage mental servaient de terreau aux inquiétudes de certains érudits. Par ailleurs, ces questions avaient le mérite d'être énoncées très tôt, parfois plus de 15 ans avant que d'autres institutions ne s'en emparent ou n'y soient confrontées. Cela me donnait un avantage stratégique. Elles m'obligeaient aussi à préciser le périmètre d'une discipline ou d'une recherche en construction -l'informatique littéraire, l'internet comme objet de recherche, puis la relation entre savoir et technique59- et à l'accompagner d'une sociologie du monde universitaire qui contribuerait elle aussi à me faire découvrir le moyen optimal de comprendre les enjeux de l'internet: mon activité, mes recherches n'étaient pas neutres. Elles dévoilaient des jeux d'alliance internes ou externes, compliqués d'historiques dominations entre disciplines, de tentatives de les infléchir, des économies symboliques, des constructions de légitimité scientifique60. Ces exigences, ces écarts entre pratique et théorie, entre méthodes et traditions intellectuelles, entre représentations de la science et de ses outils et ces dialogues interdisciplinaires m'auront beaucoup appris: en me permettant d'explorer de vastes domaines aux lisières de la technique et de l'érudition, d'appréhender la dynamique de leur construction -entre invention, tradition et institution-, et enfin d'aborder l'internet sous les angles que m'offraient les regards précédents. Assurément, je fus à bonne école. Et cette expérience m'amène à quelques remarques:- Le regard que j'ai sur les objets scientifiques qui m'intéressent aujourd'hui (l'internet, l'écriture) est dépendant de cette expérience intellectuelle. J'ai découvert l'informatique dans un contexte professionnel, où les ordinateurs et les réseaux devaient accroître les compétences de leurs utilisateurs, et par conséquent, les déplacer: en les orientant vers le fonctionnement de ces machines, et vers les méthodes qu'elles pouvaient reproduire. Il s'ensuit que je reste marqué par la complexité et le métissage de ces savoirs, la difficulté à les transmettre, et par les interrogations qu'ils suscit(ai)ent: de disciplinaires, invitant parfois à des réponses laconiques, ces questions devenaient historiques et épistémologiques. J'aurai donc toujours du mal à considérer ces savoirs comme acquis, à la portée du premier venu. Et quand je me pencherai sur les usages d'un grand public, je n'oublierai pas que les difficultés que j'ai rencontrées avec l'informatique et l'internet, et que j'ai vérifiées auprès de nombreux collègues et étudiants, puissent aussi être partagées par ce grand public. Ce qui, en corollaire, explique mon scepticisme quand j'entends des discours communs ou savants minorer la dimension intellectuelle des usages de l'internet ou la relation entre l'internet et l'informatique61. Ceci ne m'empêche pas de raccorder ces pratiques savantes à des savoirs profanes, quand une méthode complexe pour les uns se transforme en culture pour les autres, ni de concevoir que ces derniers savoirs puissent aussi être autonomes des premiers.
- Ensuite, le fait de découvrir un déplacement des savoirs, leurs besoins de s'articuler avec des nouveaux (essentiellement ou d'abord techniques et méthodologiques) m'oblige -sauf à croire naïvement en une révolution dont la puissance la rendrait unique au monde- à imaginer qu'il y en eût d'autres. D'où l'idée de comparer les déplacements d'aujourd'hui aux précédents, même s'ils ne ressemblaient pas à ceux que j'ai pu vivre et voir. On l'a vu62, cette hypothèse conduit à l'étude historique des mondes lettrés, et à y inclure celle des scientifiques des derniers siècles.
- Mon expérience ulmienne constitue certainement le vrai «terrain» où j'ai pu élaborer et aiguiser mes théories, et m'a permis aussi de relever quelques points communs à l'anthropologie et aux mathématiques: conceptualisation et souci de cohérence -dont elles n'ont pas le monopole; goût pour la généralisation, invitant à négliger des théories locales si des globales peuvent les absorber (de même pour les objets d'étude) -sorte de principe du moindre effort qui cherche à la fois le levier explicatif et son point d'appui idéal; construction d'un universalisme logique -et non moral, point essentiel pour l'anthropologie- qui assume de débattre du caractère transhistorique de certaines vérités [Bourdieu, 2001b]; et enfin intérêt certain pour les outils et la technique. Ce sont aussi deux disciplines dont les représentants acceptent sans trop d'efforts l'invitation à la réflexivité63 , le débat sur la notion de vérité et l'auscultation par la sociologie des sciences.
- Si la rédaction d'un mémoire d'HDR est l'occasion de souligner l'évolution et l'originalité de sa propre pensée, elle ne doit pas occulter le caractère fortement collectif de toute activité intellectuelle: sans de nombreux étudiants et collègues, dont certains sont devenus des amis, ma réflexion n'aurait pas atteint son stade actuel. J'ai déjà évoqué cette dimension au chapitre précédent, et l'existence d'institutions savantes permet de ne pas l'oublier: si nous pensions si bien seuls, elles n'auraient pas de raison d'être. Les conditions de fonctionnement de l'Atelier Internet et les modalités variées de l'élaboration et de la transmission des savoirs dans un lieu comme l'ENS me l'ont confirmé de façon insistante. Au point que cette envie d'être ensemble est probablement mue par une même intuition partagée par de nombreux individus: l'idée que l'activité psychique soit profondément technique, vertébrée par les savoir-faire, et donc qu'elle ne puisse se déployer qu'en des collectifs. Ce qui conduit à supposer que les savoirs ne peuvent se donner à voir ni se développer sans les outils ni les institutions qui leur sont dédiés.
- l'enseignement d'une «littératie de base». Cela constitue la déclinaison informatique des 3R britanniques (Read, wRite, aRithmetics): écrire, compter, dessiner (l'internet introduira le savoir documentaire). Cette culture de base passe par le traitement de texte, les éditeurs et les outils d'écriture comme LATEX, et peut aller jusqu'au calcul (tableurs), la programmation, la cartographie. On est ici dans le domaine de l'enseignement technique, et la frontière avec les savoirs spécialisés de l'apprenant est manifeste.
- Apparaît ensuite la conception d'outils informatiques pour littéraires: elle se réalise à partir d'un dialogue entre des personnes aux savoirs différents72. Les deux interlocuteurs profitent des déplacements réciproques de ces savoirs. Ici apparaît la notion d'outil ad hoc, et le travail sur la graphie est manifeste: repérer les didascalies de Beckett, dénombrer les références au «nouveau» dans des textes de politique scientifique, trier des valeurs pour les associer plus facilement à un mot (par exemple, à une couleur, cas évident et oublié pour la cartographie), etc. L'informatique reste technique, mais la littératie qu'elle sollicite se rapproche des briques élémentaires constitutives de méthodes qui lui pré-existaient. On travaille sur des symboles, des formes graphiques (les motifs informatiques: patterns), que l'on ordonne, associe, décompose, additionne, mesure, compare, projette, etc. La décontextualisation opère: des mots, des concepts ne sont plus que des points dispersés dans un espace multidimensionnel (AFC), des sommets dans un graphe, quand ils ne sont pas noyés en des lignes qui deviendront cartes, images.
- Les participants à cette aventure se demandent alors ce qui relève de l'informatique et ce qui n'en relève pas. Ils comprennent que les savoirs, aussi spécialisés soient-ils, sont faits d'écriture, de procédures, de conceptualisations voire de théories dans lesquelles ces objets écrits élémentaires et les moyens qu'on a développés pour les traiter, les arranger, ont souvent un poids démesuré. Ils abordent alors l'histoire et l'épistémologie de la discipline qui a convoqué l'informatique. Et ils réalisent que la technique est partie intégrante de cette épistémologie.
- Comment décomposer l'écriture et mesurer les interactions entre ses éléments structurants, puis entre leurs relations? La réponse à cette première question, et plus encore, l'idée de poser cette question en ces termes, me fut donnée par Yves Jeanneret75 et par Christian Jacob, pour qui l'écriture a trois dimensions: matérielle (support et système de signes), intellectuelle, sociale (ex.: le groupe de lettrés). Et l'exemple du rouleau de papyrus aux marges étroites, sans place pour l'annotation, qui contraint Ératosthène à inventer un système de signes qui synthétise son raisonnement et ses conclusions, puis ses successeurs à le transmettre par le biais d'écoles me semble être l'exemple paradigmatique des interactions entre les constituants de l'écriture [Jacob, 1996]. Et si j'en vois quatre au lieu de trois, c'est pour tenir compte de l'écart entre le système de signes et son support auquel nous confronte l'informatique76.
- Puisque l'usage de l'écriture requiert une large technicité, on conçoit que les savoirs qu'elle transporte coexistent avec les savoir-faire propres à la maîtrise de la technique. Peut-on tracer une frontière entre les uns et les autres? Pour le dire autrement: puisque ces apprentissages requièrent un effort, l'organisation de leur transmission a-t-elle pour effet de contraindre les évolutions de ces savoirs et savoir-faire, et de les distinguer artificiellement? Ce qui permet d'introduire une autre question, elle aussi induite par mon expérience d'informaticien littéraire: les élèves et enseignants de l'ENS désireux d'infléchir leurs recherches à la lueur de l'outillage informatique n'étaient pas si nombreux. Pourquoi si peu de personnes étaient tentées par les avantages et les mises en perspective qu'offrait cette nouvelle écriture? Là encore, les travaux de Jack Goody et Christian Jacob m'ont aidé à prendre du recul et à mieux comprendre comment se forgent et s'institutionnalisent des littératies, tout en me donnant le goût du comparatisme historique: quand ils détaillent, au sein même des mondes lettrés, les tensions entre inventivité et routine, entre tradition et nouveauté; et quand ils rappellent leur caractère presque inéluctable.
2.1.3 La découverte du lien entre technique et discours
La rédaction de la thèse fut l'occasion de théoriser ma pratique, en détaillant l'inclusion de l'informatique dans l'écriture. Peu après, j'affinais et synthétisais ces résultats dans un article au titre explicite: «L'internet, une technique intellectuelle77» [Guichard, 2004a]. Ce texte, largement diffusé, avait aussi pour but de faire débat chez les informaticiens: il ouvrait les actes du colloque Mesures de l'internet que j'avais organisé en 2003, quand j'étais chercheur à l'INRIA78 . Cet article avait deux parties: la première, consacrée à l'écriture, la seconde à l'informatique. Dans la première, je rappelais les capacités rationalisantes de l'écriture (défaite de la magie), et donnais des exemples historiques d'interactions entre activité psychique, support et système de signes, en insistant sur le fait qu'elles ne fonctionnaient pas à sens unique (de la pensée vers la matière). J'appuyais mon raisonnement en mobilisant des exemples de formes de résistance à des «innovations technologiques» du passé: les très lentes adoptions du codex, de l'index, de la graphie structurée des moines irlandais79 témoignaient du fait que les lettrés pouvaient se montrer rétifs à des améliorations du système de signes ou du support, et dévoilaient des enjeux de pouvoir liés à l'écriture, entre des fins de domination et d'émancipation. Je détaillais ensuite les apports cognitifs des listes, leur contribution à la réflexivité de l'écriture, et la façon dont celle-ci s'autonomisait en s'inscrivant dans une temporalité qui dépassait celle des humains, ce qui pouvait expliquer les difficultés de ces derniers à interpréter ses transformations: «l'écriture, avec ses objets, ses méthodes et ses savoir-faire, tous sans cesse remis en chantier, est une technique dont les fonctions et les régimes nous dépassent parfois {{[Guichard, 2004a], p. 29.}}». Et, pour la première fois, j'évoquais explicitement ses quatre piliers: «supports matériels, systèmes de signes, activités cognitives, et structures sociales» {{[Guichard, 2004a], p. 29.}}. Je précisais donc aux informaticiens la technicité de l'écriture, ainsi que ses dimensions sociale80 et historique -et proposais déjà quelques liens entre écritures lettrée et mathématique. La seconde partie conservait cette forme pédagogique: je montrais que l'ordinateur était avant tout une machine à traiter les listes; avec quelques exemples (codage, graphiques, cartes), je spécifiais comment des modifications de l'écriture et les outils qu'elles induisaient altéraient nos catégories conceptuelles: «Par toutes ces manifestations -transformations des systèmes de signes et des supports, apparition de méthodes associées, évolution des modalités du raisonnement-, l'informatique ne fait pas que prouver son appartenance à l'écriture: elle modifie objectivement cette technique de l'intellect [et donc ...] formate nos méthodes de travail, nos esprits, puis nos manières de penser» {{[Guichard, 2004a], p. 32.}}. Je m'appuyais sur d'autres comparaisons historiques pour conseiller la vigilance face aux «raisonnements qui sollicitent majoritairement le `contemporain' pour en déduire le caractère `émergent', `innovant', voire `révolutionnaire' d'une pratique ou d'une technique» {{[Guichard, 2004a], p. 35.}}. J'y voyais l'expression du déterminisme de l'innovation -et donc une négation de l'histoire: le caractère radical de cette nouveauté excluait toute comparaison avec le passé. Quant à la difficulté d'imaginer des usages savants et variés81, elle me semblait la preuve d'une position déséquilibrée face à la technique82 et je remarquais que ce fait comme le précédent proscrivaient le concept de technique intellectuelle. Mais j'excusais aussi les destinataires de mes critiques, potentiellement pris dans un cadre qui les dépassait: «on doit alors se demander si les laudateurs des `NTIC' ne sont pas, plus que de piètres idéologues, les héraults inconscients d'un fait anthropologique, d'une fascination collective pour la science et la technique, qui seraient alors confondues» {{[Guichard, 2004a], p. 40.}}. Je proposais alors d'étudier cette dimension mythique83 de l'internet, sans négliger la contribution des universitaires: «Une telle analyse doit se compléter par l'étude précise de la façon dont les scientifiques eux-mêmes -acteurs essentiels de la production de représentations sur la science et la rationalité- participent à la réification d'un tel mythe. Le projet n'est pas que de montrer comment des universitaires font, par opportunisme ou par nécessité, commerce de l'innovation, et adaptent leurs compétences aux rêves et `visions' des financeurs de la recherche, mais d'insister sur le processus, qui, là encore, n'est pas nouveau. [... Mais aussi de montrer] comment les conflits de personnes, d'écoles, d'appareils, internes à une discipline donnée ou entre diverses disciplines, peuvent inviter certains de leurs représentant/e/s à intégrer -de façon consciente ou inconsciente- des mythes ou des croyances dans leurs argumentations scientifiques ou, à l'opposé, refuser de critiquer de telles attitudes, au motif que la grandeur de leur discipline les empêche de participer à un débat chargé d'idéologie. Et, par suite, comment les individus, les institutions d'enseignement et de recherche, les agences qui en ont la charge, tous pris en des enjeux de légitimité, interfèrent et élaborent ou s'approprient des discours sur la sience et la culture» {{[Guichard, 2004a], p. 42-43.}}. Enfin, je suggérais de se pencher sur les pratiques des informaticiens: «Pour détailler encore plus le plongement de l'informatique dans la technique de l'intellect, on peut étudier les faits, gestes et manières d'écrire des `expert/e/s' de l'informatique, celles et ceux qui font fonctionner machines et réseaux, qui maîtrisent plusieurs codages, supports, formats d'écriture, et les moyens de passer des uns aux autres. On saisirait alors comment des connaissances souvent complexes sont assimilées et diffusées, comment circulent des représentations -sociales, techniques, politiques» {{[Guichard, 2004a], p. 44.}}. Ce texte contient en germe nombre de mes projets ultérieurs. Il annonce assurément un tournant après la thèse. Pour la première fois, je propose une anthropologie des mondes lettrés d'aujourd'hui et j'aborde explicitement le lien entre idéologie et mythe, entre rationalité et croyance. Mais il a aussi quelques faiblesses. Certaines relèvent du style et renvoient au contexte historique du débat: par exemple, le ton un peu polémique du milieu de la seconde partie s'explique du fait que certains discours de ce début du XXIe siècle transpiraient une idéologie naïve (nouvelles technologies, convergence, société de l'information, etc.) qui s'immisçait dans les publications savantes. Et aujourd'hui encore, je m'étonne du conformisme de la majorité de mes compatriotes quand ils évoquent l'internet84. Mais j'aurais aussi pu m'afficher moins solitaire, par exemple en sollicitant les analyses d'Armand Mattelart85, explicites quant à la force de l'idéologie dans les discours sur les nouvelles technologies. On peut aussi remarquer que je réduisais l'internet à de la pure écriture avec une rapidité qui peut étonner: mais je m'adressais aux chercheurs en informatique, à qui je n'avais nul besoin d'expliquer que l'internet, qu'ils fabriquaient au quotidien avec leurs ordinateurs et qui fonctionnait avec leurs programmes, relevait de l'écriture. Je pense cependant que je n'étais pas assez foucaldien, en partie parce que je manquais de recul vis-à-vis de ma propre position. J'avais des difficultés avec le fait que des experts (en informatique, par exemple) pussent à la fois articuler des savoirs rationnels et des croyances. Deux facteurs sociologiques se conjuguent ici:- Un effet direct de la domination, au sens bourdieusien: il ne m'était pas facile de penser que des personnes parées de toutes les légitimités (docteur issu de l'École Polytechnique, etc.), dont les compétences m'étaient confirmées chaque jour pussent faire coexister un ensemble de savoirs à la cohérence reconnue avec des croyances -et parfois revendiquer la connexion entre ces deux registres. Certes, le recours à l'idéologie permet de contourner en partie ce problème: un intérêt bien compris (par exemple de classe ou de position) inciterait de telles personnes à solliciter des propos qu'elles rejetteraient si elles leur appliquaient la rigueur dont elles font preuve dans leur activité professionnelle. Mais je sentais là une contradiction: il est toujours difficile de concilier l'idéologue, le technocrate, et le brillant chercheur en une seule personne86.
- Ma critique était aussi ambiguë, car à la fois située dans le champ qu'elle analysait et en dehors: entre la positivité d'une pratique que je revendiquais (faire de l'informatique) et la distance du sociologue, tout aussi revendiquée. Comment concilier l'intuition que les informaticiens, parce qu'ils renouvellent l'écriture, ont la double capacité de révéler sa dimension réflexive et de se montrer sensibles à des questions sociologiques (la dimension sociale des réseaux, l'instauration de nouveaux rapports de domination suite à l'avènement de cette écriture) avec la logorrhée dont certains pouvaient faire part collectivement (sur la révolution des usages ou sur l'avenir radieux de la société de consommation)?
- Ce cadre conceptuel permet de comprendre qu'une culture spécialisée, par exemple professionnelle se conjugue avec un ordre du discours. Il s'ensuit que les ingénieurs d'aujourd'hui, comme ceux des siècles passés, ont la possibilité d'avoir des compétences élaborées, des représentations sociales, politiques et des imaginaires, qui se juxtaposent aux premières sans nécessaire cohérence; ou qui leur sont si entrelacés qu'il devient difficile de préciser lesquels infléchissent les autres (cf. les trois dimensions de la culture, ).
- Ensuite, en permettant que les savoirs soient articulés par des croyances ou des inductions lâches, le concept de formation discursive permet de préciser, plus que la science à laquelle ces savoirs sont associés, celles qu'ils risquent de préfigurer: en considérant les savoirs comme «ce dont on peut parler dans une pratique discursive qui se trouve par là spécifiée» [Foucault, 1969], on peut interpréter une partie des discours sur l'internet comme le témoignage de la naissance d'une «internétologie» ou diktyologie [Mathias, 2009]: des règles d'articulation de savoirs qui se cherchent et s'expérimentent. Pour le dire autrement, on réalise alors que ces discours ne relèvent pas que de la science informatique. Ils ne se réduisent ni à une idéologie propre à cette discipline établie ni à des propos du sens commun sur les effets sociaux d'une science. Il s'agit alors de tenter de distinguer ce qui relève d'une science (qui évolue), d'une idéologie, et d'une ou plusieurs sciences qui se cherchent, en voie d'autonomisation88.
- Il s'ensuit un avantage pour l'analyse sociologique, puisqu'on prend alors conscience de sa propre position dans le champ discursif: l'espoir de fonder une nouvelle discipline centrée sur l'internet89 ou sur les réseaux90, la promotion de paradigmes tel celui de territoire de l'internet ou de technologie de l'intellect, expriment tous le projet d'expérimenter, d'élaborer, de diffuser une formation discursive. Alors, tout destinateur de telles constructions intellectuelles se voit aussi comme acteur qui s'inscrit dans un jeu d'alliances et de compétitions. Il comprend qu'il ne peut critiquer les discours d'autrui sans prendre conscience qu'il tente lui aussi d'imposer un type de formation discursive.
2.1.4 Rétrospective
Ainsi, à ma double culture mathématique et anthropologique s'est superposée une expérience, celle de l'écriture, à un moment et en un lieu où sa transformation était objectivement ressentie: à l'ENS, l'informatique «débarquait» en sciences humaines, et posait des questions qui montraient à quel point, et même en un milieu savant, la réflexion sur l'écriture était sous-évaluée, laissant la part belle à des préjugés, à des représentations. Pour le dire autrement, l'informatique rendait visibles nombre de pratiques en relation directe avec la transmission des savoirs érudits et la construction des champs de recherche savants quand, auparavant, ces pratiques ne semblaient pas mériter qu'on s'y attardât, même si leurs dimensions intellectuelles, sociales, techniques n'étaient pas niées. Je me remémore toujours les propos de quelques personnalités, aussi séduites par l'informatique que séduisantes quand elles évoquaient la littérature, tout à fait capables d'expliquer à la fois que la «bibliothèque était leur laboratoire» et que l'art de chercher et de trouver n'étaient que des corollaires du génie. D'après elles, les personnes soucieuses de montrer la part des dispositifs techniques et donc collectifs dans la construction de la pensée n'étaient que des besogneux qui compensaient leurs limites intellectuelles par une mise en valeur de leurs savoirs techniques. Mais plutôt que de frapper les uns d'anathème ou d'offrir des lauriers aux autres, je préfère insister sur cette chance collective que nous avons eue à l'ENS de pouvoir et vouloir92 mettre en doute nos convictions, nos préjugés et de prendre conscience de leurs fragilités. Reste à savoir si cette réflexion au sein de l'Atelier Internet était originale ou importée. La seconde option serait la plus crédible: on a vu qu'à l'ENS l'informatique littéraire est advenue avec l'internet. Le débat français sur l'informatique en réseau rappelle les réflexions américaines sur les potentialités de la chose dans les années 1960, même si elle n'était alors qu'en gestation. Cependant, je ne crois pas que le chantier intellectuel normalien que j'ai évoqué ait copié celui impulsé en Californie trente ans plus tôt. Et plutôt que de forcer des filiations qui supposent un «retard» des idées, je voudrais insister sur des proximités intellectuelles repérables au même moment entre les informaticiens du nouveau monde et les anthropologues de l'ancien. Par exemple, le concept de technologie de l'intellect de Jack Goody me semble très présent dans les propos de Douglas Engelbart93. L'informatique relance les questions sur la technicité de l'écriture et l'internet met en évidence le caractère collectif des opérations de la pensée. En effet, avant l'internet, un cartographe, un lexicomètre94 ne sont que des experts titulaires d'un savoir peu répandu, avec ses outillages, ses méthodes, ses concepts. Les mêmes, pris dans l'univers de l'internet se «voient» écrire, communiquer. Une forme d'échange, intimement liée à leur outil principal, leur permet de faire connaître leurs idées, inventions et travaux, de les soumettre à la critique, d'en obtenir un retour rapide, d'intégrer de façon accélérée ces commentaires et conseils (par exemple en se servant du couper/copier/coller en des programmes informatiques), de voir leurs outils se faire approprier: le social revient en force. Pour le dire autrement: si, avec l'informatique, le système de signes, le support et la psyché apparaissent assez rapidement comme les premiers piliers de cette technique de l'intellect qu'est l'écriture, l'idée qu'un quatrième puisse survenir -le social- était loin d'être acquise pour le profane que j'étais vers 1992 -et ce, malgré ma sensibilité sociologique. Et c'est bien cette quatrième dimension qui a suscité l'intérêt de tant de normaliens, au point d'être à l'origine de l'Atelier Internet, en même temps qu'elle a nourri leur réflexivité: au travers des échanges, la mise en évidence du caractère collectif de l'activité intellectuelle fut la cause de cet intérêt (lui aussi pluriel) pour l'écriture et pour la mise en perspective des pratiques savantes. L'internet pouvait aussi faire tourner la tête: en donnant le goût d'étudier pour lui-même ce social qui s'y agrégeait, que ce soit par le biais des pratiques effectives ou des discours à son sujet; en suscitant l'idée d'inventer des outils, des logiciels qui s'appuyaient sur ses protocoles, tant cette technique démocratisait l'accès à la programmation95; voire, entre 1998 et 2000, en cédant aux sirènes de la bulle spéculative, qui poussaient à l'abandon de la recherche universitaire. Pour éviter de surfer sur ces effets de mode, j'ai forgé une ancre conceptuelle: l'appartenance de l'internet à l'écriture, les quatre constituants de cette dernière, les capacités intellectuelles qu'elle permet, sa réflexivité me donnaient le goût d'une exploration aussi théorique que concrète. Au tournant de ma thèse, je m'efforçais de montrer à mes collègues et étudiants comment un changement matériel, au plus loin de certaines conceptions spiritualistes, pouvait transformer des méthodes, générer des objets de recherche, relancer des préoccupations épistémologiques; par exemple, en montrant les effets cognitifs, puis disciplinaires, d'un travail combinatoire sur des listes. J'insistais aussi sur l'éventail des savoirs mobilisés par une littératie donnée (en l'occurrence électronique) pour montrer comment les savoirs nobles s'articulaient avec les profanes, comment tous se déplaçaient, et produisaient par là des réarrangements fructueux. Je pressentais comment une ethnographie de l'intellect contemporain (à partir d'un bureau électronique96, d'un clavier et de gestes simples) donnait le goût d'une anthropologie qui s'accordât avec toutes les écritures: d'hier et d'aujourd'hui, des plus communes aux plus impensables -par exemple, mathématiques. Concrètement, cela s'est réalisé à partir de deux objets a priori différents -les us de l'internet et la cartographie97 - reliés par un troisième: mon souci de donner un cadre théorique à l'internet. Ces trois «programmes», qui pouvaient sembler hétérogènes les uns aux autres il y a dix ans, ont vu parfois leur progression ralentie par des contraintes professionnelles -la recherche de postes stables s'avérant coûteuse, non seulement pour les individus, mais pour la recherche- et psychologiques -je pensais que des problématiques au voisinage de l'épistémologie devaient être abordées par plus experts que moi. Si la question des usages m'apparaissait problématique (les discours à leur sujet se développaient grandement et avaient plus valeur de vérité que des résultats statistiques méthodiques), la cartographie servait de pivot entre elle et la théorie. La cartographie renvoie essentiellement à une pratique écrite et faiblement articulée à des discours -alors que sa part réflexive m'apparaît manifeste. Pour montrer concrètement l'importance de l'écriture dans nos catégories mentales, nos classifications disciplinaires et nos représentations du monde, il suffit de détailler comment la transformation d'un de ses quatre constituants de base, par exemple son support, infléchit jusqu'à des champs entiers de la recherche. Un texte, une fois sous forme électronique, se déforme, se déploie en autant de listes qu'on le désire. Celles-ci offrent d'autres sens, grâce à la décontextualisation des mots mis en série; et les outils qui les produisent donnent l'idée de les appliquer à d'autres listes. Ces phénomènes sont connus [Goody, 1994]. Les apports de la systématisation et de la récursivité de ces procédés le sont moins. Pourtant ils nourrissent notre quotidien: entre l'algorithme (d'Euclide) et la totale hypertextualité d'outils linguistiques comme le TLFi ou l'atlas sémantique du CNRS98, nous réalisons à quel point des procédures mécaniques poussées à leur limite témoignent des courts-circuits intellectuels que peut apporter une amélioration de l'écriture. Cela nous invite à concevoir l'écriture non plus comme un simple outil, mais comme une somme itérative construite à partir de ses objets élémentaires, des relations entre eux, puis entre ces relations premières, et ainsi de suite99. Une telle approche ne demandait qu'à être appliquée à des corpus de la nouvelle écriture pour vérifier si leur mise en liste, en tableaux, et en carte pouvait produire de nouveaux savoirs. Avec les traces100 des sites web et des échanges électroniques, il était aisé d'étudier des usages, par exemple des normaliens à l'occasion de l'essor du courrier électronique101. Il n'était pas plus difficile de dresser une cartographie des origines nationales du lectorat d'un site web, d'imaginer de nouvelles enquêtes et descriptions du monde. Et le fait de pouvoir aborder très tôt les questions éthiques que soulevaient de telles études102 résultait aussi des effets réflexifs de la technologie de l'intellect. Ainsi ai-je eu une première preuve que les archives électroniques permettaient de répondre à des questions classiques, qui relevaient de la sociologie ou de la géographie, et qu'elles pouvaient aussi les nourrir, les motiver. Il s'est avéré que la littératie requise pour appréhender le support et le système de signes supportait aisément le changement d'échelle. Ce qui donnait l'idée de l'appliquer à des objets écrits de très grande taille: somme des serveurs internet européens103 , ou totalité des requêtes adressées à un moteur de recherche durant trois mois104 . Certes, pour cela, les contacts avec les informaticiens professionnels s'imposaient. Et ces rencontres nourrissaient aussi la réflexion: je pouvais alors comprendre plus finement des enjeux complexes (logiciels libres, miliciens de l'internet, etc.) et m'ouvrir à d'autres champs disciplinaires -par exemple, les systèmes complexes, dont les dynamiques me semblent mériter l'attention des sciences de l'information et de la communication et des sciences sociales. Cette expérience d'écriture en lien étroit avec mon métier d'informaticien littéraire a eu pour moi plus d'importance que ce que ma production intellectuelle donne à penser. En partie du fait qu'elle m'a incité à réaliser des logiciels en ligne, qui sont toujours appréciés (mais après un délai certain, pouvant aller jusqu'à quatre ans). Elle m'aura aussi épanoui, grâce à cette créativité que permet l'écriture et par là, l'informatique. Elle aura peut-être, tout simplement, été ce que j'en attendais: un moteur épistémologique. Et je crois que ces enquêtes et expériences, collectives et solitaires, même si elles restent discrètes, me donnent à voir, pour mes étudiants et collaborateurs futurs, autant de champs de recherches que de méthodes.2.2 Le défrichage d'un terrain
La reconstruction historique court le risque de n'être qu'une narration unifiante de faits hétérogènes que le hasard a mis en contact. Aussi me semble-t-il utile de préciser quelques étapes de ma première expérience de chercheur. En offrant une rétrospective des contraintes, opportunités et désirs qui l'ont sculptée, je compte aussi dévoiler l'«archéologie» d'un terrain. Un terrain n'est pas qu'un lieu que l'on choisit au préalable pour se caler sur le réel. Ce n'est non plus un espace de travail empirique que l'on remet en perspective a posteriori. Pour prolonger la métaphore géographique héritée de l'anthropologie et de la sociologie, un terrain est un «lieu» que l'on fabrique patiemment pour qu'il devienne une référence de sens. Un lieu dans lequel on se plonge, pour se distancier des implicites d'un monde considéré comme allant de soi105, pour mieux en saisir les dynamiques et les structures. Mais aussi pour prendre la mesure d'un écart vis-à-vis de soi: en l'occurrence pour se forcer à s'éloigner des doxa qui gouvernaient le chercheur au moment de l'enquête, de la constitution de son objet. C'est un lieu que l'on choisit pour ses capacités à désorienter. Un terrain est tangible, il sert d'appui, mais il est aussi construit: il est cet espace réflexif et concret qui pose les problèmes. Il excède l'expérience. J'ai déjà montré partiellement à quel point mon terrain est à la fois précis et complexe -preuve de sa mobilité: l'ENS et les usages savants de l'internet106; mais aussi l'écriture informatique (intégrant ma propre pratique), qui déborde la notion d'architexte107 pour devenir un univers souvent difficile d'accès, exotique, alimentant de ce fait la réflexivité.2.2.1 Aux racines des usages de l'internet
Quand je me suis penché pour la première fois sur les usages de l'internet, mon terrain était fort ciblé, principalement pour des raisons d'insertion locale: il concernait un petit milieu de chercheurs et d'étudiants d'une institution élitiste. J'ai déjà rappelé l'intitulé du programme de recherche que j'ai mis sur pied: «Internet et les chercheurs108». J'entendais par là «l'analyse des pratiques sociales {{http://barthes.ens.fr/atelier/articles/guichard-presRI-nov96.html}} liées à la diffusion de l'Internet, en limitant volontairement le `terrain' sociologique au monde de la recherche». Mais cette restriction ne suffisait pas à rendre aisée l'exploration d'un tel thème: les chercheurs de disciplines distinctes ont des pratiques vraiment différentes. Au-delà de la variété de leurs chantiers et de leurs histoires, de l'importance méthodologique donnée aux outils, les normes de collaboration interdisciplinaire, d'écriture et d'évaluation sont elles aussi distinctes et parfois incompatibles. Aussi ce premier travail en compagnie de chercheurs de divers horizons, outre ses résultats concrets comme théoriques, m'aura-t-il offert une triple expérience: celle d'un terrain (à écrire), celle d'une méthode, et celle de valeurs constatées et partagées. Car il m'a appris à:- travailler sur les mondes savants, et donc à me familiariser avec les représentations de chercheurs de disciplines et de sensibilités variées (sur leurs propres mondes comme sur la science);
- développer un savoir-faire qui garantisse concrètement la bonne tenue du dialogue interdisciplinaire, jusqu'à la publication109;
- trouver une méthode qui systématise le succès d'une telle entreprise. Celle que j'ai mise sur pied reproduit les formes de l'imaginaire scientifique qui m'a façonné et dont j'ai pu vérifier l'efficacité110: travailler d'une façon collective et réellement paritaire -avec la conviction que la valeur n'attend ni le nombre des années111 ni celui des titres112- et en étant systématiquement honnête et franc.
2.2.2 Des usages aux territoires de l'internet
Dix-huit mois après la tenue du colloque, j'en publiais les actes123, intitulés «Comprendre les usages de l'Internet» [Guichard, 2001]. L'ouvrage, imprimé à 750 exemplaires, fut épuisé en trois ans, alors que le nombre de librairies qui le proposaient ne devait pas dépasser la dizaine. J'ajoutais deux articles aux contributions des orateurs: l'un, écrit par une étudiante du DEA de sciences sociales, Gwenaëlle Pasco, proposait une étude fine des réseaux peer-to-peer et montrait que les adolescents venaient plus sur Napster pour socialiser que pour télécharger de la musique [Pasco, 2001]; l'autre, écrit par Henri Desbois, avait pour titre: «Les territoires de l'internet: suggestions pour une cybergéographie» [Desbois, 2001]. En choisissant de clore l'ouvrage sur un tel thème, j'espérais signifier les nouvelles orientations que je comptais donner à la recherche, et poser le premier jalon d'une nouvelle discipline: la cybergéographie. On peut considérer que de tels propos sont velléitaires, sinon que de tels marquages symboliques du champ scientifique font perdre plus de temps (au moins à son arpenteur) qu'ils n'en font gagner (à la «communauté» scientifique). Je pense néanmoins que l'édition scientifique est aussi affaire d'affirmations, de prises de position, d'énonciation de choix programmatiques. En présentant cet article comme le point de passage entre le colloque passé et les recherches futures de mon équipe, je signalais qu'après les usages, un second thème scientifique devenait prioritaire: celui des territoires de l'internet. À cette période, les «usages de l'internet» se portaient bien: déclinés de façon appliquée, orientés massivement marketing et nouveaux produits. C'était les années de la bulle spéculative de l'internet. À part quelques évocations de la notion de «surcharge cognitive», peu d'approches étaient en lien avec les notions d'effort ou d'exercice intellectuel. Les colloques sur les usages de l'internet se multipliaient. Cependant, les sociologues ne s'y intéressaient pas et ne contribuaient donc pas à consolider ce champ de recherche. Les «ingénieurs», en revanche, ont témoigné d'une réelle curiosité et d'une indéniable ouverture intellectuelle124. Leur rhétorique générale a néanmoins fini par s'appuyer sur le déterminisme de l'innovation et le consumérisme125. Aussi avais-je l'impression que je pouvais abandonner ce thème, au moins temporairement. Et je pensais, un peu à l'instar de Laurence Lessig, que le code déterminait partiellement les usages [Lessig, 1998,Forest, 2004]. Voire qu'il les révélait: je retournais vers les archives électroniques, pour qu'elles me donnent à voir des usages originaux et des configurations territoriales à leur sujet -fussent-elles métaphoriques. J'espérais aussi vérifier la fiabilité de mes conceptions sur l'écriture: si, comme je le supposais, un frémissement dans ses caractéristiques les plus profondes pouvait ébranler jusqu'à l'ordre conceptuel des humains, les archives électroniques de l'internet devaient révéler presque spontanément de nouveaux champs de recherche, bien au-delà de la simple question des pratiques des utilisateurs et de leur éventuel degré de consumérisme. Grâce à mes collègues informaticiens, j'avais trouvé des bases de données qui permettaient de reconstituer une histoire de l'internet, que je traduisais sous forme de cartes animées, et cette succession d'opérations textuelles et graphiques s'avérait fructueuse à plusieurs titres: les cartes donnaient à voir une réalité sociale et historique. Elles me permettaient aussi de dessiner un territoire de l'internet et généraient des questions intéressantes sur la sémiologie graphique, jusque là cantonnée aux cartes fixes [Bertin, 1967]. Surtout, elles prouvaient une rupture dans l'écriture: elles ne rentraient pas dans un livre. De ce fait, je les considère aussi comme constitutives de mon habilitation, même si les traduire classiquement sur papier n'aurait guère d'intérêt. Le premier «jeu de données» fut issu des archives du RIPE NCC126, qui centralise les noms de domaines nationaux pour les pays de l'Europe et de son grand voisinage. J'avais récolté les statistiques mensuelles du nombre de machines connectées à l'internet et du nombre de noms de domaines. La période couverte allait de 1992 à 2000. Je réalisais alors une série de cartes animées qui «fonctionnent» parfaitement127: on y voit la naissance de l'internet en Europe et dans une zone plus large qui va de l'Afrique équatoriale à la Russie. L'avance de la Scandinavie, le lent démarrage des pays latins, les frémissements du Tiers-Monde, le soudain et tardif attrait des paradis fiscaux (à partir de 1999) se déploient de façon convaincante. Ces cartes me valurent de nombreuses invitations à les commenter et contribuèrent au développement de la problématique sur les territoires de l'internet: au travers d'elles se dessinait une géographie de l'internet. Elles me valurent aussi une commande d'article, sur le thème des «Mesures de la fracture numérique128». J'expliquais que ces chiffres et leurs évolutions montraient la relation directe entre appropriation de l'internet et richesse des nations, et je rappelais la dimension idéologique du déterminisme technique; à ses tenants qui présentaient la fracture numérique comme un départ vers un gai futur, j'opposais les chiffres qui prouvaient qu'elle était une conséquence de la pauvreté. J'écrivais que «ces statistiques témoignent [...] de l'infranchissable frontière entre info-riches et info-pauvres» {{[Guichard, 2003b], p. 45.}} et je raisonnais en termes de retard. Certes, le flux chronologique de l'animation invitait à raisonner en termes d'écart temporel. Mais de tels propos signalent aussi la façon dont un militantisme de l'internet reprend certains des élements des discours qu'il critique (déterminisme de l'innovation, fracture numérique, etc.) parce qu'il fonctionne avec les mêmes ingrédients qu'eux: essentiellement en articulant souci démocratique (partage de la culture et des richesses) avec innovation technique (fut-elle fabriquée par des savants altruistes). En d'autres termes, j'avais effectivement correctement repéré le caractère idéologique des discours sur la fracture numérique, mais comme j'y répondais en termes autant politiques que scientifiques, ma critique s'émoussait: je partageais certaines des catégories intellectuelles de mes adversaires dans ce débat sur la fracture numérique. Nous ne pouvions donc nous opposer que sur des interprétations. Je n'étais pas loin d'aborder la question du lien entre l'idéologie, l'ordre du discours et la narration mythique. Il me fallait auparavant comprendre que l'idée que les réseaux -ou une technique à venir- puissent améliorer le sort de l'humanité n'était pas qu'une émanation des idéologues, et qu'elle pouvait être alimentée par la capacité qu'offre la carte (et les chiffres) à produire une narration du monde. J'en eus la preuve quand je présentais mes animations et mes analyses lors de la Pugwash Conference on Science and World Affairs129 de 2002. Je proposais à mes interlocuteurs de mesurer «objectivement» la fracture numérique130 avec mes cartes et des chiffres -dont je montrais le caractère critiquable- et je les invitais à raisonner en termes de technologie de l'intellect plus qu'en termes de déterminisme technique. Pourtant, il me semblait que ces savants avaient envie de croire que l'internet allait améliorer le sort de l'humanité. Aussi, l'année d'après, je revenais vers eux avec une conférence au titre explicite: «TIC: fausses théories et vraies questions131». Je proposais une critique précise des discours sur les «technologies de l'information et de la communication» (TIC), accompagnée de propositions méthodologiques. Mon résumé d'alors témoigne de mes soucis d'antan:«Il me semble important pour nous, membres de Pugwash, de comprendre le caractère mythique de ces discours [sur les TIC], et, au-delà, pourquoi nous acceptons ces mythes, malgré nos statuts de scientifiques et d'intellectuels. Ceci devrait nous permettre de développer une attitude plus critique quand nous étudions les relations entre science, technique et société: {{http://barthes.enssib.fr/archives/pugwash2003/Halifax-Guichard.fr.html}} il semble que nous restions souvent tributaires d'un positivisme scientifique qui nous amène à accorder une valeur aux techniques; or celles-ci ne sont que le jouet des êtres humains.»On le verra dans la troisième partie, je suis aujourd'hui bien moins radical quant au statut des techniques -hybrides, constamment reconstruites, pervasives au point d'être parfois des «assemblages d'actants profilés pour rendre envisageables et possibles certaines actions collectives» [Callon, 2006], jusqu'à des actrices «d'une histoire qui raconte une société, un imaginaire, une cosmogonie» [Faucheux, 2008]. Mes propos de 2003 témoignent aussi de mon doute d'alors, où, un pied dans l'idéologie que je critiquais, je m'étonnais qu'elle atteignît des savants supposés s'y opposer, par intelligence ou par choix politique. Je me heurtais en fait à la consistance de l'ordre du discours quant à la science et à la technique: les positions de mes interlocuteurs (pacifistes, souvent physiciens, parfois conseillers de gouvernements) donnaient à penser que leurs propos n'étaient ni réductibles à une idéologie (qu'ils subiraient ou qu'ils diffuseraient, par exemple pour défendre leurs intérêts de scientifiques) ni à un mythe techniciste. J'avais une perception intuitive de ce fait et je sais aujourd'hui que se fabrique autour de tels processus discursifs une réelle culture. Celle-ci n'est pas réductible à une simple doxa au service des dominants, et elle donne à penser que des phénomènes analogues se sont déjà produits par le passé (cf. le point 2 sur la culture ). Certains de mes interlocuteurs, tel Bas de Gaay Fortman de Pugwash Hollande, m'invitèrent à préciser ma pensée sur la fracture numérique, d'abord en un colloque, ensuite en ses actes. Ce fut l'occasion d'écrire «Does the `Digital Divide' Exist?132» [Guichard, 2003a]. Cet article et sa version française, que j'ai publiée en ligne en même temps que sortait l'ouvrage (en langue anglaise, et aux Pays-Bas), ont connu un franc succès. Longtemps première réponse proposée par Google quand on saisissait la requête fracture numérique, il était, six ans après sa publication, bon second, juste derrière Wikipédia (qui le cite effectivement en première référence). Ainsi suis-je devenu, presque malgré moi, et en partie grâce à des physiciens pacifistes, le spécialiste de la fracture numérique. Cet article est lui aussi critiquable, quand il substitue à la notion de fracture numérique celle de fracture cognitive (je parlais alors de capital culturel et pas encore de littératie). Il a toutefois le mérite de ne pas laisser croire que celle-ci va être dissipée par le développement des réseaux ou l'achat d'ordinateurs. Il détaille l'incohérence des chiffres à l'origine de la prétendue fracture numérique et montre la puissance narrative des indicateurs. Il explicite les mensonges des principaux tenants des discours sur la fracture (qui prétendaient que le téléphone portable allait émanciper les femmes du Bangladesh). Bien entendu, il insiste sur les vertus méthodologiques des approches de David Edgerton et de Jack Goody. Surtout -et je crois avoir été le premier à dire les choses ainsi- il déduit le caractère idéologique de la notion de fracture numérique du fait qu'elle est uniformément partagée: «Les politiciens de tous les bords s'en emparent, la Banque Mondiale et le G8 prétendent la résorber, les militants s'en inquiètent. {{ [Guichard, 2003a]; p. 69.}} Déjà, le fait qu'une telle notion fasse l'objet d'un consensus aussi large, au sein de groupes sociaux qui s'opposent les uns aux autres, donne à penser qu'elle est scientifiquement fragile.» Je pensais avoir clos cette question. J'y reviendrai six ans plus tard, avec une approche plus critique [Guichard, 2010], et avec l'assurance que de tels discours -incluant celui sur la fracture numérique- sont d'authentiques objets de recherche133.
2.2.3 Pousser l'écriture à ses limites
Ce premier travail sur les archives et les flux, et les compétences qu'il m'invitait à développer favorisèrent la rencontre avec des physiciens comme Jean-Pierre Nadal et Marc Barthélémy. Ce dernier et moi-même nous impliquions dans un travail de longue haleine -il aura passé trois mois dans un bureau adjacent au mien. J'avais alors obtenu des données à la fois détaillées et massives de Renater (l'institution qui prend en charge le réseau internet des universitaires français) et nous tentions d'en déduire des indicateurs géographiques, sociaux et structurels. Cette collaboration me permit d'acquérir une culture statistique propre aux réseaux et aux graphes et de voir comment le graphique s'intégrait dans le raisonnement des physiciens: l'usage du logiciel Xmgr134 me permit de développer la notion de preuve graphique -notion que j'abordais dans ma thèse et développerai dans plusieurs articles, à partir de 2004. Les gestes de Marc Barthélémy me confortaient dans l'intuition qu'une ethnographie des pratiques des informaticiens et des physiciens nous aidait à comprendre en détail comment l'écriture électronique transformait nos capacités mentales, et même temps, me faisaient saisir combien cette écriture était produite par des humains. D'une certaine façon, ce terrain a repoussé les limites de ma théorie. En effet, ces fabrications de listes à partir de flots de textes, leurs mises en forme graphique pour tenter d'y voir des structures, le sur-usage de logiciels (écrits) pour comprendre l'écrit produisaient non seulement des savoirs nouveaux, mais aussi des légitimités savantes: deux articles sont issus de cette collaboration. Ils furent publiés en des revues scientifiques réputées: Physical Review E et Physica A [Barthélemy et al., 2002,Barthélemy et al., 2003]. Le second article -reproduit dans le recueil de mes travaux- catégorise les plaques régionales de Renater à partir des flux agrégés de ses deux millions d'utilisateurs135. Nous y montrions136 la présence d'un réseau structurant de l'internet français académique, qui concentre la majorité du trafic (environ sept villes dans le quadrilatère Paris - Strasbourg - Nice - Montpellier) et les effets intellectuels de la littératie électronique: plus les chercheurs consultaient l'internet professionnel137, plus ils écrivaient d'articles. La démarche, audacieuse, était argumentée et s'appuyait sur un fait connu: les grands lecteurs des bibliothèques viennent y lire pour écrire. Cet article de physique abordait l'ensemble des dimensions de l'écriture que je voulais préciser: de la fabrication de listes à l'évocation de leurs effets sociaux et réflexifs138 en passant par la production de cartes (deux d'entre elles étaient publiées). Cette expérience fut déterminante: elle me renvoyait aux mondes lettrés d'aujourd'hui (qui sait écrire? que signifie écrire?) et me rappelait que l'internet était aussi un produit de l'outillage mental que ces mondes ont développé pour leurs besoins propres. Elle me confirmait les continuités (matérielle et cognitive) entre texte, graphique et carte. Elle deviendra le pivot de ma réflexion sur la cartographie, les mondes lettrés et l'écriture scientifique139. Ce «passage à la limite» de l'écriture contemporaine et de son traitement put se concilier avec une mesure approfondie des pratiques intellectuelles sur l'internet quand j'étudiais les requêtes adressées au moteur de recherche Voila.fr140. À partir d'une enquête massive (62 millions de requêtes sur trois mois), «réduite» ensuite aux interrogations qu'ont posées au moteur de recherche durant une semaine 641 000 personnes «réelles» (et non pas sessions ni robots), je montrais que 87% d'entre elles ne savaient pas s'en servir141. La très grande majorité des internautes étaient donc en état de fort déficit littératien face à l'écriture électronique. J'avoue que la faible réception de ces travaux -diffusés à partir de 2002- m'avait un peu déçu: mes résultats n'ont suscité d'engouement ni chez les journalistes ni chez les chercheurs. Mais ce dépit était aussi lié au désir d'obtenir une reconnaissance rapide alors que j'étais en situation de fragilité professionnelle. A posteriori, je fais une analyse moins alarmiste du silence qui a entouré ces résultats: il était logique qu'ils fissent peu débat au moment où l'appropriation massive de l'internet par les populations était présentée comme le passeport universel vers la société de l'abondance. Ce silence relatif renforce par défaut l'efficacité du concept de technologie de l'intellect: comment une transformation dans l'écriture induit de nouveaux objets d'étude et de nouvelles méthodes, au point qu'on ne saura pas dans quelle discipline, dans quelle catégorie de savoir-faire les intégrer. Ici, mon propos, partagé par de nombreuses personnes qui ont essayé de comprendre l'internet d'alors, n'est pas celui d'un fidèle au culte de l'innovation qui se démasquerait enfin: l'accueil que m'ont fait l'informatique (à l'INRIA) puis les sciences de l'information et de la communication, discipline récente née à peu près au moment où l'écriture électronique s'imposait, donne à penser qu'il y a effectivement des objets modernes que des disciplines plus anciennes ne savent pas aborder. La question ne s'évacue pas d'un mouvement de la main: au-delà des exemples donnés par Pierre Bourdieu [Bourdieu, 1984] -relations de domination entre la philosophie, l'anthropologie, la géographie...-, celui de l'électronique, qui s'émancipe difficilement en France entre la fin de la guerre et les années 1960 de la mécanique -discipline reine dans «le milieu `polytechnique', `ponts' et `mines'»142-, celui de la sociologie dans les années 1950, et enfin le «A» de l'INRIA (pour «automatique») rappellent que les disciplines ne sont pas des colonnes inamovibles à distance respectueuse les unes des autres. Aujourd'hui, les études sur les traces électroniques sont en plein essor. Ce n'était pas le cas entre 2000 et 2002, et je subissais certainement aussi une forme de défiance qui vise les pionniers: j'étais certes en France un des premiers à travailler sur de telles «archives» et à proposer une méthode fiable pour identifier des utilisateurs derrière les «hits» des sessions des humains et des robots. J'avais élaboré plusieurs méthodes d'agrégation et de comparaison lexicométriques qui permettaient de retrouver de réelles pratiques et préoccupations derrière le nuage de fumée des requêtes statistiquement majoritaires. Pour autant, les soucis des disciplines d'alors, entre une sociologie qui, parfois à juste titre, se montrait dubitative quant au statut et à la représentativité de telles traces et un marketing qui voulait des chiffres éloquents sans trop s'embarrasser de précautions méthodologiques ou éthiques, la voie était étroite. Cependant, j'ai pu présenter mes résultats lors de divers colloques143. Les économistes signalaient leur intérêt pour ma démarche en intégrant les notions de capital culturel et social de l'internaute dans leur mesure de la «fracture numérique» [Le Guel et al., 2004]. Et l'INRIA m'aida à prolonger ce débat au carrefour des sciences humaines et de l'informatique, quand j'exprimais le désir d'étudier tous les usages de l'internet à la fois. Cette institution144 m'encouragea à mettre sur pied le colloque «Mesures de l'internet» (Nice, 2003). Cependant, et pour faire retour au dialogue avec des lettrés contemporains, je n'aurais pu avoir un tel projet si des physiciens, des informaticiens et des mathématiciens tels que Patrice Abry, Matthieu Latapy et François Baccelli ne m'avaient fait comprendre l'importance de la métrologie de l'internet. À cette époque, je ne désespérais pas de raccorder la statistique des paquets de l'internet aux pratiques de leurs émetteurs et destinataires: j'avais l'idée que les flux de l'internet avaient des distributions statistiques en loi de puissance parce qu'ils étaient le fruit de pratiques intellectuelles145. Ce colloque fut aussi l'occasion d'un réel échange entre métrologues et spécialistes des sciences humaines: linguistes, économistes, documentalistes et bibliothécaires attachés aux pratiques cognitives, géographes, à qui je réservais une belle part -afin que soit actée la naissance de la cybergéographie française. Les meilleures interventions de ce colloque ont été réunies dans l'ouvrage Mesures de l'internet [Guichard, 2004b].2.3 Sociologies
2.3.1 Universalisme et déplacements méthodologiques
La référence à la dimension intellectuelle des usages de l'internet facilite la critique des discours à leur sujet. Je détaillerai dans ma troisième partie comment ils se réduisent souvent à des «projections d'usages» et combien ils négligent la notion de littératie, ce savoir-faire étendu hérité de l'écriture imprimée, transformé par l'écriture électronique et qui désarçonne aujourd'hui nombre de spécialistes et de profanes, au moins dans le domaine de la recherche documentaire. Celle-ci nous résiste, du fait des compétences qu'elle sollicite (et qu'elle accroît en retour), de nos efforts d'adaptation aux algorithmes des machines que nous sollicitons [Mathias, 2009], de la surcharge cognitive. Ce fait, abondamment exploré par les participants à l'Atelier Internet dès 1996, reste actuel: bien des experts de l'internet, théoriciens, hackers ou documentalistes146, en font quotidiennement l'expérience. En imaginant que le grand public aura du mal à esquiver les difficultés que les spécialistes de la littératie contemporaine rencontrent quand ils cherchent des informations en ligne, je n'exprime pas un doute sur les aptitudes de l'internaute «moyen». Je pose la question des limites de l'universalisme de nos approches, un peu comme Jack Goody le fait quand il refuse le «grand partage» entre sociétés dites primitives et dites évoluées: je pense que beaucoup d'analystes des usages qui combinent propos altruistes (ingrédients nécessaires au mythe techniciste) et grand partage (implicite) entre experts et profanes sont dans la contradiction. Pourquoi l'apprentissage par coeur de l'équivalent d'un texte de quelques milliers de lignes, qui relève déjà de l'exploit quand son récitant s'aide d'un support textuel, serait-il à la portée du premier venu dans les sociétés orales? L'idée qu'une «mentalité primitive» offre à ceux qui la partageraient une compétence cognitive (la mémoire) que perdraient les membres des sociétés modernes peut être étayée, mais d'une façon très partielle147, sauf à solliciter des arguments qui expriment une différence essentielle et permanente entre un «eux» et un «nous». Ainsi Jack Goody s'appuie-t-il sur le constat d'un Bagré à plusieurs variantes chez les LoDagaa du Nord-Ghana pour expliquer qu'ils ont les mêmes capacités et difficultés cognitives que nous. La différence réside dans la présence ou l'absence d'une technique (l'écriture) et dans l'ensemble des savoir-faire développés, accumulés pour en tirer parti: la littératie. Cette question de la littératie électronique s'impose quand nous lisons -en 2006- que «91% des internautes savent utiliser un moteur de recherche». Cette phrase n'est pas tirée d'un blog farfelu: c'est la conclusion de l'Insee148, après une enquête massive auprès de 5 600 personnes fin 2005. Comment assumer l'évidence que les moteurs de recherche nous résistent et l'idée qu'ils soient d'un usage facile pour le grand public? Sauf à supposer que ce dernier se satisferait de régimes d'information que nous savons de qualité médiocre, sauf à projeter sur autrui des usages que nous ne connaissons pas. La question ne s'élude pas en jouant sur la variété des distributions des compétences des internautes -où chacun d'entre nous serait autant expert en un domaine qu'il serait l'archétype de l'inculture en d'autres. Elle ne se résoud pas plus en minimisant l'aspect intellectuel de nos pratiques scribales, comme le faisaient les ingénieurs du RNRT, qui considéraient que la maîtrise de l'internet ne relevait pas de la compétence de l'utilisateur final, mais de la leur: à eux de simplifier le mode d'emploi des machines à communiquer afin qu'elles soient d'un usage aussi simple qu'une machine à laver. Elle est de savoir si nous sommes prêts ou non à imaginer que n'importe quel internaute puisse être comme «nous» ou s'il restera toujours une sorte de «bon sauvage». Elle est politique et scientifique. D'une part, car de nombreux discours politiques s'avèrent rapidement racistes dans leurs allusions: le «prenons ensemble le train du futur» suivi d'un «avant que les Chinois ou les Indiens ne le fassent» exprime assez clairement le fait que l'enjeu n'est pas celui d'une société heureuse mais celui du maintien ou de l'inversion des actuelles relations de domination entre les nations, et, par extension entre les classes sociales (l'étude de ces implicites ségrégatifs, mériterait une étude approfondie). Elle est aussi scientifique car le passage à limite des argumentations, quand est abordé l'internet -inclura-t-on le monde entier, d'une façon qui n'oublie personne?-, peut s'avérer une bonne façon de vérifier si un analyste qui se prétend humaniste est vraiment rigoureux: ou il souscrit à l'idée d'une information neutre, accessible, indolore, ou il suppose que les pratiques des internautes sont en partie déterminées par la maîtrise de l'écriture électronique, par un savoir qui s'acquiert. Le concept de technique intellectuelle offre, une fois de plus, une réponse à cette question de la compétence: si une évolution de l'écriture se traduit souvent par une augmentation de nos capacités intellectuelles, celles-ci restent potentielles. Elles valent certes pour l'humanité tout entière, mais ne sont pas disponibles instantanément pour tous les individus: il leur faut une pratique (technique) qui puisse se traduire en savoir-faire. En effet, à une simplification (du système de signes, de la lecture, de l'interprétation, etc.) s'oppose un déplacement des méthodes associées à l'écriture, qui, parce qu'elles sont nouvelles, requièrent un réel effort d'apprentissage et de transmission. Le phénomène est connu: l'histoire de l'écriture repose sur de telles simplifications (l'adoption des chiffres indo-arabes, la normalisation des alphabets occidentaux, etc.) qui augmentent nos capacités intellectuelles et engendrent des méthodes qui, au moins à l'occasion de leur émergence, apparaissent complexes (l'apparition de l'index au Xe siècle, l'algèbre de Descartes, etc.). Mais cette dynamique structurante et désarçonnante me semble peu comprise149.2.3.2 Auto-analyse en vue de généralisation
La période 2002-2006 m'apparaît aujourd'hui comme un moment charnière: mes postes, mes publications, mes centres d'intérêt et leurs échos, tout en témoigne. Ce regard rétrospectif lisse peut-être trop un parcours constitué de préoccupations et de recherches parfois divergentes et d'explorations passées qui, au tournant du XXIe siècle, pouvaient encore déterminer des orientations professionnelles futures. Par exemple, l'histoire sociale: je m'y suis beaucoup impliqué en compagnie de collègues et d'étudiants (cf. point 2.1.2 ); elle m'a permis de penser l'écriture cartographique et ses apports heuristiques150 et n'était pas loin de conditionner mon avenir. Un tel itinéraire donne aussi l'idée que la singularité de mon parcours intellectuel puisse être interprétée. Elle témoigne certes de l'obligation pour les jeunes chercheurs de multiplier les compétences, de maximiser les opportunités dans un contexte de raréfaction des postes dans la fonction publique française151. Elle peut aussi être confrontée à l'originalité d'autres parcours de chercheurs, avec l'idée paradoxale mais à mon avis fructueuse que ces singularités fassent paradigme. Pour le dire plus simplement: l'hétérogénéité de tels parcours en sciences de l'information et de la communication est-elle la norme (par exemple au regard de ceux des historiens)? Et si oui, peut-on l'expliquer, voire la théoriser? Cette hypothèse en suggère une autre -assurément admise mais rarement évoquée: qu'une discipline soit aussi marquée par ses outils et ses terrains, et que l'essor des sciences de l'information et de la communication soit lié à cette transition de l'écriture en son sens le plus large -technique de communication- qui se traduit aujourd'hui par la cohabitation de deux littératies. On peut alors imaginer que diverses personnes soient venues aux sciences de l'information et de la communication parce qu'elles disposaient d'une curiosité originale, stimulée par une expérience extra-universitaire, pluri-disciplinaire ou contrariée par les normes académiques: parce qu'elles étaient intéressées par cette situation de coexistence de deux régimes d'outils intellectuels (pour les savants ou pour le grand public, dans leurs effets directs comme lointains) ou parce que leurs objets et leurs méthodes (leurs outils) n'étaient pas ceux de coeurs de métiers éprouvés par une tradition de savoir-faire universitaire152. Ainsi, une curiosité commune pour des objets153 qui n'avaient pas encore de légitimité savante serait un point commun à ces chercheurs. Une telle situation n'est pas nouvelle, si on se remémore l'essor institutionnel de la sociologie [Duclert et Rasmussen, 2002]. On pourrait prolonger ce travail en une socio-histoire des sciences de l'information et de la communication, ce qui permettrait à cette jeune discipline de renouer avec ses origines et parrains cybernéticiens, linguistes et anthropologues -pour n'en citer qu'une poignée. À se pencher sur sa genèse, elle gagnerait, je crois, en visibilité comme en réflexivité. Une telle recherche expliciterait les influences concrètes de l'écriture sur nos objets intellectuels par le biais de l'histoire et de la sociologie de ses membres. Elle risquerait certes de se réduire à une juxtaposition de concepts, éventuellement historicisée, dans le but de rehausser la discipline, de l'aider à revendiquer le droit à la pensée pure. À l'inverse, une étude attentive des enjeux des développements de l'outillage mental pourrait aussi montrer que ce n'est pas seulement l'essor de la discipline qui s'articule avec l'informatisation de l'écriture, mais les positions relatives de toutes les autres face à des savoirs de plus en plus privatisés -au moins depuis trois ou quatre décennies [Pestre, 2005]-, peut-être du fait de cette transformation de l'écriture. Ainsi, les sciences de l'information et de la communication pourraient tirer parti de leur histoire, de leur expérience liée à un rapport spécifique à une écriture en transition pour aider l'ensemble des sciences humaines à repenser leur évolution récente. Le fait de ne pas prendre l'informatique comme simple objet154, mais de penser l'essor conjoint des sciences de l'information et de la communication et de l'informatique permettrait, par esprit comparatiste, d'historiciser la place de la technologie de l'intellect dans nos pratiques savantes. On sait que son histoire et ses effets sont clairement perçus, en grande partie grâce à Jack Goody, qui est anthropologue [Souchier, 2004]. Mais si l'écriture relève de la communication, pourquoi s'enthousiasmer pour tant de formes contemporaines de cette dernière? Armand Mattelart nous incite à oser l'histoire, au moins pour imaginer autrement un monde communicationnel et «machinique», désormais «amnésique», sur lequel «spéculent démagogues et démiurges» [Mattelart, 1997]. Michel Faucheux affirme que «les SIC155, si elles s'intéressent, par exemple, au téléphone portable, devraient aussi étudier l'usage des bifaces, des choppers, des grattoirs utilisés pendant la Préhistoire» [Faucheux, 2008]. On gardera en mémoire le fait qu'en sus de Marcel Mauss, il convoque les archéologues. Effectivement, les techniques se transmettent, et pour cela, exigent un processus de communication. Il semble utile de préciser cette dernière, dans ses dimensions les plus massives comme dans les plus intimes, et de ne pas la réduire à une évidence (Pascal Robert promeut le concept d'«incommunication» [Robert, 2009]): sommes-nous, avec le développement de l'informatique et de l'internet, face à des structures exclusivement éditoriales ou médiatiques, ou pouvons-nous déceler des processus, qui témoignent certes d'impositions, de rapports de pouvoir en lien étroit avec l'écriture et son histoire, mais aussi d'un «jeu156» des acteurs? Un jeu non seulement sociologique, mais aussi intellectuel: si technique de l'intellect il y a, nous devons imaginer qu'il y a aussi exercice intellectuel. Il convient alors de relier ce qui est fait et ce qui peut être fait de l'écriture avec notre propre expérience de l'écriture, heurs et malheurs inclus157. Et cela nourrit la recherche: Des chercheurs comme Dominique Cotte s'inquiètent de la lente appropriation par les sciences de l'information et de la communication d'objets d'études qu'ils rencontrent pourtant au quotidien, comme les «systèmes d'information», désormais présents dans toutes les universités [Cotte, 2009]. Pourtant, remarque-t-il, elles possèdent, plus que d'autres disciplines, les clés pour analyser ces systèmes. On le comprend: quelles que soient nos positions personnelles quant aux relations entre les savants, leurs outillages mentaux, leurs laboratoires, leurs réseaux, et ce qu'ils produisent, l'informatique en réseau change ces relations, et au-delà, certaines des modalités concrètes du fonctionnement de la science. Et plusieurs d'entre nous sont ou ont été des acteurs concrets de ces changements158. Cela invite à changer notre perspective collective quant à la technique. Yves Chevalier rappelle l'époque d'un «éclectisme de bon aloi» [Chevalier, 2004], qui l'amène à citer Daniel Bougnoux: «Il faut donc que notre communication demeure cette chose turbulente et vague, de laquelle il n'y a ni science ni technique, mais qui surplombe ou cadre la plupart de celles-ci. On n'abordera pas ce domaine sans être un peu sorcier, ou artiste» [Bougnoux, 1998]. De tels propos semblent aujourd'hui révolus. Mais comment comprendre le fait que les sciences de l'information et de la communication tendent à un maximum de scientificité, avec leurs concepts, leur érudition, leurs terrains, et négliger la part de la technique dans ce qui organise et oriente nos pratiques savantes? Si, comme le dit Francis Chateauraynaud, il importe de «retourner le cadre informatique contre lui-même» (je pourrais dire: le dévoiler, en montrer les structures, les limites comme les idéologies), il ajoute aussitôt: «à condition de le prendre au sérieux, y compris dans ses aspects les plus techniques» [Chateauraynaud, 2003]. Voilà qui milite pour une étude des pratiques les plus fines de l'écriture informatique, programmation incluse. Ce travail sera rendu aisé grâce à cette socio-histoire de la discipline: elle montrera que nos propres compétences en informatique sont tout sauf négligeables159. Cela permettrait certes d'approfondir la relation entre science, technique et idéologie (qu'explicite Armand Mattelart en évoquant le gradient découvertes scientifiques --> métaphores mécanistes puis organiques --> communication) et permettrait tout autant de préciser les seuils entre ces trois termes: je prends autant au sérieux Michel Foucault que Claude Shannon, même si le premier a été utilisé par les idéologues de l'«entreprise post-moderne» [Mattelart, 1997] et le second par ceux du «libéralisme épistémologique et communicationnel» [Chevalier, 2004]. Et je me demande si, en esquivant des catégories de savoir et des expériences qui nous sont accessibles de par nos connaissances et nos curiosités collectives, nous ne laissons pas une belle place aux idéologues que nous critiquons: ils peuvent alors réduire la complexité du monde et de l'exercice intellectuel dans les termes qui leur conviennent. Qui d'entre nous n'a pas conscience qu'à défaut de préciser en finesse la succession des articulations entre une découverte scientifique et sa métaphorisation collective, un réel gap [Searle, 1998] les sépare? N'en est-il pas de même entre une expérience intellectuelle liée à l'usage intensif de notre outillage mental (de la technique) et les formations discursives qui se focalisent sur les plus visibles de ses instruments? Cette socio-histoire de nos compétences et de la façon dont elles ont construit la discipline offrirait aussi le moyen de reprendre la main sur le «social», à la fois popularisé et honni par Bruno Latour. Le succès de ce dernier est indéniable et on peut le mesurer aisément au nombre des critiques qu'on lui fait. On peut détester son style, ses phrases à l'emporte-pièce et ses propos méprisants160 ou son approche sociologique qui «dénie aux normes toute pertinence explicative» [Babou, 2008]. On peut aussi faire le même constat que Gérard Noiriel: un excellent sociologue à ses débuts, qui a ensuite ressenti le besoin de parler le langage du généraliste et qui se prend alors à son propre piège:161 «lorsque Latour aborde son propre monde, sa propre sphère d'action, les acteurs et leurs principes disparaissent comme par magie. En lieu et place, nous avons un récit qui met en scène des personnages collectif: le Philosophe-Savant, le Sociologue, etc.» ([Noiriel, 2005], p. 246). Effectivement, Bruno Latour a énoncé de nombreux paradigmes fort utiles pour comprendre plus finement l'histoire et la sociologie des sciences, il a rompu avec le spécisme, en proposant d'intégrer les non-humains162 (les actants) dans la sociologie. Ce qui est, au moins heuristiquement, une bonne idée. Et il n'est pas exagéré de penser que certaines des limites actuelles des sciences sociales proviennent de leurs difficultés à concilier les humains avec la panoplie d'objets qu'ils ont fabriqués et qui aujourd'hui s'hybrident avec leurs corps et leurs actes. Et leur focalisation excessive sur les humains et leurs symboles serait la conséquence de cadres hérités de notre histoire culturelle, qui refoule la technique [Simondon, 1989]. En cela, les sciences de l'information et de la communication, même si elles sont les premières concernées par ce métissage entre acteurs et actants163 n'auraient aucune raison d'être exemptes des travers des disciplines qui leur sont cousines. Elles pourraient déjà, grâce à leur histoire et leur sociologie, s'assumer comme le «cheval de Troie qui permet de réintégrer la technique dans le périmètre de la science» [Faucheux, 2008] et l'idéal serait que cette démarche commence par une introspection; celle de leur propre rapport à l'écriture informatique, dans toutes ses dimensions: probatoires, inventives, performatives, imaginaires. Et quand Bruno Latour affirme que «les outils [...] modifient toujours les objectifs que [nous avons] à l'esprit» [Latour, 2006], il énonce une vérité à laquelle je souscris quand je propose de prendre au sérieux la façon dont ces outils modifient ce que nous avons en tête164. Cependant, s'il a fait école -notamment avec la sociologie de l'acteur réseau [Callon, 2006] (SAR ou ANT: actor network theory), son projet de faire système a échoué à mes yeux: que le gendarme couché ait des effets sociaux, nul n'en doute; de même, personne ne nie la réalité des réseaux ni la variété plastique des interactions multiples entre acteurs (même s'il les fige, les paralyse dès que sont évoquées les disciplines). Mais si ces regards peuvent éclairer les tensions entre Renault et EDF, voire un certain état collectif de la science, ils n'expliquent ni le raisonnement d'un Galilée ni celui d'un Galois. De même pour l'émergence de l'idée de progression géométrique: François Viète avait-il à sa disposition des actants qui manquaient aux Grecs165? Cette question mérite d'être approfondie: ce concept aidera John Napier, et de façon parallèle, Grégoire de Saint-Vincent à développer la notion de logarithme. Ce dernier mathématicien fut déterminant: il a démontré le paradoxe de Zénon et imaginé l'exponentielle. Or, sans passage à la limite et sans exponentielle, pas de fluxion, pas d'électricité, pas de trains [Caron, 1998] ni de téléphone portable, et pas plus d'internet. On en déduit que la notion d'actant doit alors intégrer les concepts et les symboles. Et donc les formations discursives, les normes et la culture. On redevient sociologue. Il me semble assurément profitable de faire une anthropologie des sciences, d'articuler toute science sociale avec sa propre histoire; mais sans pour autant éluder l'aspect intellectuel de sa dynamique. En cela, la prise en compte des quatre paramètres constitutifs de l'écriture que je propose à la suite de Christian Jacob m'apparaît aussi comme un garde-fou méthodologique: un des quatre est effectivement la psyché. Et autant je considère les arguments de Bruno Latour salutaires quand il s'attaque aux spiritualistes166, autant je pense qu'il se focalise de façon non pas excessive mais erronnée sur les objets matériels et sur leurs relations avec les humains. On pourrait dire que la théorie de Bruno Latour est devenue l'actant qu'il refuse de prendre en compte: il voit la vie en réseau, c'est-à-dire au filtre d'une grille, d'un tamis dont il n'étudie que le résidu. Tout ce qui passe au travers devient invisible. Il perdrait la notion de continuité167 car il serait dépendant du diamètre des mailles de sa claie: il raisonnerait alors comme si l'actant essentiel à sa théorie (le diamètre) n'avait pas d'effet. Aurait-il en cela un travers naturaliste d'ingénieur? On peut le penser, et lui appliquer une méthode qu'il n'estime guère: une sociologie de son univers. Le succès intellectuel des personnes passées par le Centre de Sociologie de l'Innovation de l'École des Mines de Paris pourrait alors être estimé à l'aune de trois paramètres: la qualité de leurs idées, leurs parcours (la plupart sont ingénieurs des Mines) et l'habitus de leur auditoire. Ce dernier est aussi constitué d'ingénieurs (en France: X, Mines, etc.) qui désirent légitimement comprendre le réel et leurs actes. Ils en ont de plus les moyens car ce sont des personnes qui disposent de la littératie contemporaine168 et donc d'un pouvoir: technique, industriel, et souvent politique et scientifique. Une telle enquête sociologique, à mes yeux instructive, éviterait l'écueil du procès à charge. Elle pourrait se généraliser in fine aux sciences de l'information et de la communication et à leur public, ce qui permettrait d'en préciser les attentes intellectuelles: tout comme l'originalité des parcours des acteurs des sciences de l'information et de la communication, celle de leurs lecteurs et de ceux de la SAR signale certainement nombre de champs de recherche en émergence. Cette notion de continuité me semble essentielle. Certes, il y a des faits, des actes, des constructions. Et je montrerai dans ma troisième partie leur importance, avec les exemples de la cartographie et des mondes lettrés. Toutefois, l'insistance sur les plus industriels de nos objets ne peut donner l'illusion que tout est construction, que tout est artificiel. On connait la fécondité des débats anthropologiques sur l'opposition entre nature et culture et ils pourraient bien nous aider à préciser ce que nous entendons derrière le mot artificiel169. Il en est de même pour la notion de construction sociale de la réalité, dont Gilles Gauthier rappelle que, si elle est à distinguer de la construction de la réalité sociale chère à Searle, «elle donne lieu en philosophie à un débat extrêmement riche» [Gauthier, 2004] en même temps qu'elle «devient une vulgate tellement prégnante dans les sciences de l'information et de la communication qu'on la tient pour acquise». Pour Pierre Bourdieu, Bruno Latour est l'archétype du constructiviste radical, et il lui reproche un brusque changement de stratégie: parce qu'il s'est «fait accuser [...] de faire de la désinformation et d'utiliser des stratégies scientifiquement déloyales, [...] il s'est fait tout récemment le défenseur du réalisme et en particulier des objets manufacturés» [Bourdieu, 2001b]. Il me semble qu'en passant des objets techniques à la technique, en interrogeant l'objectivité de cette dernière au travers de nos faits et gestes les plus intellectuels (donc, les plus sociaux, comme je l'ai montré), on conserve la démarche continuiste que je proposais, et on ne perd alors rien de la relation entre la science et sa production, ni de la multitude de déplacements entre notre activité psychique, les outils qui nous permettent de la réaliser (et qui l'infléchissent), et ses résultats visibles. En l'occurrence, une histoire des sciences et des disciplines qui intègre les logiques politiques, les formations discursives, les controverses, mais aussi l'écriture, l'effort et l'intelligence. C'est en cela que l'étude de l'hétérogénéité des sciences de l'information et de la communication que je propose peut nourrir l'histoire sociale de la discipline, conduire à l'étude de la diversité des «objets» (matériels comme immatériels, tangibles comme conceptuels) qui en ont sculpté le destin puis, par dynamique réflexive, aider à comprendre comment les sciences et leurs écritures se font ensemble. Dans ce développement, on aura remarqué les références aux disciplines (comprises ici comme des démarches intellectuelles) suivantes: l'histoire, l'archéologie, l'anthropologie, la sociologie, la philosophie. Mais aussi les mathématiques, la physique. Cette liste n'est pas exhaustive (pensons à la géographie). Elle donne à penser que si les sciences de l'information et de la communication ont les moyens d'entamer ce travail épistémologique, il serait illusoire qu'elles puissent le faire seules.
Chapitre 3
Technique et réflexivité
3.1 Usages et discours
La question des usages de l'internet n'est pas simple. D'une part, leur dimension intellectuelle est reconnue, au moins implicitement: on cherche, on lit, on écrit sur l'internet. J'ai montré que l'internet met en évidence la part sociale de l'activité intellectuelle. Au moins en filigrane, le couple {mental, social} est présent en divers commentaires des usages de l'internet; et c'est certainement parce que ces usages apparaissent comme un reflet permanent de nous-mêmes -êtres pensants en collectif- qu'ils ont tant de succès. Cependant, ce couple a longtemps été escamoté au profit de discours déterministes et consuméristes. Je l'ai évoqué au point 2.1.3 et le rappellerai au point 3.1.1. Enfin, depuis peu, le succès d'expressions comme «web 2.0» ou «réseaux sociaux», réinjectées en divers articles journalistiques ou universitaires, déplace cette approche techniciste: l'idée d'une sociabilité totale qui, à son tour se renforce, mais elle néglige la dimension intellectuelle. Dans tous les cas, la question des usages de l'internet, quand elle est abordée pour elle-même, rencontre trois écueils.- Tout d'abord, elle subit l'influence de sa genèse: elle est souvent conjuguée avec l'intérêt pour les «NTIC», toujours nouvelles, vecteurs d'une foi en le déterminisme de l'innovation. Pourtant l'histoire prouve que la grande majorité des techniques nouvelles est condamnée à brève échéance et qu'en cas de succès, leur appropriation passe par des détournements qui vont jusqu'à les dénaturer totalement [Edgerton, 1998]. Et le renouvellement constant des objets et des outils ne supporte pas la comparaison diachronique: les études longitudinales sont difficiles ou impossibles. Quand elles sont réalisées dans une optique consumériste, les enquêtes sur les usages supportent mal le passage à la petite échelle: dans la plupart des cas, des pratiques fort diverses sont réduites à une seule. Par exemple, les usages du courrier électronique sont tous agrégés. Ainsi, les personnes qui découvrent le webmail seront confondues avec les hackers qui utilisent mutt et qui se font envoyer chaque jour des centaines de mails par leurs propres robots pour surveiller les réseaux dont ils ont la charge. Pourtant, la culture et les pratiques des uns et des autres s'opposent radicalement.
- Ensuite, une vision instrumentale de la technique exclut l'acte mental au profit d'une disponibilité qui finit par mettre en avant «les usages de l'homme ordinaire et ses représentations de la réalité empirique et de la `vie'. [Ce qui a pour principal résultat de nous engluer en un] marécage réflexif du on dit [qui] exhale ainsi des valeurs éthiques et de vérité que des études savantes intègreront par les moyens de leurs méthodologies à des systèmes catégoriels appropriés» [Mathias, 2009]. En d'autres termes, les usages de l'internet servent plus des représentations naïves quant à la technique et des modes disciplinaires que des problématiques scientifiques. Et notre «homme ordinaire», étudié à l'aune d'une instantanéité banale où la singularité de sa pensée a peu de place, est de plus en plus éloigné d'un «nous», ce qui relance avec acuité la question de l'universalisme évoquée au point 2.3.1.
- Enfin, cette question des usages transpire souvent un projet idéologique qui ne s'assume pas. Il est en effet tentant et facile de mesurer des usages à l'aune des échanges sur l'internet. De telles démarches sont favorisées par les outils permettant d'analyser les réseaux sociaux. Ce qui renvoie à un parti-pris méthodologique intéressant: il s'agit de privilégier des propriétés relationnelles à des propriétés «substantiellement attachées à des êtres qu'elles définiraient en soi» [Boltanski et Chiapello, 1999] (p. 216). Un tel programme est donc partiellement structuraliste (étudier les relations entre des objets plutôt que ces derniers) et il renouvelle l'approche sociologique, en proposant de relativiser le poids des déterminismes (de classes, d'institutions, d'appareils, de champs, etc.). Des chercheurs comme Maurizio Gribaudi ont explicité et expérimenté avec succès un tel changement de paradigme [Gribaudi, 1998]. Mais cet auteur est bien moins cité par les analystes des usages de l'internet que Mark Granovetter170. Cependant, exprimée sans recul, cette approche relationnelle suppose une société ouverte, fluide, très peu contrainte par les organisations et les normes. Et la démarche fortement empiriste qui nourrit la plupart des programmes de recherche sollicitant graphes et réseaux sociaux déplace doublement la focale: on glisse des humains aux agents (chose certes admissible dans un contexte de science physique mais plus contestable quand les méthodes sont importées sans recul dans l'univers des pratiques sociales171) et de l'épaisseur des relations sociales (gorgées d'historicité et de culture) à l'instant, à l'«évènement de la connexion» [Boltanski et Chiapello, 1999] (p. 219). Les esprits caustiques diraient que ces déplacements témoignent d'un opportunisme d'esprits en mal de conceptualisation, mais capables de travailler sur les nombres et les graphes (des experts en littératie contemporaine sans recul?). Pour autant, nombre de ces recherches alimentent une doxa qui s'efforce de donner une légitimité au «nouvel esprit du capitalisme» -pour reprendre le titre de l'ouvrage des auteurs précités. Au final, les schémas conceptuels qui autorisent une telle approche sont souvent oubliés au profit d'une excessive naturalisation des réseaux, et donc de la société. Et les catégories sociales qui étaient évacuées d'emblée des analyses (puisque seules comptent les autonomies des agents et le hasard de leurs relations) sont réintroduites dans leurs conclusions - mais cette fois sous une forme pré-sociologique, para-démographique, qui rappelle le marécage réflexif évoqué par Paul Mathias.
3.1.1 Définir l'internaute
Je commente ici quelques résultats de l'enquête Insee174 déjà évoquée au point 2.3.1. L'enquête est massive, elle date de l'automne 2005. J'ai pu y avoir accès car, moyennant la signature d'une convention, l'Insee transmettait aux chercheurs qui le désiraient les fichiers informatiques contenant les données anonymisées de cette enquête175. Aussi ai-je pu, pour moi et mes étudiants, réaliser quelques traitements (dont les résultats n'ont pas encore été publiés). L'enquête concerne 5603 ménages -dont je conserverai 5566 individus-, 900 questions, dont environ 300 relatives à l'informatique, à l'internet et dans une petite proportion, à la téléphonie mobile. Elle est étendue à toute la France. Je ne m'y attarderai pas, et me contenterai de relever trois points. L'Insee a d'abord considéré comme internaute toute personne ayant «utilisé» l'internet une fois dans sa vie pour prendre ensuite comme référence toute personne l'ayant fait dans le mois qui précédait l'enquête: le taux d'internautes de France serait donc de 54% dans le premier cas, et de 47% dans le second. C'est la seconde définition qu'utilisera l'Insee pour servir de filtre pour les réponses aux questions ultérieures sur les usages. Or, même ce second critère est fort flou: suffit-il de consulter l'internet une fois par mois pour s'y sentir à l'aise? A priori non, puisqu'un tiers des internautes récents (du mois) affirme ne pas utiliser la messagerie électronique -pourtant généralement admise comme le catalyseur, sinon le témoin principal des usages de l'internet. Il s'ensuit donc que le pourcentage d'internautes est largement exagéré et qu'il relève de l'enjeu national: le taux le plus plausible, avant toute réelle précision sur les pratiques, ne peut excéder 31% si on exige l'usage du courriel quand l'institut l'évalue à environ 50%. Dans cette enquête, l'internet est plus imaginé comme un produit dont la consommation signalerait l'entrée de la France dans la «société de l'information» que comme une technologie de l'intellect en mutation176. On assiste là à un exemple concret de création d'une catégorie sociale indispensable à un processus de narration du monde. De tels exemples sont suffisamment rares (création de l'immigré à la fin du XIXe siècle, du chômeur dans les années 1970) pour mériter une étude détaillée. L'étude attentive des fichiers d'enquête de l'Insee confirme le résultat qu'annonce l'institut177: effectivement, 91% des enquêtés ayant utilisé l'internet dans le mois précédant l'enquête affirment savoir se servir d'un moteur de recherche. Un tel taux est radicalement opposé à celui que j'avais évalué à l'occasion de mon enquête massive sur les requêtes du moteur Voila.fr: 13% des internautes avaient cette compétence (cf. point 2.2.3 ). Là aussi, le fait que la maîtrise d'un moteur de recherche précède l'usage du courrier électronique surprend. Le doute s'installe quand on réalise que des non-internautes disposent aussi de cette compétence documentaire: 226 personnes, qui n'ont jamais utilisé l'internet -sinon qui l'ont utilisé depuis plus d'un mois- prétendent elles aussi savoir se servir d'un moteur de recherche. Au total, on obtient un taux supérieur à 100%: il y a plus de personnes qui maîtrisent la recherche documentaire en ligne que de personnes ayant utilisé l'internet dans le mois précédant l'enquête (2444 sur 2440). La cohérence statistique devient ici secondaire face à la dictature du chiffre. J'eus l'occasion d'évoquer ces contradictions à l'occasion d'une réunion de synthèse qui réunissait en 2007 les auteurs de l'enquête (et donc de ses résultats) et les chercheurs qui, comme moi, avaient pu travailler sur ces données. Elles n'ont ébranlé personne. Je vois là l'expression de la force d'un régime discursif au sens foucaldien. Sa puissance de vérité est telle qu'il peut être épargné par la contradiction, même quand celle-ci remet en question le coeur des compétences d'experts confirmés: les personnes qui écoutaient ma conférence étaient économistes et statisticiens, universitaires ou polytechniciens. Rétrospectivement, je suis autant étonné de l'hégémonie d'une telle clôture discursive que satisfait de la voir s'afficher aussi aisément. Ces deux exagérations statistiques rappellent que l'internet est désormais une entrée supplémentaire pour expliquer le rapport que les sociétés entretiennent avec la science et la technique. Elles donnent aussi confirmation que les premiers à se lancer en de telles narrations ne sont pas des tenants du sens commun, mais ceux qui prétendent être les plus neutres et les plus objectifs -au point de conforter les théories d'un Jürgen Habermas [Habermas, 1973]. Une troisième remarque pourra servir à critiquer les approches de type réseau qui nient ou négligent le déterminisme social178: il est aisé de montrer, même avec une définition aussi vague des internautes, la corrélation entre pratiques de l'internet et de l'écrit. Autrement dit, le capital social et culturel détermine grandement l'idée de faire usage de l'internet: la notion de classe sociale reste pertinente179. Il suffit de classer nos enquêtés selon un gradient de professions180, des plus éloignées de la pratique de l'écriture aux plus proches. Après recodage d'une soixantaine d'activités, j'ai construit quatre catégories: ouvriers, artisans et commerçants, secrétaires et techniciens, professions intellectuelles181. Un cinquième groupe, concernant 11% des enquêtés, a été exclu de l'analyse182. On obtient alors que 26% des ouvriers, 37% des artisans et commerçants, 52% des secrétaires et techniciens, 68% des professions intellectuelles ont fait usage de l'internet dans le mois précédant l'enquête: trois personnes sur quatre dont la profession sollicite peu l'écriture ne consultaient pas l'internet au sens de l'Insee. Et deux sur trois dont la profession était intellectuelle le faisaient. Pour donner plus de teneur à ce résultat, ambigu du fait du flou de la définition de l'internaute, on peut se limiter aux personnes se servant de l'internet au moins une fois par semaine (85% des internautes du mois passé). Les profils d'usage de l'internet sont un peu plus marqués: 20% des ouvriers (un sur cinq), 29% des artisans et commerçants, 46% des secrétaires et techniciens et 62% des professions intellectuelles (deux sur trois). Preuve que l'internet est bien en rapport étroit avec la littératie183.Ainsi peut-on prouver l'existence d'un ordre de discours chez les experts de la sociologie de la nation et en même temps conforter des hypothèses de travail qui contextualisent les usages.
3.1.2 Le législateur prescripteur d'usages
Les matrices discursives peuvent générer des usages. Le meilleur exemple me semble donné par les textes de loi: ceux relatifs à l'économie numérique ou à la création artistique184 imposent une surveillance systématique, a priori des internautes. Cela mériterait un long débat, que je n'ouvrirai pas ici. En revanche, je constate qu'au-delà de leurs effets potentiels sur les pratiques des internautes visés (qui pourraient se conformer aux lois ou les contourner), ces lois modifient le quotidien des professionnels. Elles leur imposent de remplir des fonctions de policier et d'assistant judiciaire, en exigeant des fournisseurs d'accès et de services à l'internet (FAI) qu'ils gardent trace des actions de leurs clients ou collègues et qu'ils agrégent ou synthétisent ces informations sur simple demande. De tels usages ne sont pas anodins même si on les croit marginaux: ce ne sont pas quelques centaines d'employés des FAI dont les fonctions sont dédiées à ces activités obligées de surveillance (et donc de maintenance), mais peu ou prou, tous les administrateurs de réseaux informatiques, publics ou privés. Ainsi la fonction de police se retrouve-t-elle imposée à un très grand nombre de professions, incluant des personnes opposées à l'idée de surveiller leurs collègues. L'étude des effets actuels des nouvelles lois permet ici d'éviter le piège des usages grand-public, plus fantasmés et projetés que mesurés et problématisés. Elle invite à se focaliser sur de réels changements des pratiques dans un univers professionnel, et, dans un esprit réflexif, sur les prescriptions d'usages. L'interdiction de vérifier la qualité d'un logiciel de cryptographie185, les volontés d'inscrire matériellement des droits d'usage186, les obligations d'user de navigateurs spécifiques187, la transformation d'un droit de propriété en droit de location soluble à tout instant188 renvoient à des pratiques dominantes où l'usager qu'elles tendent à profiler n'aurait qu'un droit de bricolage à la marge, face à des instruments façonnés par leurs concepteurs et publicisés par leurs promoteurs et vendeurs189. La réalisation d'enquêtes sur les formes d'imposition de telles pratiques aurait deux avantages. D'une part, elle déplacerait le regard sur des usages peu considérés tout en questionnant les limites des études sur les plus commentés: si le format et la mesure de nos faits et gestes ne nous appartiennent plus, mais sont désormais la propriété de quelques multinationales190, peut-on construire des programmes de recherche sur ces statistiques sans évaluer le biais induit par ces privatisations, qui parfois s'apparentent à des préemptions d'office? D'autre part, elle pourrait inverser la tendance à l'instrumentalisation des sciences sociales, souvent requises pour estimer -voire imposer l'appropriation de nouveaux produits 191, alors même que leur fonction principale est de permettre de prendre du recul sur les chiffres et les catégories que nous manipulons.3.1.3 Miliciens et sculpteurs de l'internet
On sait que les usages sont un formidable terreau pour cultiver une narration du monde, surtout quand ils concernent les machines à communiquer [Perriault, 1989]. Les exemples précédents font comprendre que ces représentations sont politiques: des discours et des lois s'instaurent, des gendarmes commis d'office apparaissent, des propriétés se dissolvent, la sphère privée est altérée. L'internet serait alors un révélateur du monde contemporain. Mais il convient aussi de comprendre comment il peut le façonner. Cela se fait aisément si on étudie comment un petit noyau de personnes a les moyens de traduire directement ses compétences littératiennes en pouvoir. De tels groupes existent, et ils se distinguent de ceux qui nous surveillent objectivement (du fait des lois) ou de ceux qui espèrent nous voler en trompant notre vigilance (spammeurs, etc.). Ce sont les personnes qui s'instaurent gendarmes de l'internet. Et, dans leur sillage, les prétendus notaires ou huissiers192. Depuis quelques années, des associations et des entreprises193 ont le projet de débarrasser l'internet des spammeurs. Leur idée est simple: elles tentent de repérer les noms de domaines spécialisés dans l'émission massive de courriers malintentionnés194. Ensuite, elles fabriquent deux listes: la noire, réservée aux sites (noms de domaines) considérés comme très pollueurs. En théorie, ce seraient les sites des mafias ou sous leur emprise. La grise, pour les sites estimés peu fiables, qui pourraient être détournés pour envoyer du spam. Les autres sites, supposés non problématiques, ne sont sur aucune liste. La question du filtrage du spam étant un casse-tête pour tout administrateur de réseaux qui dispose de faibles moyens de calcul et de compétences informatiques modérées, les gendarmes autoproclamés195 obtiennent rapidement une notoriété qui se traduit en autorité. Suivre leurs conseils est aisé: il suffit d'utiliser la mise à jour automatique de ces listes grises et noires pour rejeter, tout aussi automatiquement, tous les courriers en provenance des sites supposés douteux ou proscrits, avant même qu'ils n'arrivent dans les boîtes à courriel des «administrés»: quand un nom de domaine A est «banni» par un responsable réseau d'un domaine B qui applique les conseils des organisations anti-spam, tous les courriers envoyés par les membres de A et destinés à des personnes de B sont directement détruits. Cette solution semble efficace: elle génère un gain de temps (pour les destinataires des spams et l'administrateur réseau) et d'espace (disque). Ces pratiques posent néanmoins problème car le mode de constitution de ces listes est inquiétant: elles sont produites à partir de dénonciations souvent calomnieuses et jamais vérifiées (j'ai pu en faire l'expérience il y a quelques années), de statistiques sans grande signification196 ou de tests émis par les organisations anti-spam elles-mêmes197. Autrement dit, elles sont constituées sur la base de présomptions, de programmes simplistes198 et de projections d'usages. Les effets de ces jeux d'écriture sur le «monde réel» sont encore plus inquiétants: une fois dénoncé comme coupable, le site (en fait son administrateur système) doit faire la preuve de son innocence. Bien entendu, il ne sait pas ce dont on l'accuse et s'il le demande, on ne le lui dira pas: à lui de deviner le motif du bannissement. Aussi, dans la pratique, de nombreux sites officiels qui subissent de telles accusations font ce que leur proposent les vigiles: payer une amende ou une certification, ou (plus onéreux et conseillé avec insistance) s'offrir les services de l'entreprise commerciale cachée derrière les surveillants bénévoles199. Donnons un exemple: en août 2009, le site de l'ENS (environ 4000 personnes) fut déclaré de «pauvre réputation» par l'entreprise barracudacentral. Voilà ce qu'écrivait l'administrateur réseau200 à ses collègues:«Bonjour, [le serveur Z] est tombé en blacklist chez Barracuda:Effectivement, les accusations de la page http://www.barracudacentral.org/reputation?ip=x.y.z.t, étaient fort floues:
http://www.barracudacentral.org/reputation?ip=x.y.z.t
Cela bloque les mails vers au moins: @princeton.edu @df.unipi.it Je peux demander à sortir, mais il faut auparavant supprimer la raison et s'en justifier! Je cherche... et j'espère que ce ne sont pas les messages de 'vacation' que je mentionnais hier201... »
«We are sorry you have reached this page because an email was blocked based on its originating IP address having a "poor" reputation. The "poor" reputation may have been caused by one of the following reasons: - Your email server contains a virus and has been sending out spam.Ainsi apparaissent des pratiques d'exclusion [Forest, 2004] qui pourraient aller dans le sens d'une «virtualité» de l'internet, en inversant la problématique de cet écart au réel: les lois, les pratiques sociales et l'histoire n'y feraient plus référence. Ce qui est fortement condamnable en droit (l'accusation sans preuve, la ségrégation sans motif) est monnaie courante chez certains techniciens de l'internet202. De même pour la preuve de l'innocence, que l'accusé doit apporter, et l'idée qu'elle puisse être monnayée. Ce fait méconnu est aussi coûteux en temps (pour les administrateurs qui refusent de payer une certification de bonne conduite et qui sont alors obligés de trouver de quoi ils seraient coupables) qu'inutile [Hernu, 2008]. Et son institutionalisation probable (le gouvernement français a régulièrement le projet de déléguer à de telles compagnies le filtrage du spam de ses administrations) signale là aussi l'abandon de prérogatives régaliennes: la délégation à des entreprises privées non seulement de la sécurité sur l'internet, mais de la définition de cette dernière notion. Pour dépasser l'opposition réel-virtuel, on remarquera que se produit là une pratique sociale qu'il faut distinguer des algorithmes: ce ne sont pas des robots qui expulsent de l'internet un domaine et ses membres mais des humains, qui font des choix précis, à partir de leurs propres représentations et compétences. L'exclusion n'est pas mécanique, elle est sociale. Avec cet exemple, il me semble que l'internet signe ici une possibilité jamais rencontrée de configurer un monde conforme à ses catégories, à son axiologie, sans avoir le besoin de les confronter à l'expérience d'autrui -ou alors cet «autrui» est réduit à un groupe particulièrement restreint. Pouvoir démesuré de l'écriture, dont profitent quelques personnes pour «réguler» le monde selon leurs conceptions et préjugés203?
- Your email server may be misconfigured.
- Your PC may be infected with a virus or botnet software program.
- Someone in your organization may have a PC infected with a virus or botnet program. [...] Barracuda Networks is not attempting to block your individual emails in particular. The reputation system uses automated algorithms for determining its results - very similar to the anti-fraud mechanisms used for credit cards».
Le détour par les usages, du plus grand nombre et de quelques experts, nous renvoie donc à des imaginaires -fussent-ils indigents et menaçants. L'internet perd alors son statut de système technique pour devenir une fabrique du social à part entière. Il s'imbrique en nos représentations collectives. Et ce n'est pas tant la production spontanée d'éventuels parasites qui importe que la participation d'un grand nombre d'experts, de spécialistes de l'informatique et des réseaux à de tels régimes de croyances et de représentations. La problématique qui s'impose ici est celle de la culture, avec ses composantes inventives et créatives comme inertielles et réductrices.
3.1.4 Le plâtre discursif de la «fracture numérique»
Les résultats de cette partie sont tirés de mon article «Le mythe de la fracture numérique», rédigé en 2009 et à paraître en 2010 [Guichard, 2010]204. Puisque l'internet est un tel creuset de l'imaginaire social, on peut l'étudier pour comprendre comment ce dernier se construit. En fait, cette hypothèse semble incontournable: comment proposer que l'internet soit un sujet d'étude à part entière sans tenir compte de la façon dont il s'incruste dans nos représentations sociales? Le thème de la «fracture numérique» apparaît alors comme un fil d'Ariane pour comprendre comment se développent de telles représentations. Au sujet de la «fracture numérique»205, on repère aisément en France les travaux du Crédoc206 , qui mettent en place de lourdes enquêtes -parfois plus de 2000 personnes- pour la mesurer. Étonnamment, cette fracture n'est jamais définie. En revanche, en de telles études se déploie un discours complet sur la société française (ses pauvres, ses riches, ses vieux, etc.), et ce à partir d'un seul indicateur: la présence ou non d'une connexion à l'internet à domicile. Ces discours ne recherchent pas la cohérence: la culture statistique de leurs auteurs (qu'on ne peut mettre en doute) ne les empêche pas d'affirmer que «89% des adolescents et 34% des ménages modestes ont l'internet à domicile207». J'ai détaillé en quoi, à moins de supposer que les pauvres n'ont plus d'enfants, cet énoncé est contradictoire. {{[Guichard, 2010], note 9.}} En lisant le rapport du Crédoc, on repère vite que l'appel à des indicateurs statistiques sophistiqués (les indices de Gini) a plus pour fonction de masquer cette absence de rigueur (des chiffres, de la définition, des synthèses) que de conforter un raisonnement. Ces faits, combinés avec l'évitement de questions simples208 au profit de propos banals constituent les ingrédients d'un ordre de discours qui ne cherche pas à dissimuler ses motivations: conforter une hiérarchie sociale, participer à la clôture de l'espace public. «En abordant la question de la fracture numérique, [les narrateurs-experts] témoignent de leur capacité à entendre les inquiétudes et les désirs du pouvoir politique (le donneur d'ordre de l'enquête) et à les rendre légitimes et consensuels. » {{[Guichard, 2010], à paraître.}}. Pour sonder la littérature scientifique à ce sujet, j'étudiais un numéro spécial de la revue Réseaux (vol. 127-128, 2004), qui se focalisait sur ce thème de la fracture numérique. Il n'en disait quasiment rien. Les chercheurs se montraient dubitatifs: «le sentiment général est que la notion [de fracture numérique] a du sens, mais peu de contenu» [Rallet, 2004]. La majorité des articles se contentaient d'une recension de la littérature. On peut s'étonner qu'une revue savante publie un numéro double pour si peu. J'analyse aujourd'hui cette prolixité comme un marquage de territoire intellectuel, comme une contribution à cette construction-clôture du débat, et au final, à l'idéologie du marché [Stiglitz, 2002]. En effet, une polémique a priori mineure car ne remettant pas en cause l'existence de cette fracture209 permettait de retrouver le point commun aux auteurs de la revue Réseaux et des rapports du Crédoc: tous partageaient l'idée que le néolibéralisme était aussi inéluctable qu'espéré. Les premiers voyaient en les «TIC le moteur d'une nouvelle révolution industrielle210» [Rallet et Rochelandet, 2004]. Les seconds parlaient nommément des «promesses de la nouvelle économie». Ainsi, l'étude détaillée de ces travaux me permettait de remarquer que «la fracture numérique révèle plus de croyances et de soumissions à une injonction idéologique qu'elle ne se fortifie de preuves. {{[Guichard, 2010], à paraître.}} Au fur et à mesure, nous voyons comment la technocratie lui construit une parure de légitimité à grands coups d'autorité (des chercheurs, maniant la doxa économiste, s'exprimant en des revues savantes ou en des rapports commandités) et nous comprenons que l'histoire qu'elle narre dépasse le cadre national pour s'insérer dans un projet international, qui promeut le néolibéralisme comme fondement d'un monde idéal». Il est effectivement aisé de remonter à la source de tels discours: Bill Clinton (alors président des États-Unis) évoquait en 2000 la fracture numérique lors de conférences consacrées aux «nouveaux marchés économiques», à conquérir grâce aux nouvelles technologies211. C'était donc avant le projet DOT Force du G8212. En associant utopies capitaliste et sociale, l'orateur faisait là preuve d'une franchise que ne renierait pas le président de l'entreprise Cisco (cf. point 1.2.2 ), d'ailleurs présentée comme un des meilleurs soutiens au projet présidentiel de lutte contre cette fracture numérique. Étonnamment, ces propos ne rencontraient pas d'objections. Je soulignais l'ambivalence des altermondialistes qui, désirant se servir de ladite fracture numérique pour alimenter la critique sociale, reprenaient les mêmes arguments que les plus illustres représentants du capitalisme: «grâce aux TIC, la fracture sociale se dissipera213». Eux aussi proposaient plus de réseaux et de machines pour trouver une solution à ce supposé problème. Il y a ici un réel ordre de discours qui se met en place, et qui ne s'élimine pas simplement, car il est fondé sur une approche utilitariste de la technique: pour les uns comme pour les autres, la fonction de cette dernière serait de réaliser un but, de répondre à un besoin. Cette conception uniformément partagée -qui se veut parfois philosophique- explique cet étrange consensus au sein des débatteurs (sur un thème qui, rappelons-le, n'est pas défini) et leur faible intérêt pour la violence symbolique [Kvasny et Truex, 2001] produite par de tels discours, comme pour les formes d'imposition de la ségrégation ou du contrôle social qu'ils induisent (et que j'ai déjà évoquées). Ces forces et contraintes seraient-elles temporaires aux yeux de nos énonciateurs au motif que le «progrès» saurait leur apporter une réponse définitive du fait de sa capacité à répondre aux besoins? Avant de proposer de raisonner en termes de technique de l'intellect, je montrais la force argumentative de cette approche utilitariste: pour certaines personnes de bonne foi, l'emploi des notions de progrès, de besoin, d'accès au savoir et de technique, combiné avec le déterminisme technique et son pendant idéologique qu'est le déterminisme de l'innovation, peut les inciter à penser que la fracture numérique est autant une plaie sociale qu'un concept opératoire. En revanche, en raisonnant en termes de littératie, on comprend comment une transformation de l'écriture permet de penser sociologiquement les formes de domination et de ségrégation susceptibles de s'intensifier avec le développement des réseaux; par exemple quand de nouvelles méthodes de travail légitiment une remise en question de la contractualisation professionnelle ou quand des personnes à forte compétence littératienne en tirent profit pour exploiter celles qui en ont peu: «il ne faudrait pas pour autant oublier les anciennes formes de violence symbolique et de production de processus normatifs: nous connaissons nombre d'outils -dont l'informatique- qui nous ont été (ou nous sont) imposés au motif qu'ils étaient modernes, rationnels, et qui ont brutalement reconfiguré, dévoyé, taylorisé les métiers (jusqu'à ceux des savants). {{[Guichard, 2010], à paraître.}} Les discours qui les accompagnaient ressemblent étrangement à ceux relatifs à la fracture numérique. Ne pourrions-nous pas évaluer leurs effets coercitifs, la façon dont ils facilitent la diffusion de l'idéologie du management [Boltanski et Chiapello, 1999], et faire en sorte qu'ils soient remplacés par de réelles analyses et enquêtes scientifiques permettant une amélioration de ces logiciels dans le sens d'un accroissement de nos libertés et de nos capacités?». Je pouvais alors conclure en ces termes: «La fracture numérique est donc une idéologie. {{[Guichard, 2010], à paraître.}} Par son intermédiaire, l'internet -technique récente- se hisse au niveau des grands régimes de narration de la réalité, où le rêve et la séduction l'emportent sur la raison».La fracture numérique est un bon exemple de la façon dont un régime discursif se met en place en sollicitant tous les ingrédients de la légitimité contemporaine: demande d'État, enquêtes, experts, doxa économique, publications savantes.
Ces quatre éclairages montrent comment, au sujet des usages de l'internet, se produit un tressage entre trois constituants du raisonnement: un sens commun, souvent normatif et fortement relayé (déterminisme de l'innovation, nouvelles technologies); une idéologie, qui parfois s'appuie sur de nouvelles méthodes et souvent sur une conception naturaliste de la société pour imposer un changement de l'état du monde qui serait enfin libéré du déterminisme social; un ancien substrat philosophique (la technique au service des besoins). Quid de la réalité des usages? Nous avons vu qu'elle importe peu aux acteurs précités, plus soucieux de conformer le monde selon leurs imaginaires, leurs représentations ou leurs propres contraintes professionnelles que de donner un substrat théorique aux usages ou d'en produire une description fine. Le fait n'est pas nouveau [Babou et Le Marec, 2003] (p. 299). En définitive, les usages de l'internet deviennent des éléments d'une formation discursive qui s'avère un authentique champ de recherche: du fait de son pouvoir opératoire (dessiner la réalité contemporaine) et parce qu'en pleine construction, elle se donne à voir (ce qui permet de repérer d'autres formations). Nous pouvons alors étudier directement les usages idéologiques de ces usages, plutôt que de nous satisfaire de la gangue poltronne de nombreuses études à leur sujet. Enfin, si les usages d'autrui sont d'un intérêt scientifique secondaire, il nous reste la possibilité d'opérer un retour réflexif sur nos propres pratiques.
3.2 Vers la réflexivité
3.2.1 Les scientifiques et l'écriture
La force des idéologies réside dans le confort qu'elles apportent à ceux qui les promeuvent: leur espérance214 de gain concret ou symbolique est souvent plus élevée que s'ils s'en écartent et la prise de risque intellectuel peut s'avérer coûteuse: dans le cas qui nous intéresse, il est difficile de penser les relations entre technique et pensée. Le concept de technologie de l'intellect, s'il s'avère efficace, est peu sollicité, y compris par les savants. Est-ce parce que la chose n'est comprise qu'après une certaine expérience, qui peut s'avèrer rebutante? L'informatique, dans sa variété empirique, témoigne de cette difficulté et de ce risque: elle renvoie à des savoirs toujours en mouvement (logiciels, langages, systèmes d'exploitations, protocoles réseaux, etc.) et qui peuvent trouver à s'exprimer dans le cadre de spécialisations disciplinaires, sinon de services faiblement valorisés. Elle ouvre un indéniable potentiel épistémologique, en nous confrontant aux transformations de l'écriture, désormais électronique et en réseau, mais celui-ci ne peut-être réalisé qu'au prix de détours, qui obligent à acquérir d'autres savoirs, contemporains et mobiles, et aussi relatifs à l'histoire de la pensée et de ses outillages. Ce constat permet d'éviter l'adoption d'une position moraliste face aux personnes qui ne cherchent pas à conceptualiser les tranformations actuelles de l'écrit, ni à en tirer le plus grand profit. Cette dernière remarque renvoie à la question du «logiciel libre», que je conçois, non comme un garant de liberté, mais de non-privation de celle-ci; comme un «passeur» de potentialités intellectuelles. L'idée que tous ne tirent pas parti de ces catalyseurs de capacités n'a rien de choquant: chacun est libre d'utiliser les instruments de son choix et on sait que des vieux outils peuvent forger des pensées fort originales. Cependant, un chercheur confronté à la solitude de sa pratique instrumentale peut avoir le sentiment que sa pensée sera bridée tant que la majorité de ses collègues préfèrera d'autres outils, dont les inconvénients objectifs (coût, incompatibilités, usage machinique) ne sont compensés que par leurs usages fortement collectifs. Ici la notion de masse critique prime. Cet enjeu explique le caractère parfois polémique, sinon militant des débats sur les logiciels libres. Ayant pu moi-même profiter de cette expérience de la technicité de l'écriture (cf. points 2.1.2 et 2.2.3), mes connaissances en matière d'encodages, de formats des fichiers, d'articulations entre logiciels me firent vite prendre conscience d'un paradoxe: dans le monde universitaire que je connaissais, il apparaissait grosso modo que tout ce qui relevait des apports prévisibles de l'informatique (automatisation des tâches, accroissement des possibilités de calcul, assistance intellectuelle) était gratuit, et tout ce qui en était le contraire devait s'acheter. Pourtant, de plus en plus de scientifiques utilisaient des «logiciels privateurs»: payants, ne leur permettant pas l'accès à leurs propres écrits, leur imposant des milliers de gestes routiniers. Et les chercheurs en informatique eux-mêmes n'étaient pas en reste, abandonnant les outils conçus par certains d'entre eux pour ces logiciels privateurs. À l'invitation de philosophes215, je fus amené à préciser les relations que les scientifiques entretenaient avec l'écriture informatique. Je commençais par détailler les relations entre technique et culture, puis choisis de montrer comment l'écriture était un pivot essentiel de ces relations, en insistant sur quelques objets hybrides: à les regarder de près, l'algorithme, le livre, la bibliothèque, la méthode et le logiciel témoignent des dimensions réflexive et récursive de l'écriture. Restait à comprendre pourquoi cette instrumentation sociale, créatrice et parfois performative (la monnaie comme artifice [Herrenschmidt, 2007], la mécanique quantique [Bachelard, 1963], les cartes de l'internet [Johansson, 2000]) était peu prise en compte par les scientifiques. Et plutôt que de me limiter à une analyse sociologique (doxa extérieure à la science, hiérarchies disciplinaires) mais expliquant faiblement nos difficultés à intégrer dans le long terme l'évolution de notre outillage mental, je préférais détailler cette dernière. Je repérais trois bouleversements essentiels, apparus de façon lente et continue depuis deux siècles: le calcul, le graphique et la documentation. Le calcul, central dans les computers, augmente fortement nos capacités; il n'est pas qu'un sous-produit de l'informatique, il témoigne des liens forts entre technique et théorie: a priori application de la science -et outil de promotion des ventes d'ordinateur avec le tableur- et aussi son aiguillon, avec l'essor de la combinatoire et de l'algorithmique. Considéré comme une affaire de techniciens par de nombreux spécialistes des sciences humaines, il est aussi témoin d'une utopie désormais séculaire qui brise l'idée que la pensée et la technique soient distinctes. Je rappelais, en référence au programme de David Hilbert, que «l'illusion que le calcul, la machine, l'écriture et la mathématique pouvaient se confondre existait bien avant la cybernétique» {{[Guichard, 2008b], p. 65.}}. De cette première transformation de nos savoirs et capacités, dont je montrais la faible réception en sciences humaines, s'en déduisent deux autres. Le graphique est fort répandu depuis l'usage des ordinateurs: j'entends par là une «image structurée», comme les schémas, diagrammes et cartes. Ici aussi, la rhétorique révolutionnaire est inutile puisque le graphique a une longue histoire, qui commence à la Renaissance et qui se développe considérablement dans tous les domaines au XIXe siècle. La meilleure preuve en est «le Grand Dictionnaire Universel de Pierre Larousse, qui regorge de planches, graphiques, formules mathématiques, partitions de musique» {{[Guichard, 2008b], p. 66.}}. Je rappelais que le graphique est un outil essentiel de compréhension qui permet parfois d'exprimer des concepts mieux qu'avec des mots (diagrammes de Feynman). Son importance dans le domaine de la preuve est si reconnue qu'il est désormais absorbé par les systèmes d'écriture contemporains (le web, conçu par les physiciens pour leur propre usage, en constitue le meilleur exemple). Sans entrer dans le détail de l'essor de la preuve graphique et de ses effets (ce que je développerai en d'autres articles), je montrais comment notre instrumentation intellectuelle est déplacée par le graphique: «cette extension de l'écriture au graphe, associée à la rapidité de le réaliser (et donc de calculer), font que l'image (organisée), d'illustration, devient méthode; nous ne produisons plus une carte -ou un graphique- pour décrire une réalité, nous en réalisons des milliers à partir de données que nous avons du mal à analyser jusqu'au moment où l'une d'entre elles nous persuade d'une réalité plus fiable ou plus parlante que les autres. Cartes, graphes et logiciels qui les produisent font maintenant partie intégrante de notre outillage intellectuel» {{[Guichard, 2008b], p. 66.}}. La transformation de la documentation est centrale pour qui s'intéresse aux relations entre technique et pensée. Dans les sociétés de l'écrit, la documentation est le préalable à tout déploiement d'une pensée élaborée. Pourtant, son importance est déniée, y compris chez ses professionnels: «en France, c'est peut-être là que la césure entre l'intellectuel et le technicien s'est exprimée de façon flagrante» {{[Guichard, 2008b], p. 67.}}. Et s'il me fallait encore défendre, à la date de la rédaction de cet article (entre 2006 et 2007), les effets de la documentation en ligne sur nos catégories de pensée, ceux-ci sont aujourd'hui acceptés, même s'ils restent peu théorisés. Je précisais le paradoxe de l'actuelle documentation, à la fois plus naïve et plus calculatoire que celle de l'imprimé, mais aussi utilisée systématiquement -preuve de son efficacité: «La pratique documentaire témoigne cependant de la façon dont une transformation de l'écriture s'accompagne de l'invention, de l'adaptation de tout un ensemble d'instruments intellectuels, comme le sont aujourd'hui les moteurs de recherche [...]. Pourtant, les philologues accoutumés aux index et thésaurus216 «bien pensés» peuvent trouver ces outils fort rustres: un moteur ne fait que calculer des fréquences et des co-occurrences de mots (en fait de suites de symboles), des importances de pages dans le graphe du web [Abiteboul et al., 2004], sans se soucier de contextes sémantiques, de crédibilités d'auteurs, ou de traditions d'érudition. {{[Guichard, 2008b], p. 67.}} Bref, un outil a priori primitif, même s'il faut plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs pour le faire fonctionner». La recherche documentaire m'apparaissait (et m'apparaît toujours) l'exemple idéal pour montrer comment la pensée est affectée par un changement dans notre système de signes: avec l'écriture électronique, le chiffre, la lettre, la ponctuation se confondent. Nous passons alors du mot ou du nombre au «motif» (pattern), dont la recherche passe par des langages et des programmes ad hoc (dont Perl est un bon exemple). Et la documentation met en évidence la réflexivité de l'écriture: «comment une transformation a priori secondaire (coder du texte sous forme binaire) {{[Guichard, 2008b], pp. 67 et 68 pour cette citation et les suivantes.}} transforme la notion de mot, donc notre rapport au texte, à nos pratiques documentaires, et par suite, l'organisation des savoirs». Et je forçais un peu le ton, engagé que j'étais alors contre les tenants de la pensée pure et dématérialisée, et contre un certain aveuglement bibliothécaire: «il est instructif de voir que c'est l'outil le moins noble aux yeux des champions de la littérature et de la culture qui démontre de la façon la plus éclatante le statut de technique de l'intellect de l'écriture et ses effets conceptuels». Cela me permettait aussi de revendiquer une forme d'accompagnement pédagogique qui passe par l'explicitation du détail des processus de la pensée, fussent-ils exprimés en terme concrets217. Qu'ajouter à la phrase suivante? «Jolie preuve, mais ô combien prévisible: car écrire, c'est aussi ranger, et savoir comment retrouver ce qu'on a classé, ordonné. En ce sens, la documentation, qui renvoie à l'art de mettre des étiquettes et surtout, de les retrouver, dépasse largement la notion commune de recherche d'information pour s'avérer équivalente à la classification, elle-même quasi-synonyme de la démarche scientifique».Ces trois déplacements de notre outillage expliquent autant nos pratiques -et nos balbutiements concrets comme conceptuels face à l'informatique et l'internet- que l'histoire longue des rapports de la science avec l'écriture. Ils déplacent donc notre focale des usages (qui, ici ne sont pas plus «donnés» que les techniques qui les accompagnent) vers les pratiques savantes, en leurs dimensions historique, sociologique et épistémologique: nous comprenons qu'en précisant la façon dont des traditions savantes et des disciplines ont évolué avec l'écriture, nous percevrons mieux les tendances scientifiques contemporaines, voire les formes d'engouement ou de résistance face à de nouvelles méthodes, disponibles ou imposées. Par exemple, ces transformations de l'écriture témoignent de la domination d'un outillage mental forgé par les mathématiciens et les physiciens et contribuent à la diffusion d'une «manière spécifique de penser, d'appréhender et de représenter le monde» {{[Guichard, 2008b], p. 68.}} qui n'a aucune raison d'être neutre, ni dans l'univers scientifique (ex.: études sur les réseaux sociaux), ni dans celui du grand-public (ex.: pouvoir tiré de la littératie); j'espère l'avoir prouvé dans le point précédent (point 3.1). En même temps, et cela explique que l'idéologie soit si souvent sollicitée par les «experts» ès fracture numérique et ès usages pour compenser leurs pannes conceptuelles, nous «avons des difficultés [...] à prendre du recul sur le fonctionnement de notre pensée. [Et] quand nous tentons cette expérience, nous restons dépendants de catégories, de représentations, de références philosophiques rétives aux transformations intellectuelles que nous générons. {{[Guichard, 2008b], p. 68.}} Dans les deux cas, nous n'arrivons pas à être pleinement réflexifs; la contradiction, que nous refusons dans nos raisonnements, ne nous gêne pas quand il s'agit de les théoriser». Je ne suis pas le premier à faire ce constat, et je ne suis pas certain de toujours éviter les contradictions que je remarque chez d'autres. Je reste aussi persuadé que les sciences humaines peuvent apporter beaucoup aux sciences exactes pour résoudre ces contradictions: «la sociologie, l'anthropologie et l'histoire peuvent nous aider à dépasser ce paradoxe, à «durcir» les sciences dites dures, sans pour autant les réduire à de pures productions sociales» {{[Guichard, 2008b], p. 69.}}. Ceci dit, la confusion et la violence des débats en matière d'informatique obligent parfois le théoricien à tenter de s'exprimer en leur arène: pour tenter de les apaiser, et pour défendre ses méthodes et approches. C'est dans cet esprit que je me penchais sur l'écriture scientifique en 2006. Après les précautions d'usage218, je remarquais que les outils d'écriture les plus répandus étaient les logiciels privateurs, au motif étrangement démocratique et abondamment répété par leurs acheteurs (les responsables de centres informatiques) que «les incompétents n'en connaissent pas d'autres et que ceux qui auraient un minimum d'expertise sauront toujours lire ou produire des documents en ces formats». {{[Guichard, 2008b], p. 70.}} Or, à bien y regarder, ces décisions (car nous sommes ici dans l'univers de l'injonction, et non pas de la liberté d'usage) ont plusieurs défauts: elles rendent difficile l'acquisition d'une culture informatique qui serait rendue aisée par la comparaison d'outils différents; elles nous transforment en automates des automates censés nous servir («taylorisation» des tâches); elles contraignent notre pensée en obligeant nos raisonnements à s'adapter à ces logiciels privateurs. À l'opposé, les «briques» de petits logiciels ont à mes yeux deux avantages. Le premier a trait à la réflexivité de l'écriture, le second à leur possibilité d'accompagner au plus près nos échafaudages intellectuels.
- «Un logiciel libre transporte une part de son archéologie en nous livrant un code source que nous pouvons lire, même si nous n'en comprenons pas tous les termes; au moins il ne fait donc rien à notre insu et il nous familiarise avec l'univers de la programmation, de l'écriture, dont l'épaisseur apparaît. C'est le contraire de la boîte noire. {{[Guichard, 2008b], p. 72.}}
- S'ajoute à cela un trait originel toujours d'actualité: un logiciel libre est conçu comme une petite brique logicielle, dotée de quelques fonctions fiables et précises, destinée à être accrochée à d'autres briques. Ainsi, le projet intellectuel de l'auteur détermine la structure logicielle qu'il va édifier, inventer, en associant au gré de ses connaissances, de ses besoins et de son humeur, ses briques cognitives. Il fera d'autant plus aisément feu de tout bois que ces objets sont construits pour privilégier cette interopérabilité. En ce sens, la panoplie des logiciels libres traduit une compréhension subtile de l'intelligence humaine et de son caractère collectif. »
Ainsi, l'analyse de ses propres pratiques et de celles des mondes savants contemporains déplace-t-elle la question générale des usages vers celle de l'histoire des transformations de l'outillage qui conditionne ces pratiques: le calcul, le graphique, la documentation. De façon analogue, la question du non-usage des logiciels libres ne renvoie plus à des positions morales ou scientifiques. Elle dépasse la problématique naïve de la mesure de l'utilisation de tel ou tel logiciel pour signaler une injonction imposée par des personnes peu familiarisées avec la notion de technique intellectuelle, aux conceptions normatives et passéistes quant à la science et aux techniques. Il m'apparaît que cette forme de coercition, qui date de plus de vingt ans, peut expliquer les réticences de nombreux chercheurs face aux logiciels libres, même si on leur en présente les avantages: ayant subi depuis trop longtemps l'imposition d'outils inadaptés et contraignants, pourquoi pourraient-ils avoir soudain confiance en de nouveaux instruments, dont ils peuvent légitimement penser qu'ils induiront un autre coût d'entrée? Ne se sentent-ils pas de plus en plus dépossédés de leurs méthodes professionnelles, ne serait-ce que du fait que les logiciels et les ordinateurs sont payants? Replacée dans un contexte historique, cette problématique devient politique: une telle «privation de l'outillage mental [... me semble pouvoir être fructueusement mise en correspondance] avec la `prédation par des entreprises privées de savoirs de plus en plus fondamentaux' [Pestre, 2005] {{[Guichard, 2008b], p. 75.}}, [... étrangement] soutenue par des institutions supposées défendre le bien public219.». Ainsi les capacités cognitives qu'offre l'écriture passent-elles au second plan derrière un ensemble d'idéologies et de croyances, qui apparaissent plus déterminantes que la rationalité pour comprendre le statut et les usages de nos techniques de l'intellect. Gardons néanmoins en tête que l'étude attentive des usages savants de l'internet et de l'informatique ouvrent deux chantiers prometteurs: celui de l'histoire de l'écriture chez les scientifiques; celui des relations, elles aussi historiques, entre l'écriture, la science et la culture.
3.2.2 La tresse de l'internet, de ses usages et de ses discours
Des points précédents, il ressort que l'étude des usages de son propre monde, voire de ses propres pratiques, est féconde: elle déplace les problématiques et de ce fait les renforce. Elle met en évidence l'apport de l'empirie: je n'aurais pas repéré ces trois grandes transformations de l'écriture si je n'avais pas poussé mon expérience de la programmation à ses limites textuelles et graphiques. De même, ma pratique des logiciels dits libres m'a permis de préciser les formes de violence symbolique liées à l'imposition de logiciels normatifs et de m'intéresser à la notion de mondes lettrés contemporains. Les apports de cette ethnographie détaillée des pratiques intellectuelles étaient d'ailleurs prévisibles [Jacob, 1996,Jacob, 2007]. Elle permet aussi combien l'analyse de l'internet est polluée par les idéologies et les représentations naïves. Mais on a remarqué que la critique de ces dernières n'est pas aisée. Souvent, l'idéologie est sollicitée pour se sortir d'un mauvais pas, pour escamoter la question complexe de devoir penser sociologiquement l'évolution des pratiques intellectuelles étayées par la technique. La solution la plus efficace consiste à prendre ces discours comme objets d'étude et à mesurer la marge de manoeuvre de leurs énonciateurs. Celle-ci semble réduite: c'est manifeste pour les membres d'une technocratie contrainte de produire de l'idéologie afin d'assurer sa reproduction. C'est aussi clair si l'on raisonne en termes d'ordre de discours foucaldien, ou d'emprise culturelle: il nous est difficile de nous dégager de nos «habitudes rationnelles» [Bachelard, 1963], qui dissocient technique et pensée. De ce fait, il me semble que le meilleur moyen de dépasser les limites de notre pensée soit de travailler sur ces habitudes, et donc sur les notions de culture et de représentations: il s'agit de comprendre dans le détail comment elles se construisent, s'infléchissent, s'articulent, tentent de faire sens. Et l'internet peut nous y aider grandement, de par sa propension à écrire -en un sens plus anthropologique que philosophique- le monde. Je montrerai en quoi la cartographie permet d'articuler ces deux projets: celui d'une analyse réflexive de ses pratiques lettrées et celui d'une étude de l'écriture des représentations du monde. Auparavant, je voudrais revenir sur la subjectivité de l'internet. J'ai montré qu'on ne peut séparer la chose des discours à son sujet (cf. point 2.1.3 ), et il semble qu'on ne puisse faire mieux de ses usages. Certes, les usages de l'internet étudiés pour eux-mêmes sont décevants. J'ai détaillé ce fait et ses raisons, et je m'étonne que tant d'analystes se lancent encore dans la description, générale ou spécifique, géographique ou sociologique de la multiplicité de leurs facettes et tentent avec un succès variable de les articuler à des enjeux. Ainsi se multiplient des discours opportunistes et sacrifiant à la curiosité pour un présent incessamment reconductible: on «surfe» sur la vague de l'immédiateté, du dernier objet220 ou concept à la mode, on devient journaliste sans avoir conscience du fait que les catégories que l'on manipule (les publics et leurs pratiques) sont souvent définies par les entreprises-mêmes dont on narre les prouesses commerciales comme statistiques. Pour autant, on ne se débarrasse pas aisément de cette foison d'études et de propos. Parce qu'ils forment la matière première des formations discursives, dont j'ai tenu à montrer qu'elles sont un authentique objet scientifique. Et si l'internet s'inscruste dans nos représentations et nos imaginaires, c'est bien par le biais de pratiques, réelles ou fantasmées. Elles sont constitutives de son existence, de sa définition, comme je l'ai rappelé au début de ce travail (cf. point 1.1 ). Par ailleurs, les pratiques lettrées et inventives en relation avec l'écriture et l'informatique sont effectivement affaire d'usages. Mais elles en déplacent considérablement le contexte car elles invoquent des gestes, des savoirs, des débats, des cadres de pensée qui nous constituent. Ainsi, ces usages nous renvoient-ils à notre propre subjectivité. Cette double dimension des usages (terreau d'un ou plusieurs ordres de discours relatif à la technique et chose qui participe de notre définition d'êtres pensants) montre qu'ils sont eux aussi inséparables de l'internet. Il s'ensuit que même si les études sur les usages sont de fait une sous-catégorie des discours, par ailleurs souvent faiblement problématiques et encore plus faiblement réflexives, la cohérence théorique nous incite à «rehausser» les usages dans toute leur variété, avec toutes leurs définitions, au même niveau que l'internet et ses discours221.Ainsi l'internet, ses usages, ses discours forment une seule et même tresse.
Il s'ensuit que si deux des constituants essentiels à la définition de l'internet ne sont pas objectivables, l'internet ne l'est pas plus. Cela pourrait être vrai de toute technique. Mais nous comprenons que ce métissage intime de la subjectivité et de l'objectivable n'est pas seulement révélé par l'internet: il en est nourri. L'internet co-produit aussi cette réalité sociale, car il affiche et déplace le rôle de la technique qui nous rend le monde intelligible. Un idéaliste dirait que l'internet, parce qu'il traduit l'empire de l'écriture, exprime celui de la pensée. D'autres diraient que la créativité humaine a permis de déployer, au fil des millénaires, un complexe tissu d'outils en et hors nous (un concept étant aussi un outil) et que nous arrivons à un seuil de changement de nature de cet outillage: sans avoir la prétention de le déterminer définitivement (que vaut un demi-siècle au regard de l'histoire et du futur de l'humanité?), nous ressentons tous le besoin ou le désir de préciser ce qu'est ce seuil, ce qu'il définit. Assurément, nos prothèses se confondent de plus en plus avec notre corps et notre esprit. La cartographie exprime bien cette situation: elle questionne nos pratiques lettrées, nous permet de dessiner le monde à partir de nos représentations et de notre culture, tout en témoignant de la façon dont sa production les infléchit. Elle combine une anthropologie des pratiques de l'écrit contemporain avec une expérience performative.
3.2.3 La cartographie informatique
La cartographie est aujourd'hui la rencontre d'une écriture devenue numérique qui étend ses possibilités graphiques (formule, graphe, langages graphiques, etc.) et d'une évidence: la spatialité de notre univers. Elle élucide une trajectoire de l'écriture contemporaine: partant de la mise en liste d'objets, de quantités, elle sollicite la géométrie, méthode intellectuelle qui va rendre spatialisables nombre d'entités et les émanciper de nos catégories du sens commun (en produisant d'autres formes d'espace par une opération abstractive). Ensuite, cette production spatiale va s'écrire et se confronter à ce sens commun, à la culture, et les altèrer, les transformer. Ainsi la cartographie explicite-t-elle la capacité de l'écriture à se dévoiler, à produire des effets sur elle-même et sur ses utilisateurs: en alimentant des représentations du monde, en traduisant et en infléchissant des cultures. J'ai rappelé le passé lointain de mon expérience cartographique222. En 1999, j'ai réalisé l'atlas de l'immigration. Cette production est un jalon car elle signale le métissage croissant de trois centres d'intérêt: la cartographie, mes recherches théoriques et empiriques en relation avec l'internet (Atelier Internet) et d'authentiques problématiques des sciences sociales, qui étaient en ce temps peu conciliées avec les deux premières questions (sauf dans une optique utilitariste qui posait question). Mais avant d'entrer dans le détail de cette réalisation et des suivantes, je dois rappeler que la cartographie n'est pas l'unique détour pour prendre conscience de la réflexivité de l'écriture.3.2.3.1 Outils, cheminements et théories
Si mon expérience de la cartographie m'a apporté des éclairages singuliers -ouverture vers la réflexivité, histoire des mondes savants et dimension créative de l'activité scientifique et technique-, d'autres cheminements sont possibles: par exemple la pratique de l'édition en ligne223. Le désir de comprendre les possibilités «techniques» de l'écriture propre à l'internet et d'en tirer parti offre un recul et une analyse prometteurs. Ce détour par l'édition électronique n'est pas non plus indispensable: dans certains cas (Antony Grafton, Roger Chartier, etc.), l'érudition et la conceptualisation permettent de comprendre en finesse les transformations contemporaines de notre outillage mental. Mais les travaux de ces chercheurs ne sont pas banals: ils sont orientés vers les interdépendances entre support, système de signes, mutation et transmission des savoirs. Ils nous montrent les avantages et inconvénients d'une transformation matérielle de l'écriture: quand ils rappellent que l'imprimerie des débuts conquiert de nouveaux marchés et démocratise l'accès aux savoirs écrits, mais au détriment de la qualité des textes. Ils montrent aussi comme la technique induit de nouveaux métiers, souvent oubliés par l'histoire intellectuelle: les correcteurs de la Renaissance ont été les réels éditeurs des premiers imprimés romains du fait de leurs doubles compétences de lettrés et de «techniciens», de leur compréhension concrète de la totalité des mécanismes intellectuels. Une position qui rappelle celle du webmestre, a priori simple typographe de l'internet et rapidement secrétaire de rédaction, donc intervenant sur le fond des textes à publier au point de devenir éditeur scientifique: «Le correcteur [dans les années 1470-1500] a tout l'air d'une figure éminemment moderne qui doit son existence aux impératifs d'une technologie nouvelle, un peu comme les webmasters et designers de pages Web des années 1990. [...] De même que les nouveaux métiers intellectuels nécessités par l'internet, celui du correcteur a pris forme avec une rapidité qui nous paraît foudroyante» [Grafton, 2007]. Plutôt qu'une révolution, le métier de correcteur révélait une pratique euphémisée, pourtant déjà présente avant l'imprimerie: corriger un texte, c'était aussi l'émender, en remanier le fond, le commenter, l'indexer. Ainsi l'étude attentive de l'émergence de ce métier passé permet-elle de percevoir et d'expliciter les dimensions collective et matérielle de l'activité intellectuelle -et la façon dont elle dépend de ces deux facteurs. Les «technicités» de l'historien et de l'informaticien leur permettent donc de comprendre non seulement les enjeux de la technique, ses effets intellectuels et sociaux, mais aussi la façon dont elle s'hybride avec une pensée pratique comme théorique. Il en est de même pour un autre sujet malmené par les spiritualistes: l'influence de la quantité et du nombre sur nos concepts. Quand il s'agit de penser des effets d'un accroissement quantitatif substantiel de livres, de revues ou de sites web sur la documentation et sur les ordres qui permettent de qualifier les savoirs et leurs articulations, rarement les catégories héritées de la routine savante sont remises en question. Pourtant, les travaux de Gabriel Naudé [Damien, 1995], de Louis Pasteur [Duclert et Rasmussen, 2002] ou de Paul Otlet [Fayet-Scribe, 2000] conduisaient tous à réinventer les métiers de bibliothécaire, puis de documentaliste, du fait que la masse documentaire changeait le métier des érudits et des savants. Or, nul ne nie le besoin d'un classement conceptuel quand nos capacités et habitudes cognitives sont mises à mal par un excès de données et d'information. En ce cas, l'érudition doit être articulée par un fil conducteur, un autre ordre conceptuel, souvent dérivé d'un nouveau paradigme, pour se redéployer et se régénérer. François Rastier ne dit pas autre chose: «[les sciences humaines] ont accumulé des connaissances sans précédent sur la diversité des langues et des sociétés humaines; l'effort sans précédent lui aussi d'inventaire et de conservation du patrimoine culturel à l'échelon mondial appelle à présent une réflexion théorique pour penser la diversité de ce patrimoine, dans le temps comme dans l'espace» [Rastier, 2001]. Quantité des sources primaires et secondaires et quantité de leurs traitements possibles, de leurs mises en formes invitent donc à repenser pragmatiquement l'organisation des savoirs et la façon dont elle se construit. C'est d'ailleurs ce que propose aussi la cartographie, avec la production de synthèses originales à partir de données trop massives pour être appréhendées par des textes ou des tableaux. Ce détour historique et mon expérience personnelle me poussent à favoriser la formation de ces correcteurs des temps modernes. De telles personnes peuvent se montrer plus perspicaces que des collègues qui acceptent avec plaisir le titre d'éditeur mais qui évitent de se confronter à la pratique de l'édition électronique: la numérisation de collections, le rapport entre écriture électronique et patrimoine, la façon dont l'édition numérique infléchit les relations entre les savoirs et ceux qui les partagent, tout cela se pense et s'imagine difficilement sans une longue expérience de la totalité de la chaîne éditoriale électronique, du projet intellectuel au produit final, jusqu'à plonger les mains dans le «cambouis des octets». Et cette pratique invite à s'interroger sur les processus techniques et intellectuels passés qui ont conduit à la formation et à la pérennité de ces collections et patrimoines.3.2.3.2 L'atlas de l'immigration
L'origine de cet atlas remonte à 1992, quand je mettais sur pied avec Gérard Noiriel le séminaire d'histoire quantitative de l'immigration (cf. point 2.1.2 ). Pour préparer l'ouvrage collectif qui le concluait, les participants, majoritairement élèves et enseignants de l'ENS, ont saisi entre 1995 et 1997 de nombreuses données des recensements de 1931 et de 1936 relatives aux Français, naturalisés ou non et aux étrangers de chaque département. 90 pages de tableaux de recensement des années 1931 et 1936, quasiment introuvables ailleurs, étaient accompagnées de leur commentaire et d'autres articles en rapport avec notre recherche [Guichard et Noiriel, 1997]. À partir des tables des étrangers, classés par l'État français en une cinquantaine de catégories qui ne correspondaient pas toujours à des nationalités précises224, j'ai construit 147 fichiers dénombrant le total des hommes et des femmes de chaque «nationalité» dans chaque département, complétés de leurs pourcentages225, ceci pour les années 1931, 1936 et pour leurs variations entre les deux recensements: ceci permettait de mesurer les taux d'expulsés suite à la crise économique (1932-1934) et à la xénophobie de cette période. J'ai alors mis au point entre 1998 et 1999 un logiciel en ligne qui permettait aux internautes de réaliser eux-même les cartes de leur choix à partir de ces données, ce qui leur offrait un total de 3888 cartes possibles226. Sous les cartes, un renvoi hypertextuel permettait d'accéder aux tableaux des sources. Ce fut certainement le premier logiciel de cartographie en ligne publié en France, et assurément pendant longtemps l'unique qui fut destiné aux SHS. Cet outil, dénommé Atlasclio, est toujours disponible aux URL http://barthes.ens.fr/atlasclio et http://barthes.enssib.fr/atlasclio. Il témoigne des deux avantages apportés par le renouvellement de notre technologie de l'intellect: un surcroît d'analyse des sources publiées par le biais de la cartographie; une accessibilité accrue (pour les lycéens, enseignants chercheurs, etc.) de ces sources et cartes. Les premières années, le succès de cet atlas fut modeste: seuls les historiens, géographes et sociologues de la rue d'Ulm et leurs proches en faisaient usage. Ensuite, des enseignants du secondaire s'en servirent, en firent la réclame sur leurs sites et listes de discussions, et des universitaires allèrent jusqu'à publier en des manuels les cartes qu'ils avaient réalisées avec l'Atlasclio. Aujourd'hui, environ 500 cartes sont demandées et produites chaque mois, ce qui est à la fois peu et beaucoup si on considère le thème spécifique qu'illustre cet outil (l'histoire de l'immigration) et le faible intérêt du grand public pour des cartes thématiques. J'ai d'ailleurs pu vérifier que l'usage de logiciels destinés au monde de la recherche, qu'ils soient en ligne ou téléchargeables, reste confidentiel jusqu'à quatre années après sa conception227. Les suites éditoriales de telles productions renforcent cette statistique: je finis toujours par me voir proposer de rédiger un article à la suite d'une conception logicielle, mais jamais avant un délai d'au moins trois ans. Je commentais ce programme novateur en 2001 sur le site de l'atlas. Mon texte était repris en 2003 dans la revue en ligne les Actes de l'histoire de l'immigration et en 2005 dans l'ouvrage Les Historiens, leurs revues et Internet (France, Espagne, Italie)228. J'avais conscience d'avoir produit un outil original, qui tirait le meilleur parti des possibilités du web dans un contexte scientifique et j'espérais qu'il servirait au mieux mes amis historiens229. Après avoir détaillé les conditions d'usage du logiciel et ses limites, je précisais les conditions qui en avaient permis le développement: l'interdisciplinarité de l'ENS, qui favorisait le dialogue entre des individus aussi experts que dévoués, qu'ils fussent historiens ou informaticiens, et la souplesse des logiciels libres, qui m'avaient rendu la vie si facile. Ensuite, je commentais les effets heuristiques de l'atlas. Son audience réduite230 au regard des autres pages du site http://barthes.ens.fr -qui était entre 1999 et 2003 un des plus consultés de sa catégorie231- ne m'empêchait pas de prendre conscience de la dynamique intellectuelle et éditoriale impulsée par cette expérience: il «nous semblait important de pousser l'écriture sur le web à ses limites, tout en continuant à développer notre politique de publication de sources primaires: la richesse d'un site web universitaire tient plus à la spécificité des données publiées et à la réflexion sur les potentialités de l'outil, par exemple en termes de production de `produits dérivés' de ces sources et de leur appropriation par le lecteur, {{[Guichard, 2005], p. 99.}} qu'en le désir de réaliser une pâle copie de ce qui existe déjà». Ces propos me semblent toujours d'actualité et me confirment dans l'idée que nombre d'institutions universitaires ont laissé passer de nombreuses opportunités au début des années 2000 en privilégiant les sites «vitrine» au détriment d'une exploration réflexive et empirique des possibilités de l'écriture en réseau. De même quand elles ont négligé de soutenir les pionniers du web que j'avais décrits dans ma thèse232 et les «soutiers éclairés» de l'informatique233, et quand elles n'ont pas pris l'initiative de former des étudiants d'une façon qui articule au mieux production concrète et histoire des mondes lettrés: il y aurait (eu) là moyen de soutenir l'activité savante, d'aider les étudiants à trouver des métiers fort demandés, de les impliquer dans une dynamique favorisant autant l'industrie que les professions intellectuelles. Je ne suis pas persuadé que ces propos de 2001 aient encore aujourd'hui un écho considérable, malgré le développement de programmes tels qu'Adonis (http://www.tge-adonis.fr) et la multiplication de financements dédiés à la numérisation de collections. Je précisais après comment les écritures contemporaines nous facilitaient l'activité intellectuelle: «l'organisation du raisonnement est grandement facilitée par la manipulation d'outils de tris, de comptages, de productions graphiques. Le mot perd de sa noblesse (une phrase, un nombre, ne sont que des données) mais la démocratisation de son statut nous fait gagner en efficacité. Autrement dit, la production intellectuelle, la psyché, ne peuvent faire l'économie des outils externes plus que simples qui sont aujourd'hui à notre disposition» {{[Guichard, 2005], p. 99.}}. Je prouvais ici par la pratique la justesse des théories de Jack Goody. Je suggérais alors de multiplier la mise à disposition des outils premiers du chercheur (archives numérisées, bibliographie, notes de lectures, etc.) et de les articuler, comme pour l'atlas, avec des méthodes statistiques, cartographiques, lexicométriques en ligne. J'évoquais enfin les suites disciplinaires et épistémologiques de la démarche que je proposais et dont j'avais pu tester l'efficacité. L'édition électronique n'est pas qu'ouverture vers un outillage mental renouvelé. Elle offre un triple regard sur l'imprimé: économique (quel éditeur aurait accepté, même avec une subvention, de publier tout ou partie d'un tel atlas?), cognitif (accès direct aux données, qu'il est désormais inutile de recopier) et sociologique (mise en évidence des relations entre éditeurs et leurs auteurs universitaires). Et ces apports de l'écriture en ligne pour les historiens valent pour l'ensemble des sciences humaines. D'une part, en réalisant de tels instruments, on est conduit à «s'interroger sur les méthodes de la discipline: {{[Guichard, 2005], p. 102.}} lesquelles sont plus le fruit d'une tradition besogneuse, d'une routinisation de la recherche que d'une réelle avancée méthodologique?». D'autre part, l'écriture électronique conduit à repenser le rapport entre trace et archive, et à imaginer comment nos notes et brouillons d'aujourd'hui influeront sur les manières de faire et sur les problématiques de celles et ceux qui font profession de leur traitement, par exemple en les triant et en les constituant comme archives. Sur ce point, j'imagine que Michel Foucault et Michel de Certeau ne m'auraient pas contredit. Ainsi le détour par l'écriture cartographique en ligne m'amenait à réfléchir en des termes simples et concrets sur la façon dont les mondes lettrés articulent leur pensée avec les outils collectifs qu'ils fabriquent et peaufinent. Cette première démarche allait en induire deux autres: la production de cartes animées en relation avec des données propres à l'internet et la réalisation d'un atlas électoral. Ces deux logiciels m'ouvriront des pistes épistémologiques parfois inattendues, toujours fructueuses.3.2.3.3 Données et flux de l'internet
J'avais déjà expérimenté en 2000 la production de cartes animées à partir des «obtenues» [Latour, 2007] du RIPE234. Ce premier travail m'avait permis de me «faire la main» et ces cartes me valaient des invitations (par exemple au festival international de géographie de Saint-Dié des Vosges) et des commandes d'articles. Une seconde série de données de l'internet me fut communiquée par le GIP Renater235 et m'a invité à approfondir deux thèmes en relation avec l'écriture cartographique contemporaine: celui de la preuve graphique, et celui de la sémiologie: je désirais vérifier si les travaux entamés par Jacques Bertin236 pouvaient s'étendre à l'animation. Il s'agissait donc d'obtenir, avec les données des échanges inter-régionaux de Renater, une articulation satisfaisante entre fond de carte, légende, rythme et représentations des flux. Le travail était bien plus délicat que pour les cartes RIPE car la dispersion des flux internet entre plaques régionales suivait une loi de puissance237 et empêchait donc toute représentation classique. Par exemple, une épaisseur des flux proportionnelle à leur taille ou à leur logarithme aurait masqué les flux faibles ou fait déborder les flux massifs de l'écran238. Après de multiples essais, je trouvais le moyen de visualiser ces flux aux amplitudes fort variées, et l'animation mettait bien en évidence les dynamiques géographiques: le quadrilatère Paris-Strasbourg-Nice-Montpellier239 des forts usages de l'internet, face à un reste de la France aux flux presque négligeables. J'avais aussi réussi à promouvoir la géographie auprès des physiciens: «in addition to the structural complexity of the web and the Internet, the traffic has its own complexity with its own cartography {{[Barthélemy et al., 2003], conclusion.}}». La production de ces cartes m'apportait d'autres avantages. Elle m'invitait à compléter mes compétences en langage PostScript240: j'améliorais le logiciel de cartographie Ératosthène que j'avais développé (en Perl). Ce projet me poussait aussi à imaginer comment produire des animations. Je découvrais le logiciel (libre) Gifsicle, conçu par Eddie Kohler, qui produisait du GIF241 animé à partir d'une batterie d'images elles-mêmes en ce format «raster». Surtout, je défrichais des méthodes qui renvoyaient aux possibilités algorithmiques et récursives de l'écriture: je ressentais le besoin de rédiger un méta-programme (lui aussi en Perl) qui lançait Ératosthène autant de fois que nécessaire (entre 100 et 400) pour produire des cartes vectorielles, puis les convertissait en images GIF avant de les transmettre au logiciel Gifsicle. Je n'avais pas que (re)découvert l'automatisation -si peu sollicitée des utilisateurs d'ordinateurs. J'avais compris la façon dont l'informatique facilitait et explicitait l'étagement de l'écriture242. Loin d'un simple dépôt de mots sur une machine pour expliciter ma pensée intérieure, cette réalisation consistait en des ajouts de couches textuelles qui facilitaient, voire automatisaient la production de sens. Ce fait mérite d'être détaillé: dès la première étape cartographique, le texte est composé d'une ou deux couches. C'est un fond de carte, constitué d'identifiants, de coordonnées et parfois de sous-ensembles (calques). En parallèle, réside le fichier des valeurs que l'on désire décrire par l'intermédiaire du logiciel de cartographie, ici Ératosthène: il apparaît comme une surcouche textuelle qui enveloppe les premiers fichiers (fonds de cartes + données). La troisième couche (le troisième emballage) est contituée par le méta-programme243, qui produit un jeu de cartes, les convertit en GIF, et sollicite le logiciel Gifsicle pour associer ces dernières images. La quatrième complète la carte animée finale d'un ensemble de balises html qui rendra possible sa publication sur le web. On pourrait rajouter à ces étapes les processus d'écriture qui permettent leur initialisation (systèmes d'exploitation, etc.) et leur finalisation (intégration des protocoles du web dans les navigateurs). Ces processus sont connus mais oubliés et une telle expérience d'écriture a le mérite de rappeler leur existence et la façon dont tout texte simple et toute production sophistiquée sont, avec l'informatique, enchâssés dans de tels étagements textuels244. Par le biais de l'empirie, je comprenais aussi que cette stratification de l'écriture se réalisait à partir de briques élémentaires et que, bien ajustées, elles permettaient de construire des édifices intellectuels complexes. Pour le dire communément, les limites micro et macro de cette technologie de l'intellect m'apparaissaient de façon indéniable. Ce fait n'est pas une découverte en soi: les programmeurs Unix/Linux le connaissent et sont les premiers à évoquer l'expression de «brique logicielle245»; cependant, à ma connaissance, ils n'évoquent pas explicitement la dimension itérative de leur écriture.3.2.3.4 Un atlas en SVG
J'ai prolongé ces questions d'écriture cartographique dans le cadre d'un programme de recherche en cybergéographie financé par le CNRS246, ce qui m'a permis de fédérer des chercheurs physiciens, géographes, et informaticiens247 . Je projetais alors d'explorer plus encore les capacités cognitives de l'écriture électronique. Les informaticiens de l'ENST (cf. note 78) me firent alors découvrir un nouveau format graphique dédié au web et développé par le W3C, le SVG248. L'architecture et les orientations de ce langage confortaient deux intuitions personnelles: d'une part, le rôle des mathématiciens et des physiciens dans le développement de l'écriture contemporaine249; d'autre part, la textualisation accrue de l'image organisée (graphiques, cartes, etc.) et sa limite contemporaine, l'hypertualisation texte-image -qui pourrait signifier une intertextualisation de l'image devenue texte250. Certes, le statut textuel de la carte est avéré depuis fort longtemps251; l'hypertexte dans la carte apparaît avec le dessin des latitudes et longitudes, et se développe avec les cartes «spéciales» (thématiques) du XIXe siècle quand s'explicitent les relation entres formes (cercles, etc.), couleurs et légendes [Palsky, 1996]. Or le SVG pousse à l'extrême les possibilités déjà systématiques du format html et des langages qui l'accompagnent (comme le JavaScript). Avec le SVG, l'image vectorielle n'est plus que suite de mots. Elle est aussi support textuel (par exemple lors du passage de la souris sur une zone donnée), «animable», et devient brique primaire d'une graphie dédiée à la preuve et à l'argumentation. Ici encore, ce qui était compliqué se simplifie, bascule dans l'ensemble des objets élémentaires de la technologie de l'intellect, ce qui l'enrichit. Dans le même temps, les méthodes et les questionnements sur sa nature réflexive sont renouvelés et déplacés. Ce fait, troublant et décisif, explique nos difficultés face à une écriture renouvelée: sa simplification augmente effectivement nos capacités intellectuelles, comme le remarque Jack Goody. Mais cette facilité accrue invite à développer de nouvelles méthodes, de nouveaux savoir-faire, dont l'assimilation et la transmission sont rendues délicates du fait de leur nouveauté. D'où la tension entre facilité et complexité générée par une mutation de l'écriture252. Résolu à traduire concrètement les compétences acquises lors de cette fédération de chercheurs et à illustrer les questions que mes collègues m'aidaient à me poser (écritures du territoire, apports heuristiques de la cartographie et délégation aux internautes des outils cognitifs proposés par l'écriture électronique en ligne), je réalisais alors un atlas du premier tour des élections présidentielles de 2002: leur résultat -le candidat de l'extrême-droite était arrivé second- m'avait ébranlé et les commentaires des spécialistes, pendant ou après les élections ne m'avaient pas satisfait. Je voulais fabriquer un outil qui me fasse comprendre -«voir»- avec le maximum de détails ce qui s'était produit ce 21 avril 2002. Le travail était titanesque: il me fallait tout d'abord récupérer, ordonner, agréger et mettre en une forme convenable les données désordonnées publiées sur le site web du ministère de l'Intérieur253, puis simplifier et compléter le fond de carte communal de la France hexagonale dont je disposais, que je découpais ensuite en départements et en régions. Je réalisais pour cela une quarantaine de programmes. Pour chacun des 120 départements et régions que j'avais redessinés, je produisais une centaine de fichiers décrivant leurs coordonnées, celles de leurs communes et de leurs voisinages, et les résultats électoraux (pour chaque candidat, nombre d'inscrits, de votes blancs et nuls, etc.). Il me restait ensuite à améliorer Ératosthène pour qu'il puisse traiter le format SVG et réagir instantanément aux demandes des internautes, alors que la masse de données sous-jacentes atteignait les 291 Méga-octets. Là encore le travail fut fastidieux, mais j'arrivais à le finaliser en décembre 2004. Cet outil, légèrement remanié depuis, est toujours accessible à l'URL http://barthes.enssib.fr/presid2002/cartesnc.html. Le nombre de cartes avoisine l'infini: assurément bien plus que la totalité des poèmes de Raymond Queneau. Le logiciel permet de réaliser une carte diversement paramétrable, à partir d'un double choix de candidats ou de groupes de candidats dont on veut décrire les scores dans une région ou un département. Je ne détaille pas ici ses fonctions ni les conclusions auxquelles il permet d'arriver: je m'en suis expliqué dans un article [Guichard, 2007a] et j'ai précisé en ligne son usage et mes méthodes254. Je me contenterai de signaler deux points. Le premier est simple mais très efficace au plan cognitif: grâce au SVG, le résultat précis de chaque commune s'affiche quand l'icone de la souris circule au-dessus de sa surface. Source considérable d'information pour qui veut analyser finement ces élections. Ceci renvoie aux avantages de l'hypertextualisation ci-devant évoqués. Le second montre comment notre outillage peut bouleverser des hypothèses de travail -témoignage de l'accroissement de nos capacités intellectuelles du fait de la technique; les potentialités combinatoires de l'informatique me permettaient de concevoir des cartes de n'importe quelles agrégations ou oppositions de candidats: «autre corollaire des capacités computationnelles et graphiques des machines actuelles, on peut cartographier n'importe quelle combinaison de données, n'importe quel panachage de candidats. Par exemple, pour l'élection 2002, on peut opposer les voix pour M. Jospin à celles pour tous les autres candidats de la gauche plurielle de son gouvernement (+Jospin -Chevènement -Hue -Mamère -Taubira), faire la carte de l'extrême-gauche (+Besancenot +Gluckstein +Laguiller), opposer ce que j'appelle les droites extrêmes (MM. Mégret, Le Pen et Saint-Josse) à un(e) ou plusieurs candidats. {{[Guichard, 2007a]}} Une telle combinatoire permet de visualiser des cartes inédites et augmente nos capacités intellectuelles en transplantant en ligne l'heuristique offerte par les logiciels cartographiques, majoritairement hors ligne». Cette potentialité m'a permis de mener un raisonnement auquel je n'aurais jamais pensé: surpris du faible score de M. Jospin dans le Languedoc-Roussillon face aux droites extrêmes, et connaissant grâce à l'atlas sa popularité face à M. Chirac en cette même région255, je fus amené à oser additionner les voix de ces deux concurrents pour évaluer la présence d'un socle républicain et sa résistance aux droites extrêmes. Les cartes produites par l'atlas prouvent à quel point cette dernière n'avait aucune consistance: dans l'Hérault et le Gard, les deux candidats, ensemble, sont laminés par les voix des droites extrêmes256. Dans certaines villes, comme Beaucaire (près de Nîmes), le solde négatif est de 20,4%. Il est de (-)16% à Aigues-Mortes. La plupart du temps, il excède 10%. Et les préfectures et sous-préfectures, censées mieux résister bien mieux que leurs banlieues ou campagnes aux séductions extrémistes, font piètre figure: +14% à Montpellier, +4% à Nîmes, -0,3% à Béziers257. Ainsi, j'ai pu prendre conscience de phénomènes que je n'aurais pas anticipés si je n'avais pas eu à ma disposition le déploiement combinatoire proposé par l'informatique ni les articulations entre nombre, texte et graphe qu'elle permet258.3.3 Écriture, territoire et culture
3.3.1 Cartographie et philosophie
C'est à partir de 2005 que j'eus la possibilité de théoriser ces précédentes expériences. Dans un premier article, «L'internet: retrouvailles de l'écriture et de la cartographie259», je montrais comment, avec l'informatique, le statut méthodologique de la carte est renforcé: héritage de la démarche exploratoire des physiciens. Je précisais comment un territoire non nécessairement perçu au préalable pouvait se construire: «que les cartes soient réalisées par un ingénieur, un géographe, ou un physicien, leur multiplicité rend le territoire plastique, suite à toutes les manipulations qu'on lui fait subir. Même si le territoire n'est pas pensé au départ, le travail cartographique le chosifie, le réifie: quand on analyse des phénomènes sociaux spatialisés, la lecture de cartes toutes différentes, mais structurées autour des mêmes invariants produit un entendement, voire une évidence du phénomène territorial que l'on tente de saisir, d'imaginer ou de vérifier tels qu'une fois visualisé sous une forme définitive, ce dernier existe. Ce mécanisme de réification du territoire par l'intermédiaire de la carte n'est pas nouveau: Christian Jacob a montré que la carte précède le territoire plus qu'elle n'en résulte [Jacob, 1993]. {{[Guichard, 2006], p. 52.}} Mais la cartographie électronique semble faciliter ce phénomène. Et il est probable que l'intérêt renouvelé pour le concept de territoire soit lié à cette heuristique de la cartographie informatique». J'étudiais ensuite la rupture d'avec la cartographie imprimée induite par l'animation. Je m'appuyais sur la carte animée des communes de France que j'avais réalisée260 en 2001. Cette carte est originale pour trois raisons.- Elle montre qu'une carte animée n'est pas nécessairement indexée par le temps. Autrement dit, le champ d'application de ces cartes déborde du strict cadre historique.
- La rupture sémiologique propose des apports heuristiques: j'ai choisi de représenter chaque commune par un point, et non par un cercle dont la surface serait proportionnelle à sa population, afin qu'on ne puisse distinguer villes importantes, bourgs et hameaux. J'ai aussi décidé de ne pas figurer les frontières de l'hexagone.
- Cette carte s'avère particulièrement démonstrative: elle affiche tout d'abord les villes de plus de 10 000 habitants (on n'y reconnaît pas la France), puis celles d'au moins 9 900 habitants, et ainsi de suite jusqu'aux villages de moins de 100 habitants. On voit clairement que les communes de moins de 500 habitants composent la moitié des communes de notre pays et on en déduit l'extraordinaire poids politique de la ruralité, où la voix de l'électeur d'un village peut peser jusqu'à 200 fois celle d'un parisien261.
3.3.2 La construction des territoires de l'internet
Ainsi percevais-je comment l'écriture infléchit des représentations sociales tout en étant elle-même le fruit de lentes transformations à la fois conceptuelles et matérielles, dont on imagine qu'elles sont elles aussi en relation avec une culture à la fois profane et savante. J'eus l'occasion de préciser cette dynamique dans le chapitre «Géographie de l'internet», que je rédigeais en 2005 à la demande de Christian Jacob [Guichard, 2007b]262. Je commençais par y rappeler la matérialité de l'internet et la structure écrite de ses protocoles. En décrivant les deux plus connus (TCP et IP, son facteur consciencieux mais aveugle), j'explicitais l'archéologie du découpage des numéros IP en classes (cube IP de dimension quatre), qui était restée obscure à mes collègues informaticiens. Et je rappelais le poids des physiciens (du CERN) dans le développement de l'internet, comme dans ses usages: «Le caractère récent de cette `technique' donne à penser que l'internet reste dépendant de ses premiers usages: ce fut, avant tout, un outil de scientifiques pour des projets scientifiques [...] {{[Guichard, 2007b], p. 992.}} Les physiciens avaient pour projet d'optimiser l'`efficacité cognitive' de leur communauté étouffée par les multiples données, articles, graphiques, schémas, etc., aussi indispensables à leur production scientifique qu'ils étaient difficiles à recueillir, à classer, à repérer». Pour préciser les déplacements entre spatialité et territoire, je détaillais l'articulation entre plage de numéros IP et nom de domaine. Les numéros IP renvoient à une conception géométrique (l'hypercube de dimension 4) qui s'émancipe de toute catégorie culturelle: un pur jeu d'écriture soigneusement réservé à une élite restreinte qui construit son pouvoir hors du marché et qui bouscule nos conceptions en matière de proximité sémantique. En revanche, les noms de domaines, qui, eux sont vendus (en fait, loués) produisent des possibilités d'ancrage géographique par le biais de leurs intitulés et extensions. De plus, ces noms de domaines obéissent à la loi de l'offre et de la demande, qui peut induire des contestations potentiellement arbitrées en des tribunaux. Autrement dit, les deux paramètres du territoire (la spatialisation et la socialisation, concrétisée par des enjeux et des conflits) sont clairement présents avec ces noms de domaines, mais sous une forme métaphorique: la localisation est imaginée. Cette situation met donc en évidence l'articulation entre territoire et représentation sociale: «quand on découvre des sites, des domaines ou des machines identifiables par des noms comme «bbc.com» ou «univ-limoges.fr», on pense qu'ils sont «situés» à Londres dans le premier cas, à Limoges dans le second. {{[Guichard, 2007b], p. 997.}} Peu importe que ce soit vrai ou faux; la dénomination génère un ancrage proprement géographique». Apparaît ici un lien direct entre territoire et culture par le biais de ces représentations, qu'elles relèvent du savoir, des normes ou de l'imagination. En d'autres termes, nous découvrons notre propension à confondre préjugés et rationalité, réflexes culturels et confiance. «Les interrogations de nombreux universitaires et documentalistes quant à la validité ou la légitimité scientifique des contenus des sites internet semblent liées à ce potentiel qu'ont leurs noms de générer ou non une référence culturelle: {{[Guichard, 2007b], p. 998.}} il y a là un automatisme cognitif, rarement explicité dans le domaine bien balisé de l'imprimé (avec ses revues savantes, ses ouvrages, et leurs hiérarchies respectives) qui témoigne de la relation entre la culture et le territoire». Or, ces références culturelles sont encore plus fragilisées par les outils de repérage de l'internet. Ce n'est pas que les anciens territoires soient détruits: ce sont les façons de les appréhender qui changent, qui les altèrent et nous «déroutent». En effet, la cartographie de l'internet sollicite deux méthodes auxquelles nous ne sommes pas accoutumés. La première renvoie aux pratiques du Moyen-Âge: l'itinéraire. La seconde dépasse le concept de carte pour s'intéresser au graphe. Le détail des moyens imaginés par les scientifiques pour tenter de constituer une géographie de l'internet avec ces deux méthodes leur donne le pouvoir de décrire, voire de définir la réalité. Les objets graphiques qu'ils produisent servent de socle à un nouvel entendement du monde. Pour autant, il n'est pas garanti que ces chercheurs en usent en rompant totalement avec leur culture (culture3): «à voir la prolifération de ces cartes et leurs effets sur nos représentations du monde, on se demande quelle est la marge d'autonomie de cette production graphique a priori neutre. Ces cartographes des temps modernes n'obéissent-ils qu'à une logique purement technique ou scientifique, ou leur production est-elle le résultat de leur imaginaire? Autrement dit, sauraient-ils dessiner autre chose que ce que leur culture leur dicte? Une approche sociologique du monde scientifique et un regard curieux sur la production littéraire [...], invitent à ne pas rejeter la seconde hypothèse: {{[Guichard, 2007b], p. 1008.}} la façon dont les scientifiques dessinent et cartographient l'internet doit peut-être beaucoup à la culture dans laquelle ils ont été immergés». Avec cet article qui détaillait comment les territoires de l'internet s'incrustaient dans notre quotidien par le biais de choix, d'algorithmes, et de leurs associations avec des représentations qui les précédaient, je posais donc la question de la construction de la culture.3.3.3 Écrire le territoire
On l'a remarqué, dans ces premiers articles, je restais prudent quant à la façon dont se fabriquait le territoire, en insistant surtout sur les formes concrètes de sa production, et je ne faisais qu'esquisser ses liens avec la culture. J'abordais précautionneusement ce dernier thème, certes parfois sur-sollicité. Au fil du temps, je décidais de m'y confronter. Divers facteurs m'y aidèrent: mes études d'anthropologie; un certain agacement face aux «légitimistes de la culture» qui évitaient systématiquement de la définir; le terrain de l'internet, qui renouvelait de manière si féconde tant de problématiques; et enfin, les solidarités intellectuelles de chercheurs comme Christian Jacob et Jack Goody: en mars 2007, j'étais invité par le premier et par plusieurs de ses proches263 à présenter mes analyses sur le thème de l'«écriture cartographique du monde264». Suite à cette conférence, la revue Études de Communication me proposait de rédiger un article, que j'intitulais «L'internet et le territoire265». Je tentais de répondre aux questions suivantes: «quels ingrédients intellectuels facilitent le raisonnement en termes de territoires? Quelles sont les classes sociales ou intellectuelles les plus réceptives à ce concept ? Cette capacité leur donne-t-elle un surcroît de pouvoir pour forger ces territoires?» En effet, plutôt que de poser pour acquis le territoire de l'internet, je jugeais plus utile de détailler la dynamique des inscriptions et perceptions territoriales, et de préciser les classes ou groupes sociaux qui avaient le pouvoir de les infléchir. Une fois de plus, l'internet ne témoignait pas d'une révolution, mais d'un fait qui avait peu de raisons d'être absent du temps de l'imprimé: «Si mon raisonnement est juste, l'irruption des territoires de l'internet ne serait plus la conséquence d'un artifice du type deus ex machina, mais conséquence à la fois des formes contemporaines de l'écriture et du pouvoir des classes et groupes sociaux qui la maîtrisent le plus. Alors, l'internet ne serait plus ce nouveau monde peuplé de métaphores spatiales, où les imaginaires et les territoires s'imposeraient comme de nouvelles évidences témoins du caractère novateur de la «chose» [Mathias, 2002], mais la production prévisible d'une catégorie sociale aujourd'hui dominante -les informaticiens- qui sur-sollicitent, dans leur appréhension du monde, les notions d'espace, et plus implicitement, de territoire». {{[Guichard, 2007c], p. 84.}}. Je rappelais la différence entre espace et territoire: le premier peut se concevoir en éludant la culture et le social, que le second prend en charge -normes incluses; d'où l'importance des représentations dans le territoire, et donc de l'écriture, qui est la technique qui les forge et les transmet266. Je donnais quelques exemples actuels de fabrication du territoire, ce qui me permettait d'en détailler les nouveaux ingrédients scribaux: un tel outillage mental n'était pas disponible avant l'informatique en réseau. Je rappelais néanmoins la lente évolution de l'écriture informatique, et la diffusion de son pendant graphique: des icones des bureaux de nos ordinateurs aux instruments des mathématiciens et informaticiens (LATEX, SVG, etc.). Au premier plan des experts de la production cartographique, je repérais les métrologues de l'internet: «Il me semble que le territoire de l'internet est avant tout le résultat de cette écriture cartographique collective d'un groupe aux motivations précises, les métrologues de l'internet, et aux compétences étendues en matière d'écriture contemporaine, géométrisée. {{[Guichard, 2007c], p. 93.}} En ce sens, ils sont les descendants des ingénieurs du XIXe siècle qui ont inventé les cartes `spéciales', que l'on appelle aujourd'hui thématiques». Cette compétence nourrit le déploiement d'une ré-écriture du monde qui s'appuie autant sur des imaginaires et des représentations que sur des «faits scientifiques». Je restais, là encore, prudent: «Il y aurait effectivement lieu de comprendre en quoi et comment ces cartes participent d'une ré-écriture du monde, en même temps qu'elles sont le produit d'une culture précise. De même, il faudrait étudier en détail comment ces territoires écrits, créés, sont vécus par leurs auteurs; et comment, au-delà de la force culturelle dont ils héritent, ces territoires deviennent des matrices de territoire prêtes à être investies par des groupes sociaux, des imaginaires. Comment, de potentiels, d'ancrages de l'imaginaire, ces territoires se transforment en creusets de territoires vécus, de cultures, et bien sûr, de conflits. C'est sur ces bases que se constitue une géographie de l'internet, et que la problématique du territoire s'avère précieuse». {{[Guichard, 2007c], p. 94.}} Cette conjecture de l'écriture du monde s'élargit aussitôt au statut de ses auteurs. On peut logiquement considérer que ceux qui savent dessiner et commenter le monde contemporain sont les lettrés d'aujourd'hui. Cette approche a deux avantages. Elle dépasse les définitions utilitaires de la littératie et rappelle qu'hier comme aujourd'hui, les lettrés ont toujours été juges et partie: «juges, car ils analysent, évaluent les représentations sociales; ils précisent leurs structures, leurs tendances, leurs infléchissements. {{[Guichard, 2007c], p. 94.}} Par exemple, ils expliquent comment se constituent les territoires. Parties, parce qu'ils expriment, dessinent ces représentations, ces territoires. Ils les contraignent donc, [...] ils en définissent les possibles». Ainsi pouvais-je conclure en raisonnant plus en termes de matrices qui allaient modeler nos inscriptions et perceptions territoriales actuelles et futures qu'en présupposant l'évidence d'un territoire de l'internet figé à jamais. Je m'écartais donc de la définition commune du territoire et j'étais désormais assuré qu'il était un concept fructueux au plan méthodologique267. Ce que j'allais développer dans l'article suivant.3.3.4 Culture et représentations
Je proposais une synthèse de mes réflexions dans l'article «Internet, cartes, territoire et culture268». Je revenais sur la difficulté des mondes savants à appréhender les relations entre technique, science et culture en m'appuyant sur mon expérience ulmienne. Je présentais aussi de manière plus directe que dans les précédents articles mes premières intuitions en termes de territoire: «ou le territoire de l'internet existe, et il est utile de le cartographier; ou il n'existe pas, et une production cartographique va lui donner de la consistance. Donc, le territoire de l'internet existe déjà, sinon existera». {{[Guichard, 2008a], p. 81.}} Si le territoire est une méthode pour appréhender le monde, il convient d'en préciser les mécanismes et les savoir-faire. L'outillage mental propre à la cartographie invite à considérer celui de tout lettré; plus qu'un érudit spécialiste de textes particuliers, il est un expert en une ou plusieurs littératies, de son temps ou antérieures: un gymnaste de la technologie de l'intellect. Ce qui a pour vertu consécutive d'inclure les ingénieurs dans le monde des lettrés et d'imaginer que les premiers aient aussi forgé une culture -privilège souvent accordé de façon préférentielle aux seconds. Or, le territoire souffre de la cohabitation de deux savoir-faire qui s'articulent mal ensemble: celui propre au spatial et celui propre au social. Les spécialistes du premier thème maîtrisent bien l'écriture électronique, mais peuvent avoir une analyse moins fine des représentations sociales que les seconds. Ce qui invite, après avoir défini ces représentations, à en préciser le champ: elles «font système (cohérent ou incohérent, peu importe) et donc se sollicitent les unes les autres (phénomènes d'articulations, de causalités, d'apprentissage); elles suivent des canaux de communication précis, parfois parallèles, parfois alliés, d'autres fois conflictuels; elles s'articulent avec des pouvoirs et des idéologies». {{[Guichard, 2008a], p. 86.}} En quoi l'écriture agit-elle sur les représentations? Elle renforce leur inertie. «Là intervient l'écriture. En comparant les technologies de l'intellect, nous remarquons que l'écriture garantit plus facilement la stabilité des représentations sociales que l'oralité: nous les oublions moins, nous pouvons les affiner suite à la critique et, en même temps, accroître leur résistance cumulative à cette critique. À terme, l'écriture amplifie l'inertie des représentations sociales (tradition, routine) en même temps qu'elle s'avère en être l'instrument incontournable (le meilleur moyen d'infléchir une représentation est aujourd'hui l'écriture)». La question essentielle aux sociologues et politistes est celle de la définition des personnes qui ont le droit, le pouvoir de favoriser certaines représentations sociales et d'en censurer d'autres [Noiriel, 2005]. Il importe de ne pas exclure cette dimension de la réflexion sur le territoire, car elle «pose [...] la question de l'articulation entre représentations, technique de l'intellect et culture». {{[Guichard, 2008a], p. 87.}} Cependant, l'idéologie ne détermine pas toutes les représentations. On l'a vu précédemment, des représentations peuvent nous résister: l'idée d'espaces de dimensions élevées peut heurter le bon sens, comme l'idée que conflits et cultures sont essentiels à la territorialisation de ces espaces peut gêner des ingénieurs qui n'ont aucune difficulté à se projeter en des espaces non-euclidiens. J'insistais sur ce point qui peut accroître les malentendus quant au territoire -chacun en ayant souvent une définition propre. Mais cette remarque vaut aussi pour la notion de réalité, biaisée par nos savoirs, notre culture. Si on fouille nos représentations relatives à cette réalité, on constate qu'elles sont fort ambiguës. En m'appuyant sur les travaux d'Henri Desbois [Desbois, 2006b], je remarquais que la ville «avec ses architectures, ses galeries, son instrumentation technique (caméras, interphones, sémaphores, etc.) relève autant de la matérialité que de l'imaginaire. {{[Guichard, 2008a], p. 88.}} La ville est à la fois un ensemble de pratiques vécues et de représentations qui peuvent en être fort éloignées, et la circulation entre les unes et les autres est parfois à l'origine de réaménagements urbains». Les systèmes d'information géographique et le cinéma amplifient l'ambiguïté. Les films décrivent souvent comme réel ce qui est fantasmé: «la ville devient aussi le lieu de l'effacement du réel au profit de son simulacre, avec ce mélange de surveillance généralisée et de dissimulation potentielle, crainte ou espérée, où le réel n'est plus distinguable, non pas du virtuel, mais de la fiction. Comme l'est Los Angeles aujourd'hui, qui devient décor réel de toutes les fictions cinématographiques qui s'y tournent». Ainsi une question apparemment de bon sens renvoie-t-elle directement aux mythes, aux fictions qui nous nourrissent. En un mot, à la culture. Raison de plus d'étudier attentivement cette dernière. Certes, la culture est mal définie, mal abordée, surtout quand elle est mise en relation avec l'internet. Mais c'est son lot, et la dimension ségrégative de la culture est bien connue des anthropologues [Leroi-Gourhan, 1964,Lévi-Strauss, 2005]. Je commençais alors à préciser les trois dimensions de la culture détaillées au point 1, définie comme «comme la somme des représentations sociales, des plus concrètes aux plus itérées, {{[Guichard, 2008a], p. 90.}} d'un collectif relativement large et organisé: l'ensemble des choses pensées collectivement qui a vocation à nous offrir une image cohérente du monde». Cette définition intègre les notions de culture large (culture3) comme spécialisée (culture1) et d'appréhender son dynamisme comme son inertie, du fait des représentations qu'elle sollicite, qui elles, évoluent lentement. Le troisième terme de la culture (la culture2, adaptative, proche de l'habitus) apparaît quand on met en correspondance la culture1 (le learned behaviour de Ruth Benedict) avec l'usage préférentiel de certains des éléments de l'outillage dont elle nous équipe: «dans cette boîte, bien des outils seront inutilisés, car nous n'avons pas appris à nous en servir, et d'autres le seront trop, parce qu'on nous a surtout enseigné leur usage. Nous comprenons là, comme le rappelle Jack Goody269, à quel point l'écriture transforme le processus d'apprentissage: {{[Guichard, 2008a], p. 91.}} en élargissant la nature et le volume du mode d'emploi des outils, en nous les rendant plus proches, en nous invitant à nous interroger sur leurs statuts (matériel, symbolique, réflexif, etc.)». Il m'était alors aisé de conclure: «ainsi la culture d'une personne est la somme de ses représentations; l'outil essentiel de leur fabrication, de leur transmission, de leur renforcement et de leurs transformations est l'écriture, la technologie de l'intellect construite depuis quelques millénaires et qui a acquis un intense développement depuis une centaine d'années. {{[Guichard, 2008a], p. 92.}} De ce fait, l'écriture contribue à fabriquer la culture, à la transformer, voire à en étouffer des pans entiers». Je rappelais malgré tout nos difficultés à appréhender en ces termes les relations entre pensée et technique, entre culture et écriture, pris que nous sommes dans un ordre du discours: «nous sentons que les mots nous manquent pour expliquer plus en détail ces relations entre outil et concept, entre technique et pensée: nous réalisons alors combien nous sommes pris dans une culture, {{[Guichard, 2008a], p. 92.}} qui relève autant de la philosophie d'avant le XXe siècle que des conceptions de l'industrie mécanique du XIXe siècle». Et je proposais que les sciences de l'information et de la communication s'emparent de cette problématique féconde, qu'elles étaient à même de traiter du fait de leur double compétence, technique et anthropologique: «Il me semble que le temps est venu de profiter de ces deux types de compétences, de les dépasser en nous interrogeant sur le caractère artificiel -sur-naturel, virtuel?- des frontières des deux sous-disciplines; et de les unifier en nous rappelant que l'opposition entre spiritualité de la culture et matérialité de la technique ne tient pas, {{[Guichard, 2008a], p. 92.}} en choisissant des «objets» tels que le territoire, qui posent explicitement la question de la construction mentale et matérielle, singulière et collective, réelle et imaginée du monde». C'est cette interrogation qui m'aura permis de développer l'idée d'une épistémologie des sciences de l'information et de la communication dans le point 2.3.2.3.4 Conclusion
C'est ainsi que la cartographie, souvent présentée comme une technique ancillaire, conduit à la réflexivité: elle précise en quoi l'écriture et ses usages permettent de décrire le monde; elle met en perspective des évolutions disciplinaires en relation avec la méthodologie qu'elle suscite. Le regard sur ces usages de l'écriture explicite une circulation entre cette technique, ses praticiens -qui ne sont pas loin de se confondre avec les lettrés- et la culture. Cette dernière s'entend de deux façons. En un sens anthropologique, unitaire malgré les tensions entre approches universaliste et relativiste [Descola, 2005], qui rappelle ses fonctions, son statut de technique. En un sens sociologique, qui renvoie à sa pluralité, y compris dans un même pays: aux cultures de divers groupes sociaux (qu'on peut parfois dénommer classes) et à leurs possibilités d'imposer certains archétypes. Ce qui ouvre la voie à deux autres subdivisions, à l'entrelacement manifeste: une culture dominante270, qui affirme son héritage et sa volonté de le développer, et une culture en construction, qui s'émancipe de la première, l'infléchit, voire la renforce, du fait des compétences scribales de ses auteurs et de l'imagination que ces dernières nourrissent -apparaît ici la relation étroite et parfois antagoniste entre littératie et pouvoir. Les partisans du maintien d'anciens savoir-faire et monopoles, les informaticiens qui reconfigurent la spatialité271 pourraient exemplifier ces deux tendances, qui font écho aux culture1 et culture3 précédemment décrites. Dans cette perspective sociologique de rapports de domination entre groupes (qui vaut aussi pour l'anthropologie), se pose la question de qui a le droit de décrire le monde, qui a les moyens d'imposer ses propres énonciations. Ce qui renvoie au concept d'ordre de discours, avec ici aussi, une tension entre contraintes politiques et épistémologiques. Ce n'est pas que les univers discursifs de la science soient débarrassés des idéologies. Mais, à des propos mûs par des intérêts explicites (orienter l'étude des usages vers les pratiques du grand public pour évaluer sa propension à la consommation et pour alimenter des narrations du monde qui satisfassent au libéralisme) s'ajoute la difficulté à s'extraire d'un cadre rationnel peaufiné par les siècles: tout comme le concept d'algèbre était impensable avant Descartes (même si on peut faire l'histoire de son ébauche), nos aptitudes à conjuguer de façon rigoureuse les notions de technique et de culture, de technique et de pensée restent balbutiantes. Les premières tentatives en ce sens n'ont qu'une soixantaine d'années [Malinowski, 1968]. Elles sont plus récentes (et encore moins connues) quand ces articulations s'appliquent aux relations entre science et technique (ex.: mathématiques et écriture). On pourrait s'étonner que les deux précédents paragraphes proposent, plus que la lecture d'un monde «objectif», extérieur à nous-mêmes, une grille d'analyse de notre monde d'humains -intimement liée à nos capacités, à nos faiblesses, à l'histoire de nos concepts. Cela donne une preuve supplémentaire de la fécondité d'une approche scientifique de l'internet. C'est en enquêtant sur cette chose que j'ai pu profiter des apports heuristiques de la cartographie, en poussant l'écriture électronique et réticulée à ses limites272. Autrement dit, les dimensions scribales, méthodologiques et culturelles de la cartographie contemporaine me sont apparues comme des conséquences des propriétés de l'internet273. Ensuite, l'étude de l'internet m'a permis de préciser la notion de technique, et montrer l'impossibilité de la dégager des discours à son sujet. De même pour ses usages: toute technique se définit par ses pratiques, par la façon dont elles alimentent des discours (et réciproquement) -par sa nature humaine. Un tel constat, qui relève de l'évidence pour l'internet, est rendu difficile du fait des contraintes exercées par les deux grands types de régimes discursifs précisés au paragraphe précédent, qui expliquent les regards souvent biaisés sur une technique et ses pratiques. Cela dit, le caractère inextricable des catégories technique, usages, discours, que j'ai appelée «tresse», a peut-être valeur de théorème, à l'instar de l'équivalence technique-culture. Et si ces assertions sont vérifiées, en découlera une conclusion rarement évoquée: l'impossibilité d'objectiver toute technique -ce que j'ai montré dans le cas de l'internet. Enfin, cet intérêt pour les outils-concepts qui nous permettent d'appréhender le monde résulte directement de l'étude de l'internet. En effet, l'internet est l'affaire (l'aventure, pourrait-on dire) de l'écriture, poussée à des limites peut-être jamais atteintes: industrielles, algorithmiques, collectives, pervasives. C'est aussi pour cela que l'internet fait tant couler d'encre, sur le papier comme sur lui-même: parce que le développement de notre instrumentation intellectuelle, réalisé par nous, humains, avec nos peurs et nos espoirs, nos imaginations et nos passions routinières, nos soifs de liberté et de pouvoir, nos contraintes, nos cultures et nos croyances, nous confronte désormais à une hybridation surprenante de l'extérieur et de l'intérieur, de l'outil et de la psyché: de l'objet et du sujet. Ainsi, l'étude de l'internet s'avère doublement indispensable: non seulement pour comprendre cet «instrument fait monde» [Mathias, 2009], mais pour comprendre comment nous évoluons, nous, humains, dans cet univers qui n'est jamais que le nôtre.Perspectives
J'ai fait le choix d'être concis dans l'évocation des thèmes que je compte approfondir, avec mes futurs étudiants, et avec mes actuels et futurs collègues. J'ai en effet précisé à de nombreuses reprises, dans ce mémoire comme dans ses notes, des pistes de recherche. De même pour les méthodes et concepts que je compte faire fructifier. Il me semble d'autant déplacé d'en faire ici la liste qu'à mes yeux, l'HDR n'est pas une clôture, mais un seuil: une promesse -dont la soutenance témoigne- de futurs ouvrages, de futurs travaux collectifs.Technique, écriture et culture
Le coeur de mes centres d'intérêt restera longtemps, je suppose, l'écriture et ses articulations avec les savoirs, la technique et la culture. Et le choix de l'internet comme terrain devrait pour encore de nombreuses années stimuler cette approche. Les raisonnements développés dans ce mémoire d'habilitation perdraient de leur pertinence si, après avoir insisté sur la technicité des savoirs, je présentais mes projets futurs de la façon la plus théorique. Pour le dire autrement, ce programme de travail centré sur la technologie de l'intellect ne peut évacuer une méthodologie à la fois pragmatique et réflexive. Aussi me semble-t-il utile de garantir une articulation entre concepts et technique, de ne pas réduire cette dernière à la somme de ses produits manufacturés, et d'expliciter les apports heuristiques des gymnastiques intellectuelles favorisées par la pratique de l'écriture. Et si la relation entre technique et culture m'apparaît fructueuse, je pense toutefois qu'il faille résister à la tentation d'embrasser trop tôt les problématiques les plus largement collectives. Il m'apparaît plus fécond de s'interroger tout d'abord sur sa propre culture, ses déterminants et son évolution: en quoi mes savoirs sont-ils dynamiquement transformés par l'outillage mental qui joue le rôle d'intermédiaire dans mes apprentissages ainsi que dans les représentations qui leur servent d'arrière-plan? On l'a vu, je ne crois pas en l'immanence d'idées qui, pour s'affermir, solliciteraient spontanément le service d'une technique, d'une méthode. Comprendre comment les unes et les autres s'enchevêtrent, comment des lacunes, mais aussi des excès d'habileté contraignent ses propres approches scientifiques, me semble être une façon féconde de dessiner et donc de repérer son territoire intellectuel. Ce point de départ a trois conséquences. La première renvoie à la place de la science dans l'espace public: nombre de chercheurs, d'étudiants, d'ingénieurs et de professionnels tireraient profit de l'appropriation d'une telle explicitation pour mieux mesurer l'incidence de l'informatique sur leurs actes et métiers. Encore faut-il que des chercheurs l'impulsent. La seconde ouvre le champ à une anthropologie des scientifiques: j'ai plusieurs fois signalé les apports d'une étude attentive des gestes d'experts en littératie électronique. Il me semble difficile de théoriser l'écriture sans en étudier au plus près les pratiques: sans terrain. Dans une dynamique perspective, l'étude des mondes lettrés d'aujourd'hui (érudits, informaticiens, etc., chercheurs ou non) apparaît comme le troisième corollaire. En ayant conscience que des savoirs me résistent comme ils résistent à d'autres, je me vois alors impliqué dans une démarche collective de défrichements de conceptualisations et de techniques qui ont toutes des qualités, des défauts, et une histoire: des formations discursives entrelacées, parfois antagonistes, d'autres fois parallèles; des cadres de pensée à la fois souples et rigides, contraignants et disponibles à l'exploration, qui s'articulent avec des méthodes et des outils. Ceci invite à conduire une démarche épistémologique qui intègre la sociologie de la recherche (opportunités, restrictions, conflits, tensions interdisciplinaires, relation à l'État, etc.) et qui dépasse le raisonnement axiologique: en tentant de comprendre les tensions, les compétitions, les articulations entre diverses représentations du monde. Celles de Jean-Marie Gustave Le Clézio comme celles de Pierre Vernant ou d'Andrey Nikolaevich Kolmogorov. Le propos est de comprendre comment le monde est écrit autant que décrit, comment une circulation entre des concepts et des questionnements, entre des hypothèses, des habitudes méthodologiques et des objets fait émerger ou oublier des champs de savoir, des catégories d'appréhension de ce monde, tout cela en étant attentif aux outils qui permettent le déploiement de ces architectures sensibles et conceptuelles. Le fait de penser l'ensemble de ces sculpteurs de la technologie de l'intellect -célèbres ou humbles passeurs- comme des collectifs confrontés à l'usage et au déploiement d'instruments complexes (dont l'écriture) et de leurs dérivés (de la culture des mathématiciens à l'imaginaire des poètes) permet d'aborder une histoire comparée des sciences qui se confronte avec l'idée de vérité. Ce dernier mot n'est pas commode, mais je ne voudrais pas l'esquiver. La notion de vérité peut n'être que relative et locale274, elle peut aussi être générale275. L'épistémologie serait cette capacité à penser la vérité dans son acception à la fois la plus large (analyser la science de façon réflexive) et la plus fine (comprendre la singularité d'une formation discursive donnée). Et le fait d'intégrer la notion de technique intellectuelle dans l'univers de l'épistémologie permettrait de dépasser le contexte de ses tensions et controverses et de tirer pleinement profit de son histoire spiritualiste comme matérialiste. En voyant comment le savant est pris dans des cultures et des formations discursives, comment il les infléchit, on comprend que la continuité entre son activité la plus psychique, l'outillage mental à sa disposition et les normes et représentations qu'il renforce ou recompose vaut pour l'humanité tout entière. Ici apparaît une toute autre dimension des collectifs: la notion de culture, en son sens le plus large (qui intègre les idéologies et les croyances). Toute culture est aujourd'hui profondément exprimée et reconfigurée par l'écriture276. Ici, une anthropologie universelle qui aborde conjointement les humains, leurs cultures et leurs techniques devient possible. On connaît la meilleure façon de tirer profit d'un tel questionnement: choisir un «terrain», l'explorer au mieux. Nombre d'entre eux sont accessibles aujourd'hui (services informatiques, professionnels de la numérisation du «patrimoine», usages marginaux, laboratoires, mondes lettrés, etc.), sinon aisés à construire: discours (politiques, de militants, d'ingénieurs, de revues savantes, etc.), objets (câbles de l'internet, etc.) ou savoirs (ex.: la combinatoire, la programmation, l'histoire, etc.). Leur fécondité est avant tout liée au regard que l'on porte sur eux277. Et, avec ou sans transformations de l'écriture, le chercheur qui étudie ces espaces d'enquêtes est conduit à renouveler ou approfondir ses connaissances, et à comprendre comment elles (re) structurent son regard scientifique.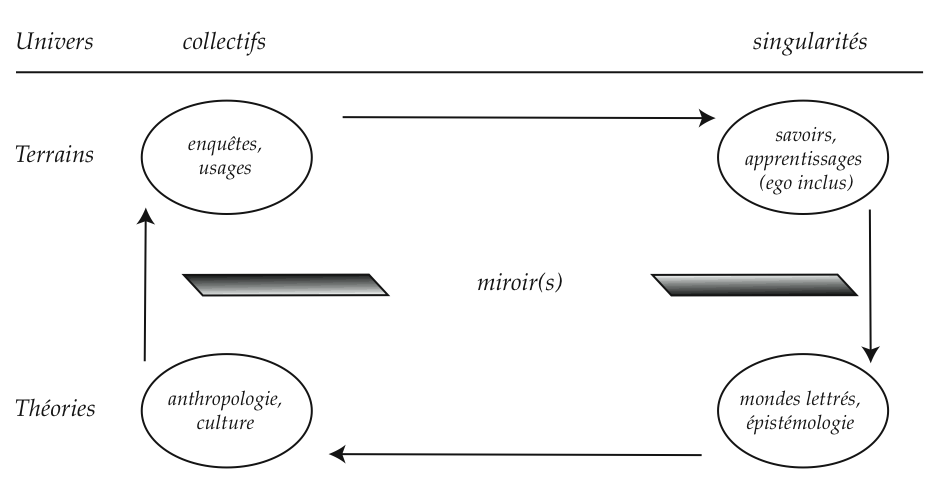
Mise en oeuvre
J'ai à diverses reprises rappelé ma difficulté à imaginer un travail scientifique autre que collectif278. La fondation de l'Atelier Internet, celle de l'équipe Réseaux, Savoirs & Territoires, les séminaires en lesquels je me suis impliqué ou que j'ai mis sur pied témoignent de cette évidence, que je partage aisément avec d'anciens ou nouveaux collègues. Le colloque Écritures: sur les traces de Jack Goody, comme mon séminaire à l'Enssib, l'Atelier Internet Lyonnais, m'ont prouvé que le déracinement géographique n'empêche nullement de prolonger le tissage d'un réseau scientifique ni de le déployer au sein d'une discipline accueillante. C'est ce réseau que je compte consolider puis élargir. En l'occurrence, les problématiques que j'aborde pourraient donner à des personnes venant de disciplines variées le goût d'approfondir, par le biais de l'écriture contemporaine, les relations entre technique et culture. Je pense tout d'abord aux «littéraires», dont le nombre de postes se raréfie. Ensuite à des physiciens, au premier lieu desquels les spécialistes de l'information, dont l'audience s'accroît précisément du fait de leur habileté scribale. Et aussi aux spécialistes des sciences humaines, des sciences exactes et des disciplines qui, comme les sciences de l'information et de la communication, se positionnent à la croisée des premières et des secondes. Enfin, à toutes les personnes, chercheurs chevronnés comme jeunes étudiants, qui cherchent à préciser en quoi l'écriture et ses littératies contribuent aux descriptions du monde et de la science. Ce programme est ouvert à tous: il sera ce que nous en ferons, collectivement.Bibliographie
- [Abiteboul et al., 2004]
- ABITEBOUL, S., COBENA, G., MIGUET, L. et PREDA, M. (2004). Calcul en ligne et adaptatif de l'importance des pages web. In [Guichard, 2004b], pages 50-74.
- [Babou, 2008]
- BABOU, I. (2008). De l'image comme catégorie à une approche communicationnelle globale. Communication & Langages, 157: 37-48.
- [Babou et Le Marec, 2003]
- BABOU, I. et Le MAREC, J. (2003). De l'étude des usages à une théorie des «composites»: objets, relations et normes en bibliothèque. In SOUCHIER, E., JEANNERET, Y. et Le MAREC, J., éditeurs : Lire, écrire, récrire. Objets, signes et pratiques des médias informatisés, pages 233-299. Bibliothèque publique d'information, Paris.
- [Baccelli, 2006]
- BACCELLI, F. (2006). Les réseaux de communication. La lettre de l'Académie des sciences, 19: 7-10.
- [Bachelard, 1963]
- BACHELARD, G. (1963). Le nouvel esprit scientifique. Presses Universitaires de France, Paris. Première éd.: 1934.
- [Baratin et Jacob, 1996]
- BARATIN, M. et JACOB, C., éditeurs (1996). Le pouvoir des bibliothèques. Albin Michel, Paris.
- [Barthes, 1980]
- BARTHES, R. (1980). La chambre claire. Cahiers du cinéma - Gallimard - Seuil, Paris.
- [Barthélemy et al., 2002]
- BARTHéLEMY, M., GONDRAN, B. et GUICHARD, É. (2002). Large scale cross-correlations in internet traffic. Physical Review E. vol. 66, 056110.
- [Barthélemy et al., 2003]
- BARTHéLEMY, M., GONDRAN, B. et GUICHARD, É. (2003). Spatial structure of the internet traffic. Physica A, pages 633-642. num. 319.
- [Bautier, 2008]
- BAUTIER, R. (2008). L'impérialisme des statistiques de réseaux. Médiation et information, 28: 129-138.
- [Benoist, 2001]
- BENOIST, J. (2001). En quoi la géographie peut-elle importer à la philosophie? In BENOIST, J. et MERLINI, F., éditeurs : Historicité et spatialité. Le problème de l'espace dans la pensée contemporaine, pages 221-247. Librairie Philosophique J. Vrin, Paris.
- [Bertin, 1967]
- BERTIN, J. (1967). Sémiologie graphique. Les diagrammes - Les réseaux - Les cartes. Mouton, Gauthier-Villars, Paris, La Haye.
- [Blanchot, 1955]
- BLANCHOT, M. (1955). L'espace littéraire. Gallimard (nrf), Paris.
- [Boltanski et Chiapello, 1999]
- BOLTANSKI, L. et CHIAPELLO, E. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme. Gallimard, Paris.
- [Bougnoux, 1998]
- BOUGNOUX, D. (1998). Introduction aux Sciences de la Communication. La Découverte, Paris.
- [Bourdieu, 1984]
- BOURDIEU, P. (1984). Homo academicus. Éditions de Minuit, Paris.
- [Bourdieu, 2001a]
- BOURDIEU, P. (2001a). Langage et pouvoir symbolique. Fayard, Paris.
- [Bourdieu, 2001b]
- BOURDIEU, P. (2001b). Science de la science et réflexivité. Raisons d'agir, Paris.
- [Callon, 2006]
- CALLON, M. (2006). Sociologie de l'acteur réseau. In AKRICH, M., CALLON, M. et LATOUR, B., éditeurs : Sociologie de la traduction. Textes fondateurs, pages 267-276, Paris. Mines Paris. Les Presses.
- [Caron, 1998]
- CARON, F. (1998). La naissance d'un système technique à grande échelle. le chemin de fer en france (1832-1870). Annales Histoire, Sciences Sociales, 4-5: 859-885.
- [Chateauraynaud, 2003]
- CHATEAURAYNAUD, F. (2003). Prospéro. Une technologie littéraire pour les sciences humaines. CNRS éditions, Paris.
- [Chevalier, 2004]
- CHEVALIER, Y. (2004). Le savant, le sorcier et l'artiste. le constructivisme en question. Communication & Langages, 139: 5-15.
- [Cotte, 2009]
- COTTE, D. (2009). Système, information, média: le SI comme objet des SIC. Communication & Langages, 160: 39-48.
- [Damien, 1995]
- DAMIEN, R. (1995). Bibliothèque et État. Naissance d'une raison politique dans la France du XVIIe siècle. Presses Universitaires de France, Paris.
- [de Certeau, 1975]
- de CERTEAU, M. (1975). L'écriture de l'histoire. Gallimard, Paris.
- [de Certeau, 1980a]
- de CERTEAU, M. (1980a). L'invention du quotidien. I: Arts de faire. Union générale d'éditions, Paris. Éd. établie et présentée par Luce Giard et Pierre Mayol.
- [de Certeau, 1980b]
- de CERTEAU, M. (1980b). L'invention du quotidien. II: Habiter, cuisiner. Union générale d'éditions, Paris. Éd. établie et présentée par Luce Giard et Pierre Mayol.
- [Desbois, 2001]
- DESBOIS, H. (2001). Les territoires de l'internet: suggestions pour une cybergéographie. In [Guichard, 2001], pages 253-263.
- [Desbois, 2006a]
- DESBOIS, H. (2006a). L'internet et la mondialisation. In LEFORT, I. et MORINIAUX, V., éditeurs : La mondialisation. Éd. du Temps, Nantes.
- [Desbois, 2006b]
- DESBOIS, H. (2006b). Présence du futur. le cyberespace et les imaginaires urbains de science-fiction. Géographie et cultures, 61: 121-138. http://barthes.enssib.fr/articles/Desbois-presence-futur.pdf.
- [Descola, 2005]
- DESCOLA, P. (2005). Par-delà nature et culture. Gallimard, Paris.
- [Donnat, 2009]
- DONNAT, O. (2009). Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique. éd. La Découverte & Ministère de la culture et de la communication, Paris.
- [Duclert et Rasmussen, 2002]
- DUCLERT, V. et RASMUSSEN, A. (2002). Les revues scientifiques et la dynamique de la recherche. In La belle époque des revues, pages 237-254. éd de l'IMEC.
- [Edgerton, 1998]
- EDGERTON, D. (1998). De l'innovation aux usages. Dix thèses éclectiques sur l'histoire des techniques. Annales Histoire, Sciences Sociales, 4-5: 815-837. English version: http://www3.imperial.ac.uk/portal/pls/portallive/docs/1/51753.DOC.
- [Evans-Pritchard, 1973]
- EVANS-PRITCHARD, E. E. (1973). Parenté et mariage chez les nuer. Payot, Paris. 1e édition: 1951. P. 140 et suivantes pour les mariage entre femmes.
- [Faucheux, 2008]
- FAUCHEUX, M. (2008). La technique et les SIC. Éléments d'un savoir de l'artificiel. Communication & Langages, 157: 105-117.
- [Fayet-Scribe, 2000]
- FAYET-SCRIBE, S. (2000). Histoire de la documentation en France. CNRS éditions.
- [Flichy, 2001]
- FLICHY, P. (2001). L'imaginaire d'internet. La Découverte, Paris.
- [Forest, 2004]
- FOREST, D. (2004). L'imaginaire du code informatique. Communication & Langages, 139: 75-85.
- [Foucault, 1969]
- FOUCAULT, M. (1969). L'archéologie du savoir. Gallimard, Paris.
- [Fridel, 2006]
- FRIDEL, Y. (2006). Internet au quotidien: un Français sur quatre. Insee première, 1076. URL: www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP1076.pdf.
- [Gauthier, 2004]
- GAUTHIER, G. (2004). Journalisme et réalité: l'argument constructiviste. Communication & Langages, 139: 17-25.
- [Genette, 1987]
- GENETTE, G. (1987). Seuils. Le Seuil, Paris.
- [Gille, 1978]
- GILLE, B. (1978). Histoire des techniques. Gallimard (La Pléiade), Paris.
- [Goody, 1994]
- GOODY, J. P. (1994). Entre l'oralité et l'écriture. Presses Universitaires de France, Paris.
- [Goody, 2000]
- GOODY, J. P. (2000). The Power of the Written Tradition. Smithsonian Institution Press, Washington and London.
- [Goody, 2003]
- GOODY, J. P. (2003). La peur des représentations. Éd. La Découverte, Paris.
- [Grafton, 2007]
- GRAFTON, A. (2007). Vers une histoire sociale de la critique textuelle. In [Jacob, 2007], pages 556-582. Volume I.
- [Granovetter, 1973]
- GRANOVETTER, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78: 1360-1380.
- [Gribaudi, 1998]
- GRIBAUDI, M., éditeur (1998). Espaces, temporalités, stratifications. Exercices sur les réseaux sociaux. Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, Paris.
- [Guichard, 1990]
- GUICHARD, É. (1990). Sud-Soudan: les ONG dans la guerre. Politique Africaine, pages 171-175. n° 39.
- [Guichard, 2001]
- GUICHARD, É., éditeur (2001). Comprendre les usages de l'Internet. Éditions Rue d'Ulm, Paris.
- [Guichard, 2002]
- GUICHARD, É. (2002). L'internet: mesures des appropriations d'une technique intellectuelle. Thèse de doctorat, École des hautes études en sciences sociales, Paris. http://barthes.ens.fr/articles/theseEG.
- [Guichard, 2003a]
- GUICHARD, É. (2003a). Does the `Digital Divide' Exist? In van SETERS, P., de Gaay FORTMAN, B. et de RUIJTER, A., éditeurs : Globalization and its new divides: malcontents, recipes, and reform, pages 69-77. Dutch University Press, Amsterdam. Traduction française à l'URL: http://barthes.enssib.fr/articles/Guichard-Digital-Divide.html.
- [Guichard, 2003b]
- GUICHARD, É. (2003b). Mesures de la fracture numérique. In PROULX, S. et JAURéGUIBERRY, F., éditeurs : Internet, nouvel espace citoyen?, pages 37-47. L'Harmattan.
- [Guichard, 2004a]
- GUICHARD, É. (2004a). L'internet, une technique intellectuelle. In [Guichard, 2004b], pages 19-49. http://barthes.enssib.fr/articles/Guichard-MI.html.
- [Guichard, 2004b]
- GUICHARD, É., éditeur (2004b). Mesures de l'internet. Les Canadiens en Europe, Paris.
- [Guichard, 2005]
- GUICHARD, É. (2005). L'atlasclio. un atlas en ligne interactif de l'immigration. In RYGIEL, P. et NOIRET, S., éditeurs : Les Historiens, leurs revues et Internet (France, Espagne, Italie), pages 93-102. Publibook Université, Paris.
- [Guichard, 2006]
- GUICHARD, É. (2006). L'internet: retrouvailles de l'écriture et de la cartographie. Revue de la Bibliothèque nationale de France, 24: 51-55. http://barthes.ens.fr/articles/Guichard-BNF-carto-web.pdf.
- [Guichard, 2007a]
- GUICHARD, É. (2007a). Des atlas en svg pour analyser les élections françaises. M@ppemonde. http://mappemonde.mgm.fr/num13/articles/art07104.html.
- [Guichard, 2007b]
- GUICHARD, É. (2007b). Géographie de l'internet. In [Jacob, 2007], pages 989-1009. Volume I.
- [Guichard, 2007c]
- GUICHARD, É. (2007c). L'internet et le territoire. Études de Communication, 30: 83-98. Guichard-internet-territoire.pdf.
- [Guichard, 2008a]
- GUICHARD, É. (2008a). Internet, cartes, territoire et culture. Communication & Langages, 158: 77-92. http://barthes.ens.fr/articles/Guichard-internet-culture.pdf.
- [Guichard, 2008b]
- GUICHARD, É. (2008b). L'écriture scientifique: grandeur et misère des technologies de l'intellect. In L'Internet, entre savoirs, espaces publics et monopoles, volume 7-8, pages 53-79, Lyon. Sens-public. Actes du colloque international L'Internet: Espace public et Enjeux de connaissance, Collège International de Philosophie, Paris, 20-21 janvier 2006. http://barthes.enssib.fr/articles/Guichard-CIPH2006.pdf.
- [Guichard, 2010]
- GUICHARD, É. (2010). Le mythe de la fracture numérique. In Éric GUICHARD, éditeur : L'internet: regards croisés (titre provisoire). Presses de l'Enssib (à paraître), Villeurbanne. URL: http://barthes.enssib.fr/articles/Guichard-mythe-fracture-num.pdf.
- [Guichard et Noiriel, 1997]
- GUICHARD, É. et NOIRIEL, G., éditeurs (1997). Construction des nationalités et immigration dans la France contemporaine. Presses de l'ENS, Paris.
- [Habermas, 1973]
- HABERMAS, J. (1973). La technique et la science comme <<idéologie>>. Tel, Gallimard, Paris. Traduit par Jean-René Ladmiral.
- [Hernu, 2008]
- HERNU, P. (2008). Les web et les organisations mafieuses: mythes et réalités. Cahiers de la sécurité, no6: 9-18. URL: http://www.cahiersdelasecurite.fr/index.asp?LETTRE_ID=46&LETTRE_CRYPT=NJ51MV.
- [Herrenschmidt, 1999]
- HERRENSCHMIDT, C. (1999). Écriture, monnaie, réseaux. inventions des anciens, inventions des modernes. Le Débat, 106: 37-65. http://barthes.enssib.fr/articles/Herrenschmidt-ecr-monnaie-reseaux.html.
- [Herrenschmidt, 2000]
- HERRENSCHMIDT, C. (2000). L'internet et les réseaux. Le Débat, 110.
- [Herrenschmidt, 2007]
- HERRENSCHMIDT, C. (2007). Les trois écritures. Langue, nombre, code. Gallimard, Paris.
- [Hughes, 1998]
- HUGHES, T. P. (1998). L'histoire comme systèmes en évolution. Annales Histoire, Sciences Sociales, 4-5: 839-857.
- [Jacob, 1993]
- JACOB, C. (1993). L'Empire des cartes: Approche théorique de la cartographie à travers l'histoire. Belin, Paris.
- [Jacob, 1996]
- JACOB, C. (1996). Lire pour écrire: navigations alexandrines. In [Baratin et Jacob, 1996], pages 47-83.
- [Jacob, 2007]
- JACOB, C., éditeur (2007). Lieux de Savoir. Espaces et communautés. Albin Michel, Paris. Volume I.
- [Jeanneret et Labelle, 2004]
- JEANNERET, Y. et LABELLE, S. (2004). Le texte de réseau comme méta-forme. In Actes en ligne du colloque Culture, savoirs, supports, médiations: le texte n'est-il qu'une métaphore?, Lille. URL: http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr/fichierspdf/pubenligne/2004francogrec/jeanneret.pdf.
- [Johansson, 2000]
- JOHANSSON, T. D. (2000). Visualization in cyber-geography: reconsidering cartography's concept of visualization in currrent usercentric cybergeographic cosmologies. http://www.casa.ucl.ac.uk/cyberviz.pdf.
- [Kvasny et Truex, 2001]
- KVASNY, L. et TRUEX, D. (2001). Defining away the digital divide: a content analysis of institutional influences on popular representations of technology. In RUSSO, N. L., FITZGERALD, B. et DEGROSS, J. I., éditeurs : IFIP Conference Proceedings, volume 194, pages 399-414, Deventer, The Netherlands. Kluwer, B.V.
- [Latour, 1989]
- LATOUR, B. (1989). La science en action. Collection Folio, Gallimard, Paris.
- [Latour, 1996]
- LATOUR, B. (1996). Ces réseaux que la raison ignore: laboratoires, bibliothèques, collections. In [Baratin et Jacob, 1996], pages 23-46.
- [Latour, 2001]
- LATOUR, B. (2001). L'espoir de Pandore. La Découverte (Armillaire), Paris. Trad. par D. Gille (orig. 1999, Harvard University Press).
- [Latour, 2006]
- LATOUR, B. (2006). Changer de société, refaire de la sociologie. La Découverte, Paris.
- [Latour, 2007]
- LATOUR, B. (2007). Pensée retenue, pensée distribuée. In [Jacob, 2007], pages 605-615. Volume I.
- [Le Guel et al., 2004]
- LE GUEL, F., PéNARD, T. et SUIRE, R. (2004). Une double fracture numérique. In [Guichard, 2004b], pages 115-125.
- [Le Marec, 2001]
- Le MAREC, J. (2001). L'analyse des usages en construction: quelques points de méthode. In [Guichard, 2001], pages 146-155.
- [Le Marec, 2002]
- Le MAREC, J. (2002). Ce que le <<terrain>> fait aux concepts: Vers une théorie des composites. Habilitation à diriger des recherches. Université Paris 7.
- [Leroi-Gourhan, 1964]
- LEROI-GOURHAN, A. (1964). Le geste et la parole. I. Technique et langage. Albin Michel, Paris.
- [Lessig, 1998]
- LESSIG, L. (1998). Jefferson's nature. http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/NatureD3.pdf.
- [Lévi-Strauss, 2005]
- LéVI-STRAUSS, C. (2001, 2005). Race et Histoire, Race et Culture. Albin Michel / Éditions UNESCO, Paris. Note sur Race et Culture. Première publication: 1971. pp. 123-173 de l'édition évoquée.
- [Malinowski, 1968]
- MALINOWSKI, B. (1968). Une théorie scientifique de la culture. Points, François Maspero, Paris. Premières éditions: 1941 pour l'article, 1944 pour l'ouvrage du même nom; texte en ligne: http://classiques.uqac.ca/classiques/malinowsli/theorie_culture.
- [Martin, 1996]
- MARTIN, H.-J. (1996). Histoire et pouvoirs de l'écrit. Albin Michel, Paris. Seconde édition. Avec la collaboration de Bruno Delmas.
- [Martin, 2003]
- MARTIN, O. (2003). Les mathématiques dans l'écriture en sciences humaines. Évolutions textuelles, transformations conceptuelles et épistémologiques. In BERTHELOT, J.-M., éditeur : Figures du texte scientifique, pages 193-223, Paris. Presses Universitaires de France.
- [Mathias, 2002]
- MATHIAS, P. (2002). La chose internet. In GUICHARD, É. et LAJOIE, J., éditeurs : Odyssée Internet: enjeux sociaux, pages 41-59. Presses de l'Université du Québec.
- [Mathias, 2008]
- MATHIAS, P. (2008). Des libertés numériques. Presses universitaires de France, Paris.
- [Mathias, 2009]
- MATHIAS, P. (2009). Qu'est-ce que l'Internet? Vrin, Paris.
- [Mattelart, 1997]
- MATTELART, A. (1997). L'invention de la communication. La Découverte, Paris.
- [Mattelart, 2009]
- MATTELART, A. (2009). Histoire de la société de l'information. La Découverte, Paris. éd. antérieures: 2001, 2003, 2006.
- [Noiriel, 2005]
- NOIRIEL, G. (2005). Les fils maudits de la République. L'avenir des intellectuels en France. Fayard, Paris.
- [Palsky, 1996]
- PALSKY, G. (1996). Des chiffres et des cartes. La cartographie quantitative au XIXe siècle. CTHS (Comité des travaux historiques et scientifiques), Paris.
- [Pasco, 2001]
- PASCO, G. (2001). Napster, dispositif socio-technique ou communauté de partage? In [Guichard, 2001], pages 230-252.
- [Perriault, 1989]
- PERRIAULT, J. (1989). Logique de l'usage. Essai sur les machines à communiquer. Flammarion, Paris.
- [Pestre, 1996]
- PESTRE, D. (1996). La reconstruction des sciences physiques en France après la Seconde Guerre mondiale. des réponses multiples à une crise d'identité (chapitre 1). Réseaux, Hors Série 14 no1: 21-42. URL: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reso_0984-5372_1996_hos_14_1_3666.
- [Pestre, 2005]
- PESTRE, D. (2005). Recherche publique, innovation et société aujourd'hui en France. Le Débat, 134: 76-91.
- [Petrucci, 1990]
- PETRUCCI, A. (1990). La lecture des clercs. In [Universalis, 1990], pages 266-267.
- [Pimienta, 2007]
- PIMIENTA, D. (2007). Fracture numérique, fracture sociale, fracture paradigmatique. http://funredes.org/mistica/francais/cyberotheque/thematique/fracture_paradigmatique.pdf.
- [Rallet, 2004]
- RALLET, A. (2004). Présentation. Réseaux, 127-128: 9-15.
- [Rallet et Rochelandet, 2004]
- RALLET, A. et ROCHELANDET, F. (2004). La fracture numérique: une faille sans fondement? Réseaux, 127-128: 21-54.
- [Rastier, 2001]
- RASTIER, F. (2001). Arts et sciences du texte. Presses universitaires de France, Paris.
- [Rebillard, 2007]
- REBILLARD, F. (2007). Le web 2.0 en perspective. Une analyse socio-économique de l'internet. L'Harmattan, Paris.
- [Rieder, 2007]
- RIEDER, B. (2007). Étudier les réseaux comme phénomènes hétérogènes: quelle place pour la «nouvelle science des réseaux» en sciences humaines et sociales? URL: archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/37/95/26/PDF/rieder_nouvelle_science_des_reseaux.pdf.
- [Robert, 2009]
- ROBERT, P. (2009). Une théorie sociétale des TIC. Lavoisier, Paris.
- [Salaün, 2001]
- SALAüN, J.-M. (2001). Documents numériques et universités françaises. In [Guichard, 2001], pages 112-117.
- [Searle, 1998]
- SEARLE, J. (1998). La construction de la réalité sociale. Gallimard, Paris.
- [Sfez, 2002]
- SFEZ, L. (2002). Technique et idéologie. Seuil, Paris.
- [Simondon, 1989]
- SIMONDON, G. (1989). Du mode d'existence des objets techniques. Aubier, Paris. Troisième édition.
- [Souchier, 2004]
- SOUCHIER, E. (2004). Mémoires - outils -langages. vers une «société du texte»? Communication & Langages, 139: 41-52.
- [Souchier, 2007]
- SOUCHIER, E. (2007). Formes et pouvoirs de l'énonciation éditoriale. Communication & Langages, 154: 23-38.
- [Souchier et al., 2003]
- SOUCHIER, E., JEANNERET, Y. et Le MAREC, J., éditeurs (2003). Lire, écrire, récrire. Objets, signes et pratiques des médias informatisés. Bibliothèque publique d'information, Paris.
- [Stiglitz, 2002]
- STIGLITZ, J. E. (2002). La grande désillusion. Fayard, Paris. titre original: Globalization and its discontents.
- [Tardy et al., 2007]
- TARDY, C., JEANNERET, Y. et HAMARD, J. (2007). L'empreinte sociale d'un outil d'écriture: Powerpoint chez les consultants. In TARDY, C. et JEANNERET, Y., éditeurs : L'écriture des médias informatisés. Espaces de pratiques, pages 141-171, Paris. Lavoisier.
- [Universalis, 1990]
- UNIVERSALIS, E., éditeur (1990). Grand Atlas des Littératures. Encyclopæ dia Universalis France, Paris.
- [Vezin, 1990]
- VEZIN, J. (1990). Les supports de l'écrit. In [Universalis, 1990], pages 148-151.
- [Wasserman et Faust, 1994]
- WASSERMAN, K. et FAUST, K. (1994). Social Network Analysis Methods and Applications. Cambridge University Press.
- [Weissberg, 2001]
- WEISSBERG, J.-L. (2001). L'auteur et l'amateur dans le mouvement de fluidification-réception-production. In [Guichard, 2001], pages 73-81.
Références en ligne citées
http://articles.mongueurs.net/comptes-rendus/hack-2007-nl.html http://barthes.enssib.fr/Guichard-Atlasclio.html http://barthes.enssib.fr/Guichard-Atlasclio.pdf http://barthes.enssib.fr/KT http://barthes.enssib.fr/archives/pugwash2002 http://barthes.enssib.fr/archives/pugwash2003/Halifax-Guichard.fr.html http://barthes.enssib.fr/archives/pugwash2003 http://barthes.enssib.fr/articles/Goody-Enssib-AIL-4juin08.pdf http://barthes.enssib.fr/articles/Guichard-CIPH2006.pdf http://barthes.enssib.fr/articles/Guichard-Digital-Divide.html http://barthes.enssib.fr/articles/Guichard-MI.html http://barthes.enssib.fr/articles/Guichard-mythe-fracture-num.pdf http://barthes.enssib.fr/articles/theseEG/theseEGpa4.html http://barthes.enssib.fr/articles http://barthes.enssib.fr/atelier/articles/guichard-mai-98.html http://barthes.enssib.fr/atelier/articles/guichard-presRI-nov96.html http://barthes.enssib.fr/atelier/geo/Tilburg.html http://barthes.enssib.fr/atelier/geo/communesfr.html http://barthes.enssib.fr/atlasclio http://barthes.enssib.fr/clio/revues/AHI/articles/volumes/atl.html http://barthes.enssib.fr/clio http://barthes.enssib.fr/colloque99/presentation.html http://barthes.enssib.fr/colloque99/programme.html http://barthes.enssib.fr/cybergeo/Renater01 http://barthes.enssib.fr/cybergeo/biblio http://barthes.enssib.fr/cybergeo/ripe.eu.anim100.gif http://barthes.enssib.fr/cybergeo/ripe.eu.anim25.gif http://barthes.enssib.fr/cybergeo/ripeanim_poponly100.gif http://barthes.enssib.fr/cybergeo/ripeanim_poponly20.gif http://barthes.enssib.fr/presid2002/cartesnc.html http://barthes.enssib.fr/presid2002 http://barthes.enssib.fr http://clinton3.nara.gov/WH/New/New_Markets-0004/20000417-4.html http://dico.isc.cnrs.fr/ http://eutoscos.web.aol.com/eu_tos_primary/ISO-8859-1/html/ISO-8859-1_575.dat http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_social http://icann.org http://mumsnet.com http://picardp1.mouchez.cnrs.fr/sciences_ex_shs_4.html http://ripe.net/legal/copyright-statement.html http://scholar.google.fr http://sedo.fr/links/showhtml.php3?Id=2423&tracked=&partnerid=&language=fr http://sedo.fr http://servus.christusrex.org/www1/ofm/mad/index.html http://sloan.stanford.edu/mousesite/EngelbartPapers/B5_F18_ConceptFrameworkPt2.html http://uk.zopa.com http://vincentmorin.canalblog.com/archives/2008/11/17/11402371.html http://watch.usnowfilm.com/subtitled http://webmaster.aol.fr/ http://www-poleia.lip6.fr/GIS.COGNITION http://www-rp.lip6.fr/~latapy/Vulg/internet.pdf http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-credoc-2008-101208.pdf http://www.barracuda.com http://www.barracudacentral.org/reputation?ip=x.y.z.t http://www.cisco.com/web/about/ac49/ac20/ac19/ar2008/financial_highlights/index.html http://www.cisco.com/web/about/ac49/ac20/ac19/ar2008/letter_to_shareholders/french.html http://www.cisco.com/web/about/ac49/ac20/ac19/ar2008/letter_to_shareholders/index.html http://www.cmh.ens.fr/hoparticle.php?id_art=232 http://www.cnrtl.fr/definition/quatre-vingts http://www.cnrtl.fr/definition/réflexivité http://www.cnrtl.fr/definition/spatialité http://www.cnrtl.fr/lexicographie/bricolage http://www.cnrtl.fr/lexicographie/technique http://www.cnrtl.fr http://www.couchsurfing.org http://www.credoc.fr/pdf/4p/191.pdf http://www.credoc.fr http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_usages_avances_du_telephone_mobile-9782707158451.html http://www.fabula.org http://www.guideinformatique.com/fiche-consommation_electrique_des_data_centers-846.htm http://www.hannibal-dans-les-alpes.com/table-de-peutinger.htm http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe00.html http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/presidentielle/presidentielle-2002 http://www.internetactu.net http://www.jstor.org http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&dateTexte= http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte= http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432 http://www.lemonde.fr/le-monde-2/article/2008/11/14/qui-tire-les-cables-du-cyberespace_1118902_1004868.html http://www.lentreprise.com/3/3/5/article/16153.html http://www.liens-socio.org/ http://www.macfergus.com/niels/dmca/cia.html http://www.msr-inria.inria.fr/ http://www.myfootballclub.co.uk. http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/08resultat.php http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/tableau/chap2/II-3-1-Q24.pdf http://www.renater.fr http://www.renault.com/en/finance/chiffres-cles/pages/chiffres-cles.aspx http://www.revues.org/ http://www.spamcop.net/fom-serve/cache/329.html http://www.tge-adonis.fr http://www.unixgarden.com/index.php/agenda-interview/ann-barcomb-au-premier-hackathon-perl-europeen http://www.usnowfilm.com/ http://www.voxinternet.org http://www.w3.org/Graphics/SVG/ http://www.w3c.org http://www.webfoot.com/blog/2006/03/05/how-many-computers-does-google-have http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cetudes-09-5-pcf.pdf https://partner.microsoft.com/danmark/40107535Notes
1Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi): http://www.cnrtl.fr/lexicographie/technique, pour cette citation et la suivante. 2Un routeur peut coûter des centaines de milliers d'Euros. Et l'industrie en est florissante: Cisco, fabricant de routeurs et d'instruments facilitant le tout communicationnel, affiche pour 2008 un bénéfice de 8 milliards de dollars pour des ventes s'élevant à 40 milliards de dollars (http://www.cisco.com/web/about/ac49/ac20/ac19/ar2008/financial_highlights/index.html). À titre de comparaison, la même année, Renault affiche des pertes de 900 millions d'Euros pour un chiffre d'affaire de 38 milliards d'Euros (http://www.renault.com/en/finance/chiffres-cles/pages/chiffres-cles.aspx). 3Les notions de licite et d'illicite se reconstruisent aussi à partir de l'internet, comme le montre la problématique du partage de la musique en ligne; mais elles s'en émancipent quand elles rejoignent le domaine de la conception du droit, et structurent le débat moral sur nos sociétés contemporaines. 4Paradoxe étrange que les choses matérielles (tranchées, câbles) soient difficilement visibles et que les plus spirituelles (pratiques cognitives) soient présentées comme les plus évidentes. 5Mot à prendre en son sens le plus général: ce qui existe, et que l'on ne désigne qu'en tant que tel, ou par son contexte. Non pas des objets que l'on éviterait de préciser, mais des entités, des catégories que l'on ne peut traiter d'objets puisque (ou tant que) leur caractère objectivable n'est pas garanti. 6Le témoignage suivant de Jack Goody au sujet de l'internet confirme ce point et conforte l'hypothèse évoquée précédemment: «These new techniques do not at all spell the end of the book but rather the easier and wider distribution of its contents throughout the country and eventually the world. It is extraordinary to sit at my computer in a cottage in rural France and consult the catalog of the Library of Congress in Washington D.C.». [Goody, 2000], p. 159. 7Exemple: le succès du protocole www mène à l'invention des navigateurs en 1996. 8On retrouvera une défiance exprimée en des termes très proches dans l'introduction à l'ouvrage Lire, écrire, récrire [Souchier et al., 2003], qui évoque le «risque d'aplatissement de la communication [du fait d'une] rhétorique [qui] incite, en effet, à représenter la notion de réseau comme une série de couches homogènes allant de l'objet technique à la pratique sociale» (p. 27). 9http://www.webfoot.com/blog/2006/03/05/how-many-computers-does-google-have. Pour 2008, le chiffre de 800 000 est avancé. Une telle note, dans le contexte d'une HDR, invite d'emblée à poser la question de la valeur de telles sources: souvent orales, leur fiabilité et leur pérennité sont sujettes à caution. J'ai de cela une conscience aiguë, et c'est essentiellement un défaut de lettré qui m'anime, quand je désire associer une source écrite à une information que je sais par ailleurs fiable, mais quasiment introuvable dans des ouvrages ou articles scientifiques. Par ailleurs, face aux chiffres évoqués, je raisonne en physicien: plus que l'exactitude numérique, c'est l'ordre de grandeur qui m'intéresse. En 2009, Google utiliserait entre 500 000 ordinateurs et deux ou trois fois plus. Assurément, ni 50 000 ni 5 000 000. En corollaire, on réalise que même si cette entreprise dispose de nombreux sites (et sûrement de tailles variées), certains ingénieurs savent faire fonctionner plus de dix mille ordinateurs ensemble en même temps. L'époque des bricoleurs des années 1990 est bien révolue. D'un autre côté, les commentaires, discours, blogs variés sur de tels chiffres, témoignent de cet essor industriel: il y a désormais un marché pour faire fonctionner ensemble tant de machines. Et il est prévisible que ce marché et ces compétences fassent débat. En quelque sorte, les sources de cette note et des suivantes illustrent aussi l'émergence de ce type de discours. 10http://www.guideinformatique.com/fiche-consommation_electrique_des_data_centers-846.htm. 11En 2008, le coût de la consommation d'électricité de Facebook était évalué à un million de dollars par mois (http://vincentmorin.canalblog.com/archives/2008/11/17/11402371.html). 12Cf. http://www-rp.lip6.fr/~latapy/Vulg/internet.pdf. 13Ces questions ne sont pas toutes sans réponses; mais ces dernières sont souvent partielles et éparses. Ainsi, l'étude des pratiques des acteurs de l'internet relève autant du travail d'investigation que de la synthèse. 14Les économistes seraient certainement les mieux à même de répondre à de telles questions. Ceci dit, il n'est pas sûr que le nombre de personnes s'intéressant à une économie générale de l'internet soit élevé: une recherche effectuée sur http://www.jstor.org en août 2009 avec la requête «(cable operator) OR (internet) OR (routing industry)» donne environ 400 réponses d'articles puisés dans des revues savantes spécialisées dans les thèmes suivants (en anglais): economics (75 revues), business (106), political sciences (63), geography (19), finance (8). Ces articles évoquent souvent les thèmes de la propriété intellectuelle, du commerce en ligne, de la régulation et de l'industrie culturelle, mais aucun n'abordait clairement ces problématiques. Cette enquête mériterait d'être approfondie avec des mots clés à la fois plus variés et plus ciblés, mais semble prouver qu'un tel projet n'est pas si commun. Une autre recherche, à partir des mots «icann» (et) «internet», et étendue à d'autres revues (law [57 revues], history of science and technology [20], sociology [73]) en sus des précédentes, donne 51 articles, dont seulement une poignée s'avère un peu critique, c'est-à-dire dépasse une description plate des institutions et des questionnements standard sur les formes du droit et de la régulation. Dans les faits, le statut particulier de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, http://icann.org), structure de droit privé mandatée par le ministère du commerce américain pour gérer les noms de domaines, et n'ayant de compte à rendre à personne, sert de point d'entrée à un autre type d'études: la «gouvernance» de l'internet. Cf. http://www.voxinternet.org pour un aperçu des axes de recherche sur ce sujet en France et [Mathias, 2008] pour une analyse historique et philosophique. 15Cf. http://www.lemonde.fr/le-monde-2/article/2008/11/14/qui-tire-les-cables-du-cyberespace_1118902_1004868.html pour une première approche, et [Desbois, 2006a] pour un regard de géographe. 16L'informatisation et la mise en réseau des universités pourrait être un excellent terrain pour cette mise en perspective de conquête de marchés où les pressions des éditeurs de logiciels, des fabricants de câbles, des fournisseurs de services (publics et privés) et des éditeurs de revues savantes sont peut-être plus décisives que les incantations au progrès (enseignement à distance, formation tout au long de la vie) ou les discours sur la nécessaire réduction des coûts. Elle préciserait les relations entre entreprises et États évoquées précédemment: en France, contrats entre ministères de l'éducation ou de la recherche avec Microsoft, Adobe, et des éditeurs de logiciels de gestion, de notation, d'organisation d'emplois du temps, d'antivirus, d'antispam, etc. 17Cf. http://www.usnowfilm.com/ et http://watch.usnowfilm.com/subtitled pour les sous-titres en français. 18Aussi appelé «web 2.0». Pour une analyse critique du «web 2.0» et des idéologies qui le sous-tendent, cf. [Rebillard, 2007]. On remarquera à quel point les définitions suivantes mettent, sans grand recul, l'accent sur l'échange social: On trouve dans Wikipédia cette définition: «Le Web 2.0 désigne les technologies et les usages du World Wide Web qui ont suivi la forme initiale du web, en particulier les interfaces permettant aux internautes d'interagir simplement à la fois avec le contenu des pages mais aussi entre eux, créant ainsi le Web social» (http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0). Dans la même encyclopédie en ligne, le «web social» est ainsi défini: «Le Web social fait référence à une vision d'Internet considéré comme un espace de socialisation, un lieu dont une des fonctions principale est l'interaction entre les personnes, et non plus uniquement la distribution de documents. Il est considéré comme un aspect très important du Web 2.0. En particulier, il est associé à différents systèmes sociaux tels que le réseautage social, les blogs ou les wikis» (http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_social). Une autre définition exprime l'idée que les internautes participent chacun à sa manière à une chaîne de production d'information, souvent capitalisée par l'entreprise qui réussit à agréger ces micro-productions: «Web 2.0: cette expression ne désigne pas une évolution technique d'internet, mais une tendance qui consiste à transformer le lecteur internaute en éditeur actif. C'est lui le producteur de contenu (textes ou images). MySpace, où chaque internaute publie ses propres vidéos et musiques, est emblématique des sites dits web 2.0.» (http://www.lentreprise.com/3/3/5/article/16153.html). Note: j'ai fait le choix personnel d'une graphie du mot «web» en minuscules, sans pour autant modifier celles des citations proposées. 19«The world's first and only web-community owned football club», http://www.myfootballclub.co.uk. 20En mettant en avant l'exemple de http://uk.zopa.com, entre caisse d'épargne et tontine à l'africaine. 21Pour ce faire, les auteurs du film insistent au début beaucoup sur la solidarité et le partage que permettrait le web 2.0 avec l'exemple d'hébergement entre inconnus (http://www.couchsurfing.org). 22Traduit à l'URL http://www.cisco.com/web/about/ac49/ac20/ac19/ar2008/letter_to_shareholders/french.html et publié le 3 février 2009. 23Et qui en diffère grandement: http://www.cisco.com/web/about/ac49/ac20/ac19/ar2008/letter_to_shareholders/index.html 24Source: version française de la traduction, cf. note 22. 25Une reprise sans recul des termes principaux d'une idéologie pourrait exemplifier le «pouvoir symbolique du langage» qui s'opère sur des orateurs qui n'ont d'autre issue que de répéter ce qui les structure et les domine [Bourdieu, 2001a]. 26Cf. les incitations fortes de l'Union Européenne à s'intéresser à la notion de «propriété intellectuelle» (de son histoire à ses devenirs). 27Cette notion concilie l'histoire de l'internet (le noyau réduit des personnes sachant écrire sur l'internet en 1990 ou 1995) et une actualité plastique (l'accroissement régulier du nombre de personnes dotées de telles compétences). 28On pourrait objecter qu'un tel logiciel n'a rien à voir avec l'internet. Or, en 2009, même les logiciels les plus classiques relèvent du paradigme de l'internet: il suffit de regarder les mises à jour que leurs éditeurs nous proposent dès que nous sommes connectés. 29Microsoft au Danemark: https://partner.microsoft.com/danmark/40107535 ou à l'INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique): http://www.msr-inria.inria.fr/. 30ex.: RNRT et ANR en France. 31Cf. l'ouvrage de Luc Boltanski et Eve Chiapello [Boltanski et Chiapello, 1999] et les travaux de chercheurs qui étudient l'incidence de l'informatique et de l'informatisation sur les salaires et sur les conditions de travail (Centre de Recherche en Économie et Statistique, Centre d'Études de l'Emploi, etc.). 32Cela vaut pour les industries actuelles. La chimie du XIXe siècle semble au contraire façonnée par les amateurs et les expérimentations personnelles. Un tel constat favorise l'idée d'une comparaison de l'internet avec des techniques sophistiquées du passé et met en doute l'intuition d'une révolution technologique. 33On remarquera le flou de ce terme d'«informaticien», qui va du chercheur scientifique au réparateur d'ordinateur en passant par les personnes dotées d'une compétence ès langages de programmation. 34Dont Pierre Lévy est un des meilleurs ambassadeurs. 35On pourra objecter que la distinction entre comportement appris et savoir acquis est ténue; par exemple, la méthodologie qui permet d'acquérir de nouveaux savoirs peut relever des comportement appris à l'école et dans les écoles de pensée: sorte d'habitus de l'intellect. Le fait est connu: Selon Jack Goody, Claude Lévi-Strauss considère que la conception de l'esprit est culturelle «au sens où ses notions élémentaires étaient intériorisées en tant que comportement appris, non pas en tant qu'énonciations, mais comme structure d'énonciations» [Goody, 2003] p. 266. Aussi insisterai-je ici sur les modalités typiquement sociologiques et communicationnelles du comportement appris: rapport au corps, politesse, intégration de normes, etc. 36Conférence entre experts, par exemple d'un langage de programmation, où se mêlent générosité et compétition. Cf. http://articles.mongueurs.net/comptes-rendus/hack-2007-nl.html ou http://www.unixgarden.com/index.php/agenda-interview/ann-barcomb-au-premier-hackathon-perl-europeen. 37Incluant parfois des formes d'exhibition de l'ascèse. 38Elle excède donc l'habitus de Pierre Bourdieu, qui peut souvent renvoyer à des normes intégrées de façon inconsciente: incorporées. Cf. la note 39. 39Et je ne suis pas sûr que Pierre Bourdieu ait vraiment approfondi ce type de lien entre efficacité cognitive (qui renvoie au registre de la preuve, de l'économie de l'érudition. Ex.: eip=-1) et esthétique collectivisée, donc du ressort de la culture2. 40Le positivisme et le naturalisme de certains ingénieurs d'aujourd'hui pouvant par exemple trouver leur source dans des conceptions théorisées par Auguste Comte ou Claude-Henri de Saint-Simon au XIXe siècle. 41Et qui, pour l'internet, relèvent des mathématiques, de la physique théorique ou de la théorie de l'information. Cf. [Baccelli, 2006] pour un panorama de tels travaux. 42Aveugle ou lucide, l'idéologue est au service d'une cause, même s'il la déguise en concept. Il est donc peu favorable au débat. 43Cf. point 2.1.3 et suivantes. 44Citation extraite du TLFi: http://www.cnrtl.fr/lexicographie/bricolage 45On évoque souvent à son sujet les travaux de Michel de Certeau [de Certeau, 1980a,de Certeau, 1980b]. Je propose ici d'autres références au bricolage du même auteur. 46Toujours [de Certeau, 1975], p. 71. 47Souvent localisées géographiquement comme politiquement. 48Entre l'informatique et les disciplines principales des sciences humaines et sociales. 49La dimension proprement scientifique de l'internet -le fait que des recherches en mathématiques fondamentales lui soient associées- n'apparut que plus tard. 50Il est possible d'imaginer que j'aie alors été l'instrument inconscient d'une idéologie scientiste ou techniciste. Je crois plutôt avoir vécu une période étrangement faste où de nombreux normaliens, jeunes et moins jeunes, se posaient la question de la place de l'informatique et des réseaux dans leur outillage mental. 51Ce projet a été élaboré au printemps 1995, suite à une demande formulée fin 1994 par Anne Guyon, chargée de mission au ministère de la Recherche. 52En l'occurrence, nous y faisions retour en ayant cherché à en éviter les travers: dans ce groupe de travail, parfois large, tous partageaient le désir d'une attitude scientifique, et donc au plus loin des discours subjectifs, qui généraliseraient un témoignage personnel. Cette volonté d'objectivité conduisait indéniablement à privilégier l'expérience -dûment encadrée méthodologiquement- et donc l'explicitation de sa propre pratique. 53Que je concevais comme un passeport minimal pour l'avenir. 54Il faudrait ajouter ici un critère supplémentaire pour expliquer la facilité de cette reconversion: le crédit accordé par des enseignants-chercheurs normaliens à des anciens normaliens. 55Enseigner les mathématiques à l'ENS de Yaoundé (Cameroun), de 1985 à 1987. 56C'est lui qui m'aura fait connaître Jack Goody (qu'il avait fait intervenir au DEA de sciences sociales) et qui aura, à mes yeux, problématisé de la façon la plus féconde la reltion entre histoire et anthropologie. 57Mon statut d'agrégé a ici pu me desservir: de tels postes étaient rares, et il était clair que je trouverais sans trop de difficultés des postes à l'université qui me permettraient de vivre de mon savoir mathématique tout en approfondissant mes connaissances en anthropologie. Mais la discipline vivait des moments difficiles: perdant ses références au terrain suites aux indépendances, toujours cernée par des problématiques (parenté, pouvoir politique local) qui intégraient peu le développement des villes et des États, et se montrant peu réceptive à la technique. 58Je retournerai plus tard au Soudan, mais sans projet professionnel. 59Je n'ai pas la prétention d'affirmer que j'ai forgé à moi seul l'informatique littéraire. L'ENS était aussi un carrefour permettant de rencontrer des chercheurs (aux réflexion plus avancées que la mienne) comme Étienne Brunet, Jean-Pierre Balpe ou Francis Chateauraynaud. Cependant, eu égard à la lenteur et à la façon dont d'autres centres universitaires aborderont ces questions, le contexte de l'ENS fut singulier, en permettant une archéologie spécifique de l'écriture électronique. 60Ce que j'ai détaillé dans la seconde partie de ma thèse[Guichard, 2002], dans une démarche de sociologie réflexive: en prenant pour objet la «cellule informatique littéraire», que je dirigeais. 61Dans les discours publicitaires, l'internet semble exister en soi, sans allusion aux ordinateurs qui en conditionnent l'usage ni aux savoirs requis pour faire fonctionner ces machines. Les chercheurs qui s'intéressent à la «recherche d'information» ne sont pas toujours exempts de ce préjugé: quand l'effort intellectuel et le contexte (capital culturel, etc.) semblent disparaître au profit d'une simple technicité de cette information. 62Cf. point 3 . 63Ce terme a comme sens premier «réflexion spontanée se prenant elle-même pour objet et se thématisant sur un plan spéculatif, scientifique, en élaborant des critères épistémologiques d'ordre rationnel» (http://www.cnrtl.fr/definition/réflexivité). Des auteurs comme Clarisse Herrenschmidt considèrent qu'est réflexif ce qui peut s'énoncer par lui-même: le langage et l'écriture sont tels. Je complète sa définition par analogie avec la dualité mathématique et le structuralisme: est réflexif ce qui donne de nouvelles informations sur lui quand on en regarde l'image en un miroir (on en apprend plus sur un ensemble d'objets en comprenant les relations entre ces derniers). Cette définition donne l'idée de construire des perspectives itératives sur un tel ensemble et c'est celle que je privilégie. Les deux dernières définitions sont certainement équivalentes, mais je ne m'engagerai pas sur ce point, même s'il est clair que la nature réflexive de certaines «choses» (l'écriture) favorise la réflexivité de ceux qui s'y intéressent (les lettrés) et qui au final, la fabriquent et la transforment. 64La langue courante exprime bien la différence de statut entre science et technique: on peut «faire» la première, mais pas la seconde. 65Notion à prendre en un sens suffisamment large pour par exemple intégrer les linguistes qui faisaient grand usage d'une informatique théorique. 66Je peux sincèrement employer ce «nous»: le contact avec ces outils ne se faisait pas sans échanges ni débats. 67Ex.: dont les conclusions sont valides à condition que la distribution statistique étudiée soit gaussienne, cas presque toujours invraisemblable. 68Pour alourdir la critique, on pourrait ajouter que l'informatique produit aussi une ivresse, du fait des répétitions, des allers et retours machiniques qu'elle génère. Cependant, ces discours étaient aussi un peu exagérés: ils avaient une fonction pédagogique, à destination des personnes qui se défiaient des méthodes quantitatives. L'étrange est qu'il en existe en 2009 (et en le même lieu) des expressions encore plus radicales. Cf. la présentation de l'ouvrage «Le raisonnement statistique en sociologie», http://www.cmh.ens.fr/hoparticle.php?id_art=232: «Ce manuel [...] montre que seul un bon qualitativiste peut être un bon quantitativiste». 69Cette introduction de la sociologie quantitative à l'ENS est le fruit d'un phénomène plus général de mathématisation des sciences sociales dans les années 1970-1990 (à laquelle Pierre Bourdieu n'est pas non plus étranger) et semble au final avoir trop bien ou trop peu réussi: d'une part, les méthodes «qualitatives» ont repris de la vigueur (par effet rétroactif, mais aussi du fait d'un désintérêt pour les notions de classes et de larges collectifs qui confine à l'idéologie, cf. ); d'autre part, en favorisant grandement l'économie, qui s'est appropriée nombre de thématiques de la sociologie (forme de l'intervention publique, partis politiques, économie du bonheur, inégalités et pauvreté, etc. Cf. les travaux de l'École d'Économie de Paris, sise à l'ENS). Rétrospectivement, je m'étonne que cette sociologie quantitative ait si peu estimé les effets potentiels de son instrumentation nouvelle alors même qu'était connue la façon dont, un siècle plus tôt, les statistiques, sous l'impulsion de Charles Spearman, avaient transformé la psychologie [Martin, 2003]. 70Cf. point 2.1.2 . 71Depuis peu publicisée sous l'expression (nécessairement anglo-saxonne) de digital humanities. 72Dans ce point, ou entre celui-ci et le précédent, on peut intégrer l'enseignement de méthodes -statistiques, cartographiques, etc.- rendues possibles du fait de la puissance de calcul des machines. 73Le plus souvent à l'occasion des débats de l'Atelier Internet, auquel elle participait et dans lequel elle est intervenue à plusieurs reprises. Cf. [Herrenschmidt, 1999,Herrenschmidt, 2000,Herrenschmidt, 2007]. 74Même si la relation entre l'une et l'autre est de l'ordre de la course poursuite (dans les deux sens). 75Au-delà de nos échanges variés, nous aurons vécu ensemble une expérience sidérante, quand je l'invitais à préciser avec moi, devant les «conscrits» littéraires de la rue d'Ulm, les modalités de l'écriture électronique et leurs incidences potentielles sur les savoirs et leur organisation. Nous fumes littéralement incompris. Preuve indirecte du primat de la pensée dans les classes préparatoires? Ou plus simplement de la difficulté, en France, à penser la notion de technique intellectuelle? 76Le phénomène n'est pas nouveau: cf. les lanternes magiques de Kircher [Perriault, 1989], et la télévision. Mais l'ordinateur confronte systématiquement à cet écart l'auteur de quelques lignes, ou le lecteur d'une page web. 77Article disponible en ligne à l'URL http://barthes.enssib.fr/articles/Guichard-MI.html et reproduit dans le recueil de mes travaux. 78Ce colloque a permis une rencontre fort constructive entre experts en métrologie (de l'internet) et en sciences humaines, en grande partie grâce à la générosité et à l'ouverture d'esprit de quelques personnes, dont Suzanne Beauchamp, directrice à Paris de l'association Les Canadiens en Europe et Michel Cosnard, alors directeur d'unité régionale de l'INRIA à Sophia-Antipolis. 79Quelques références (citées dans l'article original): [Vezin, 1990,Martin, 1996,Petrucci, 1990]. 80Sans omettre les apports de Bruno Latour pour comprendre les instruments construits autour de l'écriture: bibliothèque, centre de calcul, etc. [Latour, 1996,Latour, 1989]. 81Par exemple, dans un établissement universitaire, quand un ancien responsable d'un centre de recherche en informatique théorique qui en devient directeur imagine pour ses étudiants une informatique de service totalement uniformisée. 82On reconnaîtra là les références -explicites dans l'article- aux travaux suivants: [Le Marec, 2001,Edgerton, 1998,Simondon, 1989]. 83En m'appuyant sur les travaux de Lucien Sfez [Sfez, 2002]. 84Alors que certains auteurs américains, comme Lynette Kvasny et Duane Truex, n'hésitent pas à s'appuyer sur les théories d'autres Français, comme Lucien Sfez ou Pierre Bourdieu, pour proposer des analyses réellement rigoureuses. 85Par exemple en m'appuyant sur la première édition, parue en 2001 (donc avant la rédaction de cet article de 2003-2004), de l'«Histoire de la société de l'information» (dont la référence suivante constitue la quatrième édition): [Mattelart, 2009]. 86Il est aisé de rencontrer des personnes possédant les certificats les plus rares de l'excellence intellectuelle dans le domaine scientifique qui tiennent, au sujet de l'internet, des propos qu'on jugerait indignes d'un candidat à la licence. Mais cette situation ne pouvait s'appliquer aux chercheurs que je rencontrais, qui étaient des experts de leur domaine. 87La condition de l'élaboration d'une science n'est pas incompatible avec l'idée que ses fonctions idéologiques ne soient pas diminuées quand sa formalisation et sa rigueur s'accroissent [Foucault, 1969] (p.243). 88Ce qui ne les empêche pas non plus d'être mêlées d'idéologie: cf. note 40. 89Que j'exprimais dans les années 1990. 90Propre à certains physiciens depuis 1999 [Bautier, 2008]. 91Projet qui ne peut faire abstraction de travaux déjà entamés sur ce thème. Cf. [Latour, 2001]. 92Cette chance fut aussi un choix délibéré que certaines institutions ont pu refuser. 93Cf. http://sloan.stanford.edu/mousesite/EngelbartPapers/B5_F18_ConceptFrameworkPt2.html. 94Un expert en lexicométrie. À noter qu'aucune de ces deux formes n'est présente dans le TLFi. 95Du fait de l'universalité de ces protocoles, qui simplifiaient grandement les questions d'ergonomie et d'adaptation à un système d'exploitation, et aussi du fait de la rapide appropriation des outils par les internautes. 96Dont l'apprentissage est d'autant plus difficile qu'il s'oppose a priori aux notions de savoir et de culture: «cherchez l'icone (et non l'icône) déposée en bas et à droite de l'écran; posez la flèche de la souris dessus puis cliquez deux fois». En même temps, ce déferlement de savoirs aussi nombreux qu'illégitimes (au moins dans leur expression verbale) fait penser qu'ils ont des équivalents dans l'univers de l'imprimé. 97Ce troisième thème est absent de ma thèse, mais une part de ma réputation professionnelle à l'ENS s'appuyait sur lui: entre l'«atelier cartographie» que j'y avais monté dès 1992 et le séminaire sur les «apports heuristiques de la cartographie en sciences sociales» qui a commencé en 1997 à l'EHESS, mes intérêts pour la carte, les modalités de sa production, ses apports aux sciences humaines étaient connus; de même pour sa déclinaison éditoriale en ligne, son histoire, et les territoires de l'internet. Ce dernier thème est moins exotique qu'il n'apparaît si on se souvient combien des personnes comme Jean-Claude Chamboredon, pourtant sociologue, et Marcel Roncayolo (assurément géographe) ont approfondi le concept de territoire à l'ENS dans les années 1980. 98Cf. les options synonymie, proxémie etc. du TLFi (http://www.cnrtl.fr) et la cartographie d'univers sémantiques du site http://dico.isc.cnrs.fr/. 99Cf. [Guichard, 2004a] et . 100Terme à prendre ici dans sa banalité extrême, tout comme celui d'«archive électronique»: «empreintes» laissées sur des disques durs par divers protocoles (en des fichiers appelés «journaux» ou logs), le plus souvent pour des raisons sans rapport avec leur usage actuel: analyser les bugs des programmes informatiques des machines Unix pour mieux les éliminer. En 2010, cette notion de trace pose problème et invite à des débats entre informaticiens, chercheurs en sciences de l'information et de la communication et historiens. 101Usages du courrier électronique chez les élèves de l'ENS: http://barthes.ens.fr/atelier/articles/guichard-mai-98.html 102Qui m'ont conduit par ailleurs à refuser de participer à des enquêtes tirant parti des possibilités de s'immiscer dans la vie privée des internautes par le biais de mouchards, et à me maintenir à distance du monde de la publicité en ligne. 103Premières cartes animées de l'histoire du web: cf. http://barthes.enssib.fr/cybergeo/ripe.eu.anim100.gif. 104À mon avis première expérience française d'une enquête grandeur nature tirée de traces électroniques massives: 62 millions de lignes, plus de 4 Go de données. Cf. point 2.2.3 et la quatrième partie de ma thèse: [Guichard, 2002] et http://barthes.enssib.fr/articles/theseEG/theseEGpa4.html. 105Ex.: les Nuer, contredisant l'idée d'une nature garantissant que le mariage entre femmes n'existe pas [Evans-Pritchard, 1973]. 106Les discours sur l'internet constituant pour moi plus un objet qu'un terrain, même si la nuance est parfois mince. 107Dans le contexte de l'informatique, l'architexte est défini comme un «texte produit par un logiciel régissant une écriture située en amont de l'écriture visible et en contraignant les formes» [Jeanneret et Labelle, 2004]. Mais la focalisation sur des architextes à la fois contraignants et instables comme Powerpoint [Tardy et al., 2007] peut aussi occulter l'existence d'outils d'écriture bien plus stables, émancipateurs non par projection idéologique, mais de par le double jeu de contraintes (sociales comme techniques) et de liberté intellectuelle qu'ils apportent (notamment en proposant une ouverture hypertextuelle élargissant de façon incomparable nos -mes- capacités intellectuelles). Cf. LATEXet sa déclinaison Beamer, qui permet des présentations utilsant tout l'arsenal de l'outillage mental, traditionnel comme moderne. Cf. aussi le point 3.2.1 pour une poursuite de cette réflexion. 108Cf. point 2.1.1 . En ces temps, l'internet était paré de majesté: sans article ou doté d'une majuscule. 109Là encore, les premières expériences furent déterminantes: les deux rapports (intermédiaire et final) de ce programme de recherche ont été écrits par des personnes aux disciplines variées (documentation, anthropologie, histoire, mathématiques, sciences de l'antiquité, philosophie, informatique, géographie, etc.). Par la suite, je m'assurerai presque toujours d'un tel métissage disciplinaire quand j'organiserai des colloques et quand j'en publierai les actes. 110Et dont Pierre Bourdieu donnera une preuve [Bourdieu, 2001b]. Ici se conjuguent les dimensions normatives et donc culturelles de l'imaginaire, en même temps que sa dimension inventive (et la preuve de son efficacité) apparaissent. Et, à la démarche d'un Pascal Robert, qui voudrait que l'imaginaire soit déconnecté du réel, perdu dans les limbes de l'utopie, et frein à la problématisation [Robert, 2009], j'opposerai les mots de Maurice Blanchot, qui explicite l'éventail et la fécondité des liens entre image et imaginaire: «ce qui parle au nom de l'image, `tantôt' parle encore du monde, `tantôt' nous introduit dans le milieu indéterminé de la fascination, `tantôt' nous donne le pouvoir de disposer des choses en leur absence et par la fiction, `tantôt' nous fait glisser là où les choses sont peut-être plus présentes, mais dans leur image» ( [Blanchot, 1955], p. 358). 111Ce qui induit un accueil collégial des étudiants (attitude par ailleurs valorisée à l'ENS). 112Un bon exemple étant donné par Christine Ducourtieux, documentaliste, collègue puis membre de l'équipe Réseaux, Savoirs & Territoires, dont l'acuité intellectuelle finira par être reconnue en 2009 quand elle se verra décerner le «cristal» du CNRS (23 novembre 2009). Et aussi pour d'autres: Philippe Rygiel, aujourd'hui maître de conférences en histoire à Paris-I et alors professeur en lycée, Rupert Hasterok, brillant anthropologue qui n'aura jamais de poste, etc. 113Et qui me valurent des jalousies: il aura fallu toute l'énergie, la générosité -et, osons le mot: l'intelligence- d'Étienne Guyon, alors directeur de l'ENS, pour que mon poste et mes projets de recherches résistent à une série de menaces et d'agressions (par ailleurs analysées dans ma thèse). 114Alors directeur de la «Cellule Sciences de la cognition». Cf. http://www-poleia.lip6.fr/GIS.COGNITION. 115Emmanuël Souchier, Yves Jeanneret, Jean-Louis Lebrave. 116Alain d'Iribarne, Georges Vignaux, Georges Salmer, Monique Sicard, etc. 117Le programme et les pré-actes sont toujours en ligne: http://barthes.ens.fr/colloque99/programme.html 118Le pionnier des études sur les requêtes adressées aux moteurs de recherche. 119Cf. [Weissberg, 2001,Le Marec, 2001,Salaün, 2001]. 120Source: http://barthes.ens.fr/colloque99/presentation.html 121Assez massivement présents: la veille (le 2 décembre), j'avais été invité à faire la promotion du colloque devant les participants d'une large journée d'études du RNRT (réseau national de la recherche en télécommunications) qui se tenait à l'ENST (aujourd'hui Télécom ParisTech). 122Avec lesquels le débat ne sera jamais simple. Ils mériteraient une étude approfondie, surtout pour cette période où la plupart d'entre eux raisonnaient en termes de duel dont l'issue garantirait la victoire du Minitel: leurs conceptions en matière d'usages sont parfois étonnantes. 123Qui avaient subi un léger filtrage: absence -avec leur accord- des intervenants ou auteurs de poster aux propos trop «informatiques», de façon à donner une tonalité «sciences humaines» à l'ouvrage. 124Ex.: Jean-Pierre Tubach et Georges Salmer, pour n'en citer que deux. J'entends par ingénieur une personne exerçant ce métier ou qui, par ses enseignements ou ses recherches, participe à la formation dispensée dans les écoles d'ingénieurs françaises. 125Rien ne semble avoir changé: le numéro de la revue Réseaux de juillet-septembre 2009 a pour titre «Les usages avancés du téléphone mobile». Sa présentation commence ainsi: «Le tournant de la mobilité se caractérise par le fait que nos déplacements ne se limitent pas à aller d'un point à un autre le plus vite possible, mais donnent lieu à des formes d'expériences originales qui tissent de manière différente mobilité, activité et sociabilité (ou communication). C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le développement récent des réseaux mobiles à haut débit et des services mobiles multimédia, dont les usages transforment notre vie de tous les jours» (source: http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_usages_avances_du_telephone_mobile-9782707158451.html). Tournant, différence, nouveauté, transformation du quotidien: tout le déterminisme de l'innovation est concentré en ces deux premières phrases. Il ne faut pas pour autant confondre les «ingénieurs», aux opinions et profils fort variés, et leurs porte-parole les plus influents, même si les seconds servent à cadrer les propos et les représentations des premiers. Je retiendrai qu'à elle seule, la revue Réseaux est un objet d'étude idéal (voire l'objet d'une thèse) pour qui veut analyser les relations entre idéologie, ordre du discours et mythe dans l'univers des techniques. 126The Réseaux IP Européens Network Coordination Center. Voir http://ripe.net/legal/copyright-statement.html pour le développement mi-français mi-anglais de cet acronyme. Ces données ne sont plus en ligne. 127Elles sont toujours en ligne: http://barthes.enssib.fr/cybergeo/ripeanim_poponly100.gif, http://barthes.enssib.fr/cybergeo/ripeanim_poponly20.gif, http://barthes.enssib.fr/cybergeo/ripe.eu.anim100.gif, http://barthes.enssib.fr/cybergeo/ripe.eu.anim25.gif. 128Article reproduit dans le recueil de mes travaux [Guichard, 2003b]. 129Mouvement international pacifiste dont je faisais alors partie. Fondé par Bertrand Russel et Albert Einstein, il regroupait majoritairement des physiciens à ses début; ses membres se sont beaucoup battus contre la prolifération nucléaire et ont garanti un dialogue minimal entre l'URSS et les USA aux pires moments de la guerre froide. Ce qui a valu à cette organisation le prix Nobel de la paix en 1995. 130Le titre de ma conférence était clair: «Measuring the digital divide: Europe and Africa from 1992 till 2000». Cf. http://barthes.enssib.fr/archives/pugwash2002. 131Titre en français en ligne de la conférence. Les deux versions, française et anglaise, sont archivées à l'URL http://barthes.enssib.fr/archives/pugwash2003. 132Article présent dans le recueil de mes travaux. La version française est accessible aux URL http://barthes.ens.fr/atelier/geo/Tilburg.html ou http://barthes.ens.fr/articles/Guichard-Digital-Divide.html. 133Cf. et suivante et point 3.1.4 . 134Logiciel de production graphique maintenu jusqu'au début des années 2000. Voici ce que j'écrivais dans ma thèse au sujet de ses effets cognitifs: «Cette étrange inféodation des calculs mathématiques complexes à la représentation graphique, qui les devance, est chère aux physiciens. Ces derniers avouent sans ambage que leurs méthodes de travail en sont transformées: ils se sentent libres d'élaborer des raisonnements sophistiqués, qui s'appuient sur des mécanismes de conviction -ou de contradiction- proprement visuels» [Guichard, 2002]. 135Durant 15 jours de l'été 2001, et à raison d'une photographie des (sommes des) flux toutes les cinq minutes. Soit environ 4000 matrices 30x30. Cet article est en lien direct avec les cartes animées de Renater que j'ai produites et mises en ligne: cf. http://barthes.enssib.fr/cybergeo/Renater01 pour une entrée vers 30 cartes animées. 136Je n'évoque pas ici les résultats statistiques intermédiaires ou finaux. 137À prendre au sens large: cette lecture est ici étendue à tous les flux entrants de tous les protocoles de l'internet (ftp, etc.), et donc non réductible à une lecture du web. L'étude comparait, région par région, les totaux de publications scientifiques et les flux entrants de l'internet. 138Le pouvoir des bibliothèques [Baratin et Jacob, 1996] figure dans la bibliographie de l'article. 139Elle fut aussi ma première collaboration avec des physiciens motivés par les problématiques des sciences humaines. Ce qui me permit d'imaginer assez tôt comment ces dernières seraient affectées, voire recomposées par l'essor de thématiques des instituts des systèmes complexes (ISC-PIF à Paris, IXXI à Lyon, etc.). D'autres collaborations avec les physiciens s'ensuivront: usages du Vélo'v, relation entre traitement du signal et écriture, écriture cartographique, etc. Il est agréable de voir qu'une telle problématique devient populaire en 2010: e-sciences, sciences des réseaux font aujourd'hui l'objet d'une attention particulière en sciences humaines [Rieder, 2007]. 140Travail rendu possible par le RNRT, qui a fait preuve d'une réelle générosité en finançant cette enquête -et peut-être aussi pour me remercier de l'organisation du colloque de 1999. Cette enquête est détaillée dans la quatrième partie de ma thèse (cf. note 57 .) 141Pourcentage aisément applicable à la totalité des internautes de France, au vu de la taille de l'échantillon. 142Citation de Girolamo Ramunni, «Colloque sur l'Histoire du CNRS des 23 et 24 octobre 1989. Un CNRS pour quelles avancées scientifiques?», http://picardp1.mouchez.cnrs.fr/sciences_ex_shs_4.html. Cf. aussi [Pestre, 1996]. 143Colloque du RNRT, Lille, janvier 2003. Journée thématique Réseaux Sociaux de l'Internet, institut des sciences de la complexité de Paris (ISCP), ESPCI, Paris, juin 2004. 3es Rencontres entre Mathématiques Appliquées et Sciences de l'Homme, Toulouse, novembre 2006. 144Avec l'association «les Canadiens en Europe», cf. note 31 . 145Je n'ai pas abandonné ce projet: il est aujourd'hui pris en charge par Thierry Lafouge (professeur à Lyon-I) et Stéphanie Pouchot (maître de conférences dans la même université), qui terminent ces mois-ci la rédaction d'un ouvrage sur les «statistiques de l'intellect», de la bibliothèque au web, de la langue à la scientométrie dans ma collection Cyber (éditions Publibook université). 146Ou les trois à la fois. 147Plasticité des narrations qui peuvent intégrer des évènements récents vs rigidité des textes écrits considérés comme sacrés. 148[Fridel, 2006]. Cf. point 3.1.1 . 149Je rappelle ce fait esssentiel . 150Cf. l'atlas en ligne de l'immigration créé en 1999 (http://barthes.enssib.fr/atlasclio) et l'article qui en explique la genèse aux historiens [Guichard, 2005] (commenté au point 3.2.3.2 ). Aujourd'hui, j'ai intégré cette réflexion de façon théorique (revues savantes en ligne, la cartographie comme écriture) et pratique (diffusion des idées, relations entre intellectuels et «corps social», projet de réalisation de logiciels de statistique en ligne pour historiens et chercheurs en sciences sociales). 151Ces précisions quant à la différence entre recherche publique et privée s'imposent, par exemple au vu de la politique volontariste de financement de thèses et d'embauche de post-doctorants d'un laboratoire comme le SENSE de France-Télécom (Sociology and Economics of Networks and Services, Orange Labs). 152Il n'est pas difficile de rencontrer parmi les chercheurs publiant des articles scientifiques dans le champ des sciences de l'information et de la communication d'actuels ou anciens photographes, éditeurs, informaticiens, écrivains, bibliothécaires, physiciens, grammairiens, médecins, etc. 153Dont certains pourraient être traités d'actants. 154Objet qui, dans les faits, s'est plus imposé aux sciences de l'information et de la communication qu'il n'a été choisi par elles. Si l'internet fait aujourd'hui l'objet de la grande majorité des études de la discipline, on remarquera qu'il y a 10 ans, elle n'était guère plus aventureuse que la sociologie en ce domaine. Cf. aussi [Cotte, 2009], prochainement évoqué. 155Sciences de l'information et de la communication. Le terme est bien trop long, et explique partiellement les difficultés de ses représentants à s'imposer dans le champ académique: on voudrait trouver un nom en «ogue», en «ien», ou en «iste». Technologue serait peut-être bienvenu. En tout cas, j'ai d'énormes difficultés à parler acronymes: SIC ne me conviennent pas plus que SHS. 156Ni ludique ni stratégique: entre bricolage et jeu d'engrenages. 157En application directe de cette proposition, je remarque que le travail de mise en forme de cette HDR m'aura coûté au moins 200 heures de «recherche d'information»: de lectures, de compréhensions (et d'incompréhensions) de pages web, de manuels et d'anciens textes personnels et de mises en application (parfois suivie d'échecs) des trouvailles faites. Pourtant, je connais très bien LATEX, au point de l'enseigner. Dois-je oblitérer cette expérience? Non, car outre le plaisir égoïstement intellectuel qu'elle m'a parfois procuré, elle nourrit directement mes propos théoriques: c'est en étant confronté à la technologie de l'intellect que j'explore que je prends conscience de sa réalité et de sa complexité. 158Cf. le point 2.1 et tout simplement certains de nos enseignements. 159Une anthropologie finement problématisée des pratiques d'écriture informatique d'autrui est facilitée par la connaissance de la programmation, comme celle des réseaux de parenté d'un village l'est par la connaissance de la langue. Or le «I» de «SIC» signale cette compétence. 160Exemples, tirés de [Latour, 2006]: «les sociologues du social [ont choisi de] s'abstenir de toute métaphysique et de couper les ponts avec la philosophie, cette discipline fantaisiste et non empirique qui représenterait, à leurs yeux, la petite enfance des sciences sociales désormais parvenues à maturité» (p. 74). «Si l'on écarte l'obsession des sociologues pour la politique d'émancipation, il faut bien mesurer la difficulté qui se présente dès qu'on veut suivre leur prolifération [prolifération des forces qui font agir les acteurs, note personnelle]. Demander à des enquêteurs de se livrer à de la métaphysique appliquée et les envoyer trotter derrière les acteurs, voilà qui est bien ardu» (p. 75). «Oui, la sociologie est la science des masses d'immigrants, mais que faites-vous lorsque vous avez affaire simultanément à des électrons et des électeurs, des OGM et des ONG?» (p. 375). 161À la saugrenuité d'une succession de «deux-points», je ne résiste pas à la tentation d'insérer une note de bas de page au dessus de l'un d'entre eux. Cette audace typographique n'est pas qu'un abandon de normes suscité par un emboîtement de citations: Roland Barthes fait parfois se succéder jusqu'à quatre telles doubles ponctuations [Barthes, 1980]. 162Les objets techniques sont privilégiés, mais on n'oubliera pas la proximité de cette approche avec celle de Philippe Descola [Descola, 2005], proximité que j'ai d'ailleurs commentée [Guichard, 2008a]. 163Yves Chevalier explicite cette situation particulière des sciences de l'information et de la communication: «une science confrontée à l'interférence du technologique et de théorique, de l'humain et du machinique, du symbolique et du factuel» [Chevalier, 2004]. 164On remarquera qu'à reprendre certains termes de cet auteur, je suis contraint de modifier mon vocabulaire: réapparaît une opposition objet/esprit que j'ai évitée tout au long de ce travail, et qu'impose peut-être Bruno Latour avec son lexique simple. Une étude approfondie de ce dernier serait à mon avis fort instructive. 165S'ils ont compris la variation, ils n'ont jamais imaginé la progression, même linéaire. 166Cf. [Latour, 2007], qui suscite toujours d'étranges rejets de la part des étudiants formés à l'école de la littératie imprimée. 167Et de distance continue: effectivement, un réseau est aisément muni d'une distance discrète. 168Manipulation aisée des nombres, des formules, des graphiques, au point de concevoir les ordinateurs que nous utilisons, ce qui n'est pas rien. 169Dont j'évite personnellement l'usage. 170Cf. [Granovetter, 1973]. D'après http://scholar.google.fr, cet article a été cité 12 298 fois (en février 2010). Ce chercheur facilita la diffusion de ses idées en proposant d'associer ses recherches sur les réseaux (pré-internétiques) à des algorithmes. D'autres auteurs ont considérablement développé cet arsenal méthodologique. Cf. [Wasserman et Faust, 1994]. 171Je n'ose pas dire «dans l'univers des sciences sociales» car les auteurs de telles analyses se revendiquent rarement de ces disciplines. 172On verra comment «rehausser» la problématique des usages, mais ceci ne contredira en rien les remarques précédentes. Cf. le point 3.2.2 . 173Cf. ma critique des approches instrumentalistes. 174EPCV (enquête permanente sur les conditions de vie des ménages): enquête sur les technologies de l'information et de la communication (auprès des ménages) / TIC. 175Une dizaine de laboratoires ont répondu à cette proposition. Les données leur ont été transmises à l'automne 2006. 176Cette logique et ses distorsions semblent devenir la norme: à l'automne 2009, le ministère de la Culture publie les résultats d'une grande enquête sur «les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique» [Donnat, 2009]. Étonnamment, l'enquête concerne beaucoup l'internet et la qualification de l'internaute est la même que celle choisie par l'Insee: personne «ayant utilisé internet au cours du dernier mois» (sources: http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/tableau/chap2/II-3-1-Q24.pdf, http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cetudes-09-5-pcf.pdf et http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/08resultat.php). Ils constitueraient en 2008 58% des Français, dont 12% n'auraient ni envoyé ni reçu de mail. 177Cf. point 2.3.1 et [Fridel, 2006]. 178Cf. l'item 3 . 179On pourrait me faire ici le reproche que j'adresse aux ingénieurs de l'Insee: tordre les résultats de façon qu'ils confortent ma théorie. Je pense néanmoins faire preuve de rigueur dans les énoncés qui suivent et surtout, je m'étonne que l'Insee, naguère expert en analyses sociologiques, n'ait pas publié les conclusions que je présente. On peut aussi penser que les chiffres qui suivent expriment aussi plus l'intégration par des classes sociales aisées des normes dominantes (l'internet signalerait une «insertion dans la modernité») que de réelles pratiques, puisque celles-ci ne sont pas vérifiées. Il est effectivement possible que les chiffres soient infléchis par la conscience qu'ont certains enquêtés des réponses qui les valorisent le plus. Mais cette critique renforce alors le déterminisme sociologique. 180Plus exactement, professions des ménages des enquêtés. 181Représentant respectivement 1799, 509, 1310 et 1310 personnes. 182638 «inclassables» sur 5566 personnes étudiées: 478 «autres» et 160 «inconnus». 183On peut aussi mesurer l'incidence du revenu sur l'appropriation de l'internet: l'Insee classe chaque enquêté dans un quartile, des plus pauvres aux plus riches. La variation d'usage croît alors ainsi: 29, 36, 49 et 62%. Elle semble moins déterminante que le rapport à la culture écrite (mais aussi moins discriminante par construction, puisque les quartiles lissent les différences, par exemple entre une personne très pauvre et une très riche), et il serait intéressant d'étudier l'importance de chaque facteur. 184Loi sur l'économie numérique de 2004: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=. Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&dateTexte=. Loi Hadopi-1 (favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet): http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432. 185Digital Millennium Copyright Act. Cf. http://www.macfergus.com/niels/dmca/cia.html. 186Digital Rights Management, qui semblent abandonnés après avoir été un projet phare de la société Microsoft. 187Navigateur (et proxy) imposé par AOL: http://webmaster.aol.fr/ et http://eutoscos.web.aol.com/eu_tos_primary/ISO-8859-1/html/ISO-8859-1_575.dat. 188Suppression de 1984 (l'ouvrage de George Orwell) de tous les disques durs du «Kindle», le livre électronique d'Amazon en juillet 2009. 189Ce qui invite à distinguer la technologie de l'intellect, et les capacités et libertés qu'elle offre à son «utilisateur» de l'ensemble des objets qui lui sont rattachés mais qui sont conçus dans le but (ou l'espoir) que leur usage conduise à un monopole. Il y a ici une tension à mes yeux féconde. 190Ex.: statistiques offertes par les moteurs de recherche, ou produites par des chercheurs mais sous le contrôle étroit des sites web qui se donnent à voir (API de Facebook, Twitter, etc.). 191Leur «acceptabilité». Notion fréquemment appliquée aux nano-technologies (Cf. les recherches du Cluster 14 de la Région Rhône-Alpes). 192Ex.: entreprises, comme Escrow et Sedo, qui s'autoproclament «tiers de confiance» pour vendre aux enchères des noms de domaines susceptibles d'intéresser des clients. En pratique, elles repèrent et achètent (pour environ 12 Euros) des noms de domaines au nom évocateur qu'elles vendent ensuite aux enchères. Ce sont donc des spécialistes du cybersquatting. À titre d'exemple: le 5 août 2009, le site http://sedo.fr proposait à la vente le nom de domaine stud.fr pour la somme de 1 200 Euros, à surenchérir. Le même site se vante d'avoir vendu au printemps 2009 4 500 Euros le nom de domaine librairie.fr: http://sedo.fr/links/showhtml.php3?Id=2423&tracked=&partnerid=&language=fr. 193Dans la pratique, on trouve souvent derrière une association sans but lucratif avoué une entreprise. Ex.: l'association Spamcop, adossée à l'entreprise Ironport. Cette dernière est désormais la propriété du fabricant de routeurs Cisco. 194La chose peut se décliner en «dénis de services»: attaques de machines sur des ports variés. 195Ex.: Ironport, déjà cité; Barracuda (et ses déclinaisons: barracudacentral et barracudanetworks) semble aujourd'hui le plus connu: http://www.barracuda.com. 196Ex.: Des personnes d'une institution utilisent un système automatique de mail prévenant leurs correspondants qu'elles sont en vacances (vacation). 197Procédure dite du «pot de miel», où le gendarme n'est pas loin de se transformer en voleur pour tester la fiabilité du site qu'il prétend protéger. 198Ce qui d'ailleurs peut faire douter de l'efficacité des applications de l'«intelligence artificielle». 199Certains responsables de réseaux comparent ces pratiques à de l'extorsion de fonds. 200La majorité des informations sur ce point proviennent de la conférence Spam et antispam: gendarmes, voleurs et miliciens qu'il a prononcée le 22 janvier 2007 à l'occasion de l'Atelier Internet de l'ENS. Bien que j'aie son accord pour publier copie de son mail, j'ai fait le choix de complexifier l'accès à son nom -au moins pour que les moteurs de recherche aient un peu de difficultés à en savoir un peu plus sur lui. Pour des raisons analogues, le nom et le numéro IP du serveur ont été anonymisés. 201Où il déconseillait l'usage des répondeurs automatiques de mail. Cf. note 27 et http://www.spamcop.net/fom-serve/cache/329.html. Quelques heures après, deux autres sites rejettaient aussi systématiquement tous les mails de ce domaine. 202Et l'idée de porter plainte contre de telles pratiques est rejetée au motif qu'elle n'aura pas d'effet dans un contexte international. 203Incluant leurs préjugés quant aux besoins d'autrui: n'oublions pas que la motivation première de ces entreprises est commerciale. 204Cet article est accessible en ligne à l'URL http://barthes.enssib.fr/articles/Guichard-mythe-fracture-num.pdf et reproduit dans le recueil de mes travaux, avec une attestation de l'éditeur certifiant sa publication prochaine. 205Par la suite, les guillemets autour de cette expression sont supprimés pour faciliter la lecture. 206Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, http://www.credoc.fr. Pour cette analyse, je me suis essentiellement appuyé sur la note de synthèse no 191 du Crédoc (mars 2006, http://www.credoc.fr/pdf/4p/191.pdf) et sur le rapport que lui ont commandé le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi et l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (2008, http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-credoc-2008-101208.pdf). 207Source: second rapport de la note 37. On avait déjà repéré de telles formulations à partir de pourcentages: cf. l'enquête de l'Insee (point 3.1.1 ). 208Quant à une éventuelle relation entre la distance aux réseaux et d'éventuelles ségrégations sexuelles, sociales ou territoriales. 209La question était d'estimer la part du capital social dans la fracture numérique. Les auteurs du Crédoc considèrent qu'elle est nulle. 210TIC: Technologies de l'information et de la communication. On pourra me reprocher de détourner les propos des auteurs car la phrase exacte est: «il existe un consensus pour faire des TIC le moteur d'une nouvelle révolution industrielle (`informationnelle') conditionnant la croissance économique». Mais entre l'expression originale et mon interprétation, qui se réduit à penser que les auteurs partagent le consensus qu'ils évoquent, je crois la distance faible. 211The President's New Markets Trip: From Digital Divide to Digital Opportunity. http://clinton3.nara.gov/WH/New/New_Markets-0004/20000417-4.html. On peut aussi considérer que de tels propos apparaissent réellement en 1992 avec les projets d'Al Gore sur les inforoutes. Cf. [Mattelart, 2009] pour des précisions, qui montrent par ailleurs comment la dimension sociale du projet politique initial a vite disparu. 212Cf. 2.2.2 et [Guichard, 2003a]. 213Propos de Carly Fiorina en 2000 -alors présidente de Hewlett-Packard- en réponse (attendue) à une question de Bill Clinton et repris par Daniel Pimienta [Pimienta, 2007]. 214Au sens probabiliste. 215Colloque L'Internet: Espace public et Enjeux de connaissance, Collège International de Philosophie, Paris, Carré des Sciences, 20-21 janvier 2006. Cette partie s'inspire de l'article qui fait suite à ma communication, intitulé «L'écriture scientifique: grandeur et misère des technologies de l'intellect» [Guichard, 2008b], disponible dans le recueil de mes travaux et en ligne: http://barthes.enssib.fr/articles/Guichard-CIPH2006.pdf. 216Au sens du TLFi: «Langage documentaire fondé sur une structuration hiérarchisée d'un ou plusieurs domaines de la connaissance» (Note datant de la rédaction de l'HDR). 217Et donc peu audibles pour les spiritualistes. 218Montrer, avec des exemples historiques, l'inutilité d'ostraciser la commercialisation de l'outillage mental ou de faire appel à des théories évolutionnistes le concernant. 219Je faisais ici référence aux responsables des réseaux informatiques des universités françaises, dont les pratiques (parfois contraintes) et représentaions mériteraient une thèse (cf. note 16 ) et à un article dans la même revue de Michel Rocard, qui expliquait comment la Commission Européenne espérait toujours imposer son projet de loi sur la brevetabilité des logiciels, malgré son rejet en 2005 par l'Assemblée Européenne. 220Qui, par un tour de passe-passe, peut devenir sujet, voire concept: la dernière écume sémantique étant, en 2009, celle de «l'internet des objets». 221Ce fait s'accorde donc définitivement avec les points 2.1.3 et 3.1. 222Part croissante de la cartographie dans mes enseignements d'informatique littéraire (Ulm, à partir de 1992), association de la pratique cartographique avec une réflexion épistémologique et historique (séminaire «Apports heuristiques de la cartographie en sciences sociales», EHESS, à partir de 1997). Cf. notamment le point 2.1.2 , la note 50 , le point 2.1.4 et le point 2.2.3 . 223Je pense à des chercheurs comme Alexandre Gefen (http://www.fabula.org), Pierre Mercklé (http://www.liens-socio.org/) et Marin Dacos (http://www.revues.org/). Gérard Noiriel, Philippe Rygiel et moi-même avions profité d'une telle expérience réflexive quand nous avions fondé la première revue savante de SHS en France en ligne: les «Actes de l'histoire de l'immigration» (http://barthes.ens.fr/clio, 2000). 224Nationalités réelles pour les pays les plus connus, les plus stables, et ne relevant pas de colonies. Les regroupements étaient plus ambigus pour les autres contrées. 225Taux de féminité de chaque nationalité, pourcentage de la nationalité dans le nombre total d'étrangers du département. 226Produites à la volée, et gardées en mémoire une fois réalisées, ce qui offrait un gain de temps appréciable: à cette période, le calcul d'une carte inédite pouvait prendre 10 secondes. En 2010, le temps de réalisation d'une nouvelle carte est insensible. 227J'avais réalisé en 1996 un logiciel de lexicométrie pour Macintosh à télécharger, Koutosuiss, qui n'avait eu de succès qu'à partir de 2000. Ce logiciel fonctionne toujours sur les machines dotées des OS antérieurs à la version 10.3, et une version simplifiée est disponible en ligne à l'URL http://barthes.enssib.fr/KT. 228Référence pour l'édition de 2003: http://barthes.ens.fr/clio/revues/AHI/articles/volumes/atl.html. Pour l'ouvrage: [Guichard, 2005]. Cet article est reproduit dans le recueil de mes travaux et disponible en ligne aux URL http://barthes.ens.fr/Guichard-Atlasclio.pdf et http://barthes.enssib.fr/Guichard-Atlasclio.html. 229Qui parfois piétinaient à l'entrée de l'université malgré toutes leurs compétences. C'est aussi ce contexte qui m'avait incité à demander puis obtenir un financement au ministère de la Recherche afin de développer la revue en ligne Actes de l'histoire de l'immigration. 230Une vingtaine de cartes produites chaque jour, comme en 2009. Cette apparante stagnation du lectorat depuis l'an 2000 s'explique par le fait qu'entre 2004 et 2006, l'atlas a été hors-service suite à un déménagement puis à une panne définitive du serveur http://barthes.ens.fr. 231En 2003, le serveur http://barthes.ens.fr était consulté en moyenne chaque mois par 45 000 réelles personnes (dénis de service, moteurs, robots non comptés; imagettes, erreurs non recensées), soit 2250 par jour ouvré. Soit 1 000 000 de hits et 60 000 sessions par mois, dont 12 000 sessions assidues (plus de trois pages consultées à la suite: de l'une à l'autre) et 6 600 très assidues (plus de cinq pages): ce qui correspond à une moyenne de 300 lecteurs très assidus chaque jour ouvré (autant qu'une bibliothèque spécialisée). Au regard de ces chiffres, le taux de demandeurs de cartes (20 cartes par jour ouvré) ne dépassait donc pas 4% des lecteurs. 232[Guichard, 2002], 3e partie. 233On peut s'étonner que des outils en ligne ne soient pas maintenus par les institutions qui les hébergent. Comme ces installations sont le plus souvent réalisées sur le temps libre des chercheurs ou des ingénieurs, il faut parfois des années pour remettre sur pied de tels sites. Ce dernier point renvoie à la chute de l'embauche dans l'univers de la recherche française. 234Cf. le point 2.2.2 . 235Groupement d'Intérêt Public du Réseau National de télécommunications pour la Technologie, l'Enseignement et la Recherche, http://www.renater.fr. 236Qui proposait une sémiologie graphique réduite aux cartes fixes et le plus souvent en noir et blanc [Bertin, 1967]. 237Avec de très grandes variations. Le modèle théorique de ces lois montre que leur variance est souvent infinie. 238Cf. http://barthes.enssib.fr/cybergeo/Renater01 pour des exemples de cartes et le détail des choix définitifs. Pour rappel, les flux inférieurs à 20 Mo/15 mn ne sont pas représentés; ceux entre 20 et 100 Mo/15 mn sont représentés en vert, avec une épaisseur fixe (1 point); les flux supérieurs à 100 Mo/15 mn sont dessinés en rouge, et leur épaisseur est proportionnelle à leur racine carrée. La fréquence de l'animation varie entre 25 images par seconde et une image toutes les deux secondes (5 choix possibles). 239Déjà mentionné au point 2.2.3 . 240Premier langage répandu de description graphique d'objets géométriques, aussi appelés vectoriels. C'est un langage à piles. Le PostScript, combiné avec son traducteur RIP (Raster Image Processing) était réputé pour piloter les imprimantes laser de haute qualité des années 1990 et a contribué à faire la fortune de la firme Adobe. 241Graphics Interchange Format, qui compresse bien les images composées de zones d'une même couleur. 242Souvent réduit à son stade le plus ordinaire quand sont présentés les langages par balises (deux niveaux). 243Bien entendu, ce méta-programme prend aussi en charge la seconde étape. 244Cf. les stratifications proposées par les théoriciens de l'informatique (les 7 couches OSI ou ISO, les piles IP). Elles sont aussi précisées par des chercheurs en critique littéraire, par exemple quand sont exposées les notions de paratexte, de péritexte et d'architexte [Genette, 1987]. Le détail des emprunts conscients ou inconscients des informaticiens aux traditions littéraires et scientifiques de structuration du texte, accompagné de la façon dont, en tant qu'architectes de l'écriture contemporaine, ils infléchissent, explicitent voire formatent les divers étagements de l'écrit pourrait profiter à toutes les disciplines concernées. 245Cf. [Guichard, 2008b] et le commentaire de cet article (point 3.2.1 ). 246Programme interdisciplinaire «Société de l'information» 2002-2005. 247Dont Marc Barthélémy (physique), Henri Desbois et Loïc Grasland (géographes), Marina Duféal (doctorante en géographie, aujourd'hui maître de conférences), David Horn (un étudiant de l'Enssib qui a réalisé une excellente bibliographie sur la cybergéographie: http://barthes.enssib.fr/cybergeo/biblio), et trois enseignants-chercheurs en informatique de l'ENST (École nationale supérieure des sciences des télécommunications, dénommée depuis 2008 Télécom ParisTech): Annie Danzart, Jean-Claude Moissinac, Christine Potier. 248W3C: World Wide Web Consortium, http://www.w3c.org. SVG: Scalable Vector Graphics (graphiques XML pour le web), http://www.w3.org/Graphics/SVG/. XML: Extensible Markup Language. 249Incidence déjà précisée quand je commentais l'article [Guichard, 2008b] (point 3.2.1 ). 250Où, comme le texte avec lequel l'image se confond, elle «tisse des relations `intertextuelles' avec les autres textes» [Souchier, 2007]. 251Peut-être depuis plus de 3000 ans, si on se fie à la carte des mines d'or de Wadi Hammamat (vers -1150), aussi appelée papyrus de Turin. Les cartes d'Ératosthène ne nous sont pas parvenues, mais nous pouvons imaginer qu'elles contenaient aussi du texte. Les cartes de Madaba (cf. l'étrange site web http://servus.christusrex.org/www1/ofm/mad/index.html) et surtout de Peutinger, dérivée des cartes romaines ( ~ 250, XVIe siècle) pour ne citer que les plus connues des cartes anciennes de l'oekoumène, regorgent de texte. Cf. http://www.hannibal-dans-les-alpes.com/table-de-peutinger.htm pour une présentation fort pédagogique qui montre Lyon au Sud de Vienne, et http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe00.html pour une excellente exposition du dernier original et des fac-similés. 252Cf. la pour une première mention de ce fait. 253http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/presidentielle/presidentielle-2002. 254URL http://barthes.enssib.fr/presid2002. J'avais aussi réalisé ensuite des atlas du même type, pour les élections régionales de 2004 et pour le référendum de 2005. Ces atlas ne sont plus maintenus. 255À l'exception de la Lozère, le premier candidat y domine le second. 256Correspondant donc aux trois candidats précités. 257Le pourcentage total Chirac + Jospin est de 35% à Montpellier, 32% à Nîmes, 34% à Béziers, 26% à Aigues-Mortes, 24% à Beaucaire. 258En 2005 puis 2006, le ministère de l'Intérieur (Direction des système d'information et de communication), après avoir désiré m'acheter ce logiciel, a demandé sa reproduction-adaptation dans le cadre d'un appel d'offre de 90 000 Euros. Cf. annonce 240, 04/04/2006, BOAMP 066 B, dépt. 75: «Objet du marché: étude, développement et intégration d'un outil d'affichage des données électorales sous forme de cartes au travers de navigateurs WEB». Il semblerait qu'il ait profité au président actuel de la République: des collègues géographes qui ont vu le produit final m'ont assuré qu'il est la copie conforme de mon logiciel. En revanche, sur la vingtaine de députés et sénateurs de l'opposition à qui j'avais proposé en 2006 d'expliquer les avantages de cet atlas électoral, seulement deux d'entre eux m'ont adressé une réponse polie, mais ils n'ont pas donné de suite. 259[Guichard, 2006]. Cet article est reproduit dans le recueil de mes travaux et disponible en ligne aux formats pdf et html à l'URL http://barthes.enssib.fr/articles. 260Cf. http://barthes.enssib.fr/atelier/geo/communesfr.html. 261En considérant la chaîne électorale qui va des conseillers municipaux aux sénateurs (Paris compte 720 conseillers). Les données sont celles du recensement de 1992. 262Cet article est reproduit dans le recueil de mes travaux. 263Essentiellement de la 71e section (sciences de l'information et de la communication). Je crois que de telles «coïncidences» définissent aussi précisément le périmètre et le dynamisme d'une discipline que son intitulé ou son histoire. Aujourd'hui, la majorité des questions relatives à l'internet, à la technique, à ses relations à la science et à la société, aux croyances et aux discours sur ces points, en bref de nombreuses questions d'actualité sont abordées par un nombre croissant de chercheurs de cette section. 264Colloque Figures du lettré et technologies numériques: une chimère contemporaine?, CNRS-BPI, tenu à l'INHA les 28 et 29 mars 2007. En juin 2008, suite au colloque que j'avais organisé sur le thème Écritures: sur les traces de Jack Goody, cet anthropologue est revenu à l'Enssib proposer une conférence qui prouvait la relation étroite entre culture et technique: cf. http://barthes.enssib.fr/articles/Goody-Enssib-AIL-4juin08.pdf. 265[Guichard, 2008a]. Article reproduit dans le recueil de mes travaux. La version française est accessible aux formats pdf et html à l'URL http://barthes.enssib.fr/articles. 266Je préciserai davantage cette articulation dans l'article commenté au point 3.3.4 ([Guichard, 2008a]). 267Ce qui était en fait le postulat de l'équipe Réseaux, Savoirs & Territoires dès ses débuts: raisonner en termes de territoires pour mieux comprendre l'internet, du fait de l'efficacité méthodologique de ce concept de territoire, bien connue des géographes. 268[Guichard, 2008a]. Article présent dans le recueil de mes travaux et accessible à l'URL http://barthes.enssib.fr/articles (toujours aux formats pdf et html). 269Conférence à l'Atelier Internet Lyonnais, 4 juin 2008: http://barthes.enssib.fr/articles/Goody-Enssib-AIL-4juin08.pdf. 270Ici, le singulier est employé à des fins stylistiques: on pourrait employer cette expression au pluriel. De même pour «les cultures en construction». 271Une citation de Paul Ricoeur à propos d'Henri Bergson illustre parfaitement la tension que peut induire l'écriture (et la science) entre conceptions du monde, et donc entre une objectivité acquise et une autre, construite: «L'idée que du non-spatial s'épaississe en spatialité n'a pas de sens objectif (Ricoeur, Philos. volonté, 1949, p. 205)». Source: http://www.cnrtl.fr/definition/spatialité. Faut-il alors faire retour à la nature irréelle, imaginaire des nombres complexes devenus points du plan au XVIIIe siècle? Cf. aussi le point 3.3.1 et suivantes. 272Et à mes limites. Je ne prétends pas avoir exploré toutes les limites de l'écriture. Et je sais que mon appétit pour cette démarche exploratoire n'est pas émoussé. 273On aurait pu retrouver ces attributs de la cartographie par d'autres biais. Mais il me semble manifeste que l'internet a permis d'en simplifier considérablement le repérage et l'approfondissement. 274Même si c'est dans ces cas que nous y croyons le plus: l'idée que la vérité n'existe pas n'a-t-elle pas aujourd'hui valeur de vérité? Jusqu'à quel point cette vérité structure-t-elle nos conceptions notre monde? 275Les chercheurs qui veulent prouver la fragilité de la notion de vérité ne sont-ils pas convaincus de la véracité de leurs propres démonstrations? 276Et la part des savants et des débats n'est pas mineure: pensons à la puissance actuelle des paradigmes économiques dans notre lecture du monde. Pensons aussi aux réels efforts d'appropriation des pensées singulières comme celles de Michel Foucault ou Claude Shannon (cf. ) ou collectives comme la «critique artiste» [Boltanski et Chiapello, 1999] pour édifier les cadres de pensée qui sont aujourd'hui si opérationnels, même s'ils ne nous conviennent pas. 277Cf. point 2.2 . 278Le point précédent montre que ce qui était de l'ordre du sentiment personnel peut se démontrer.
Page créée le 11 octobre 2010 ,
modifiée le 25 novembre 2012
